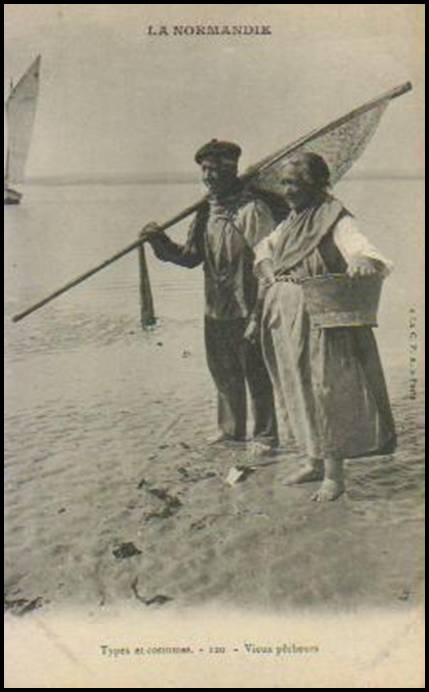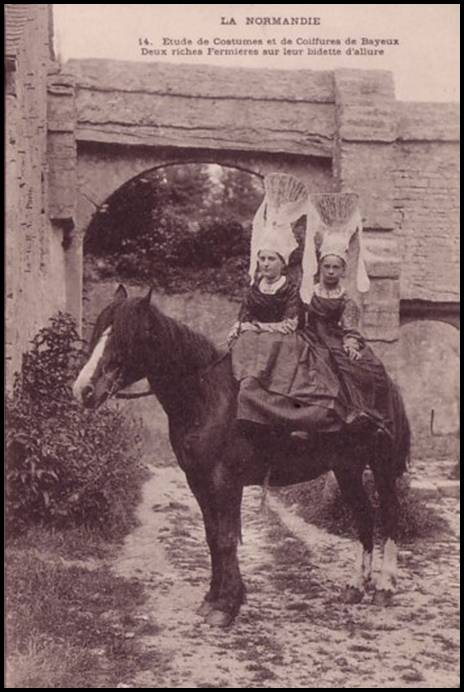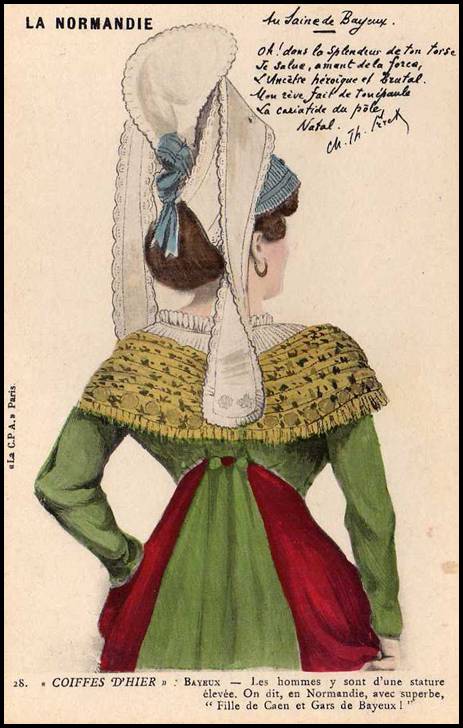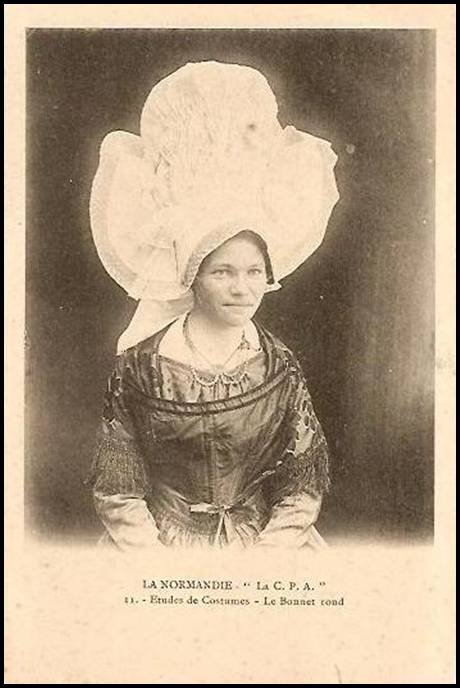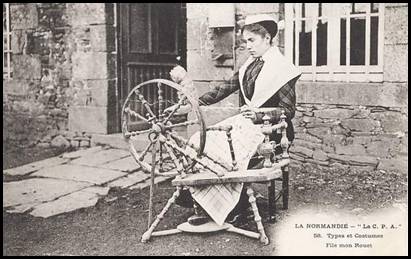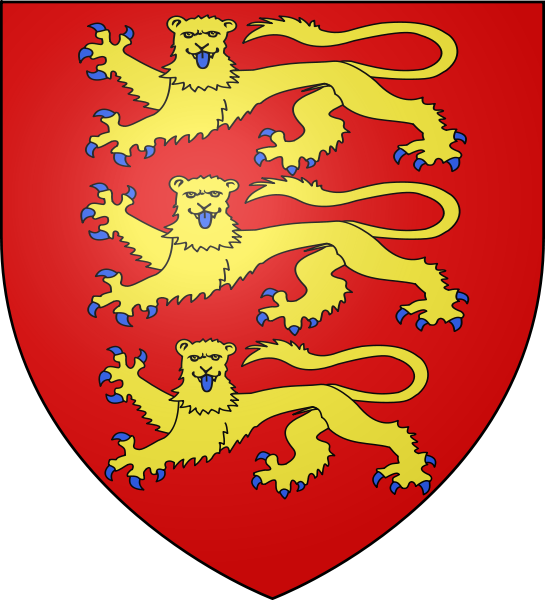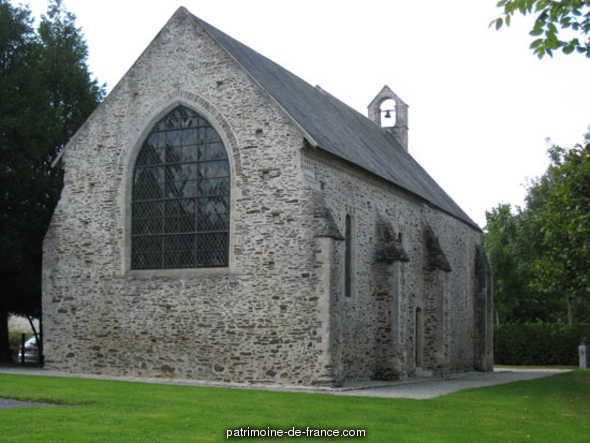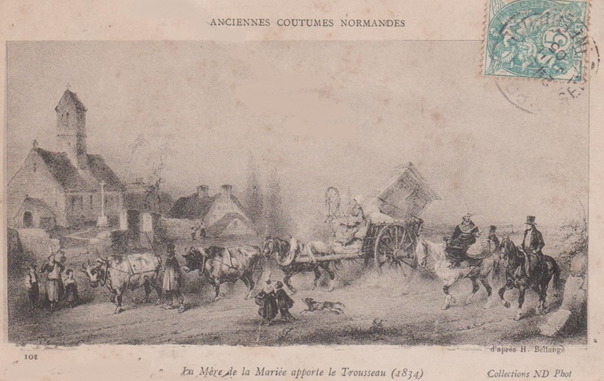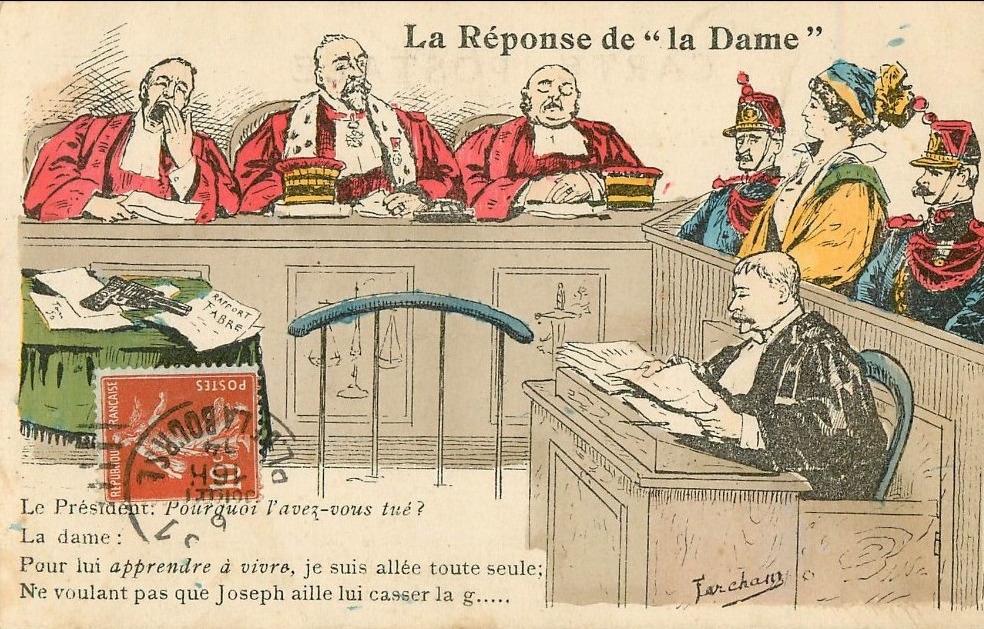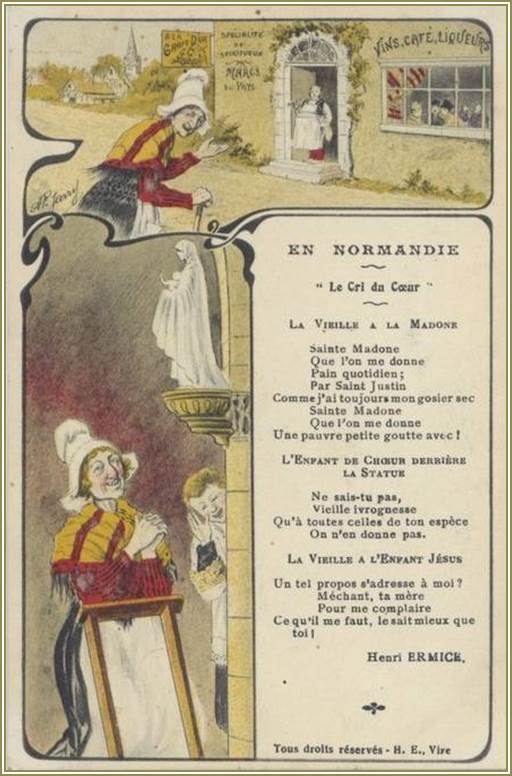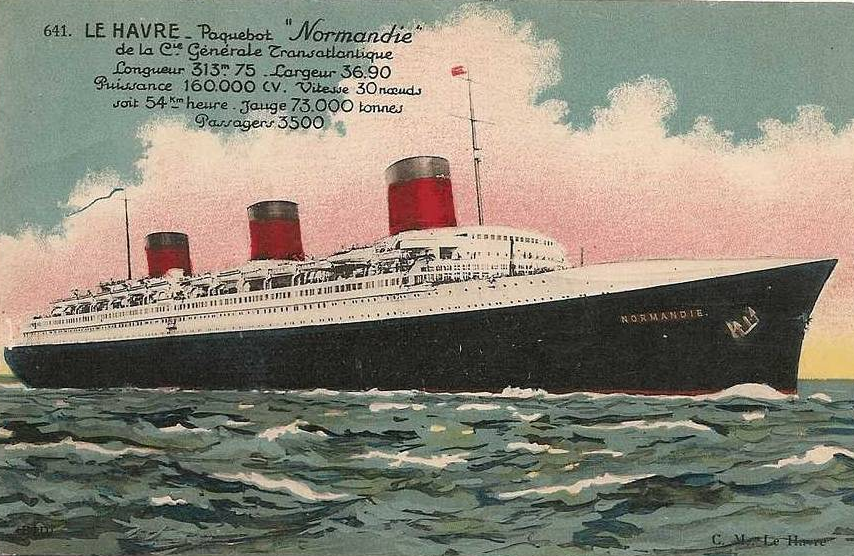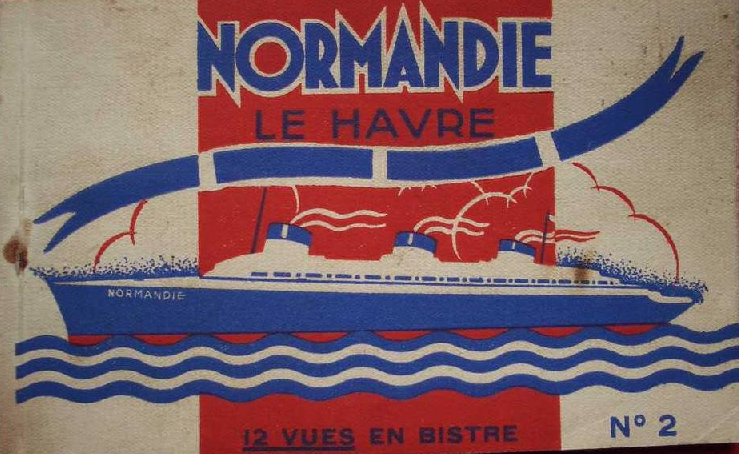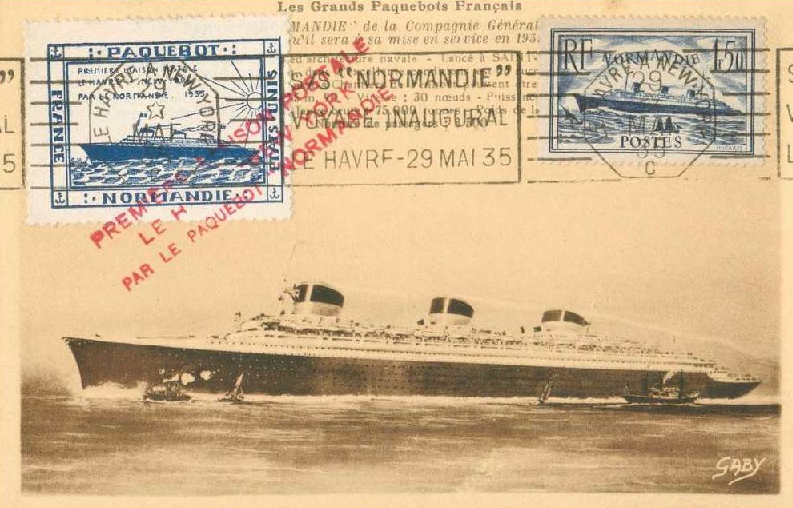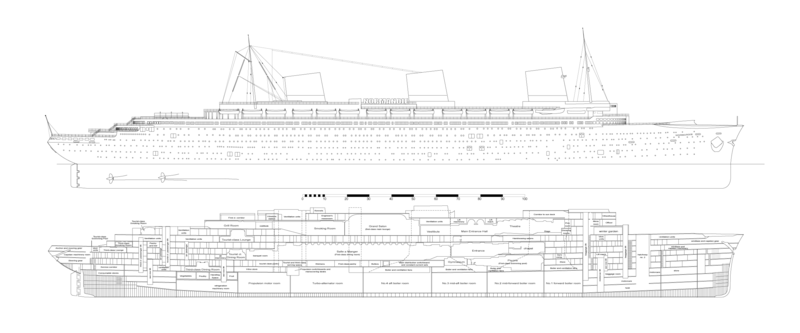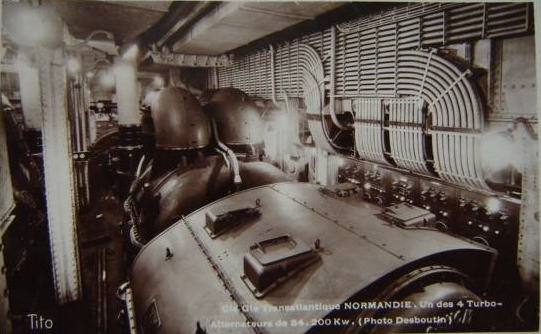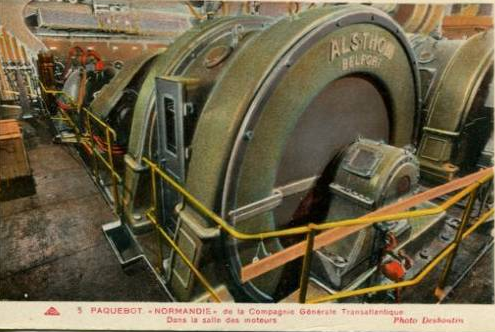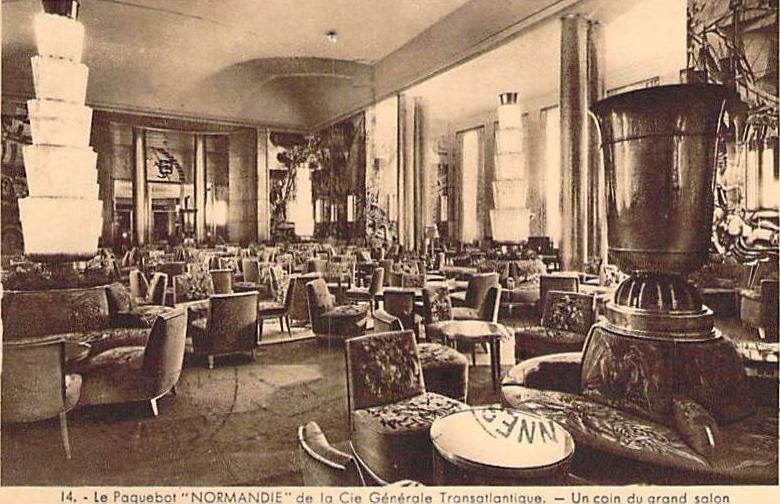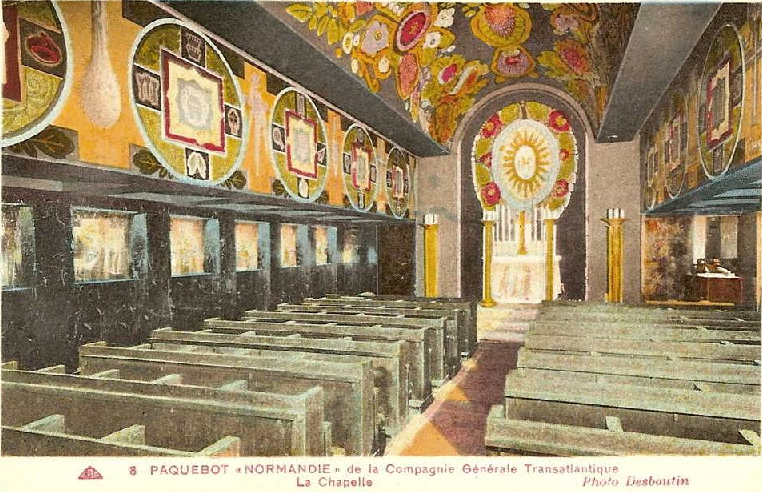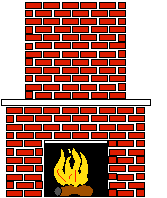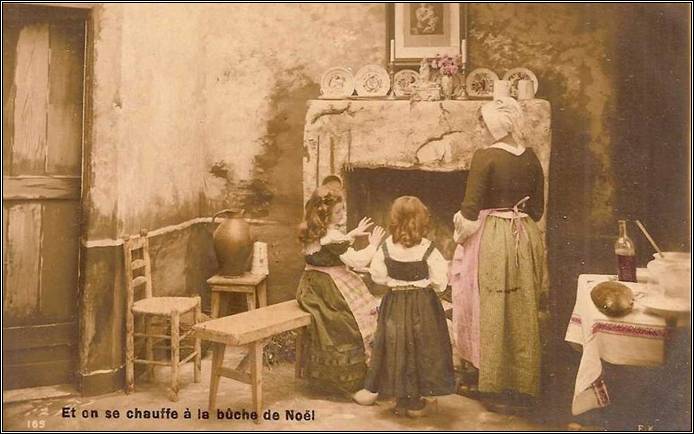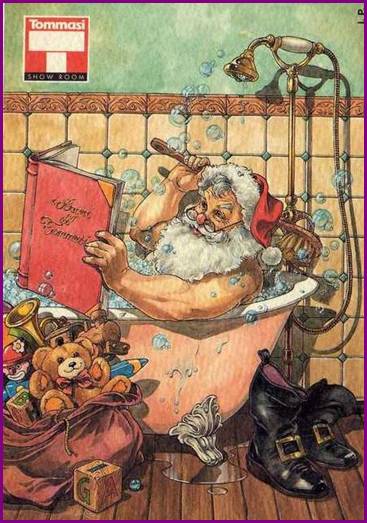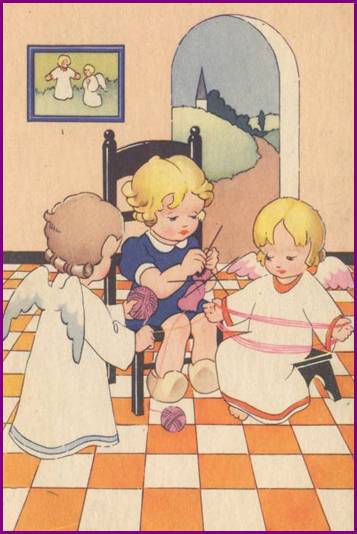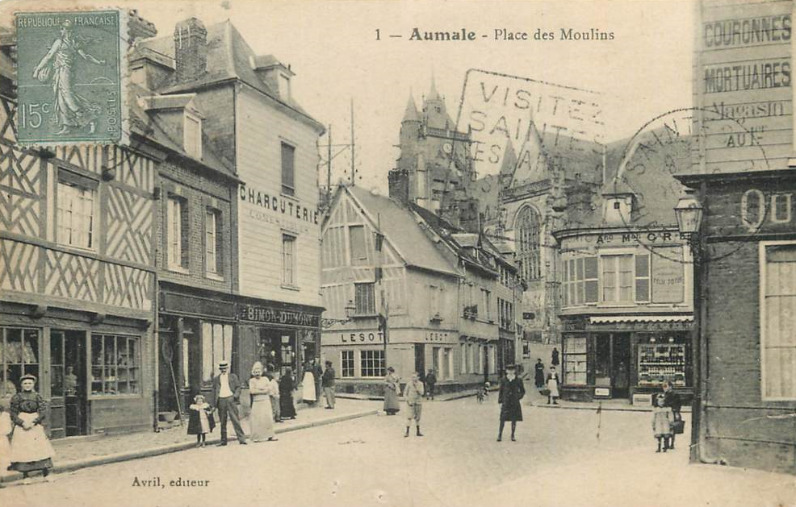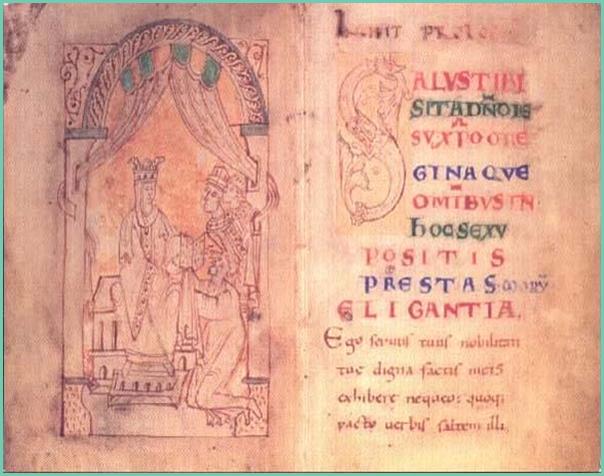|
| ||
|
| 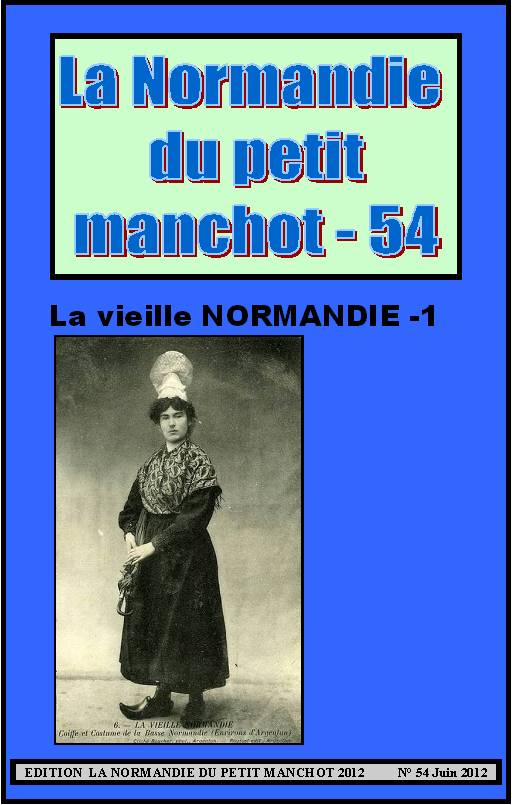 | |
|
| ||
|
| 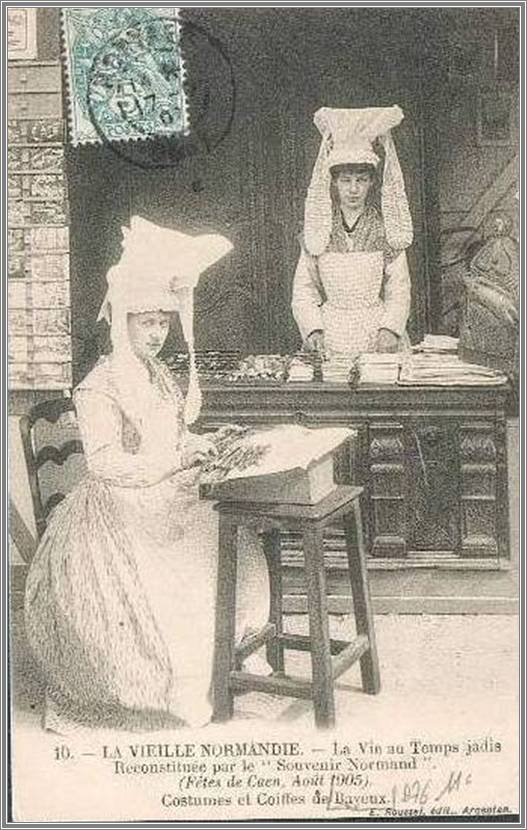 | |
|
| ||
|
| 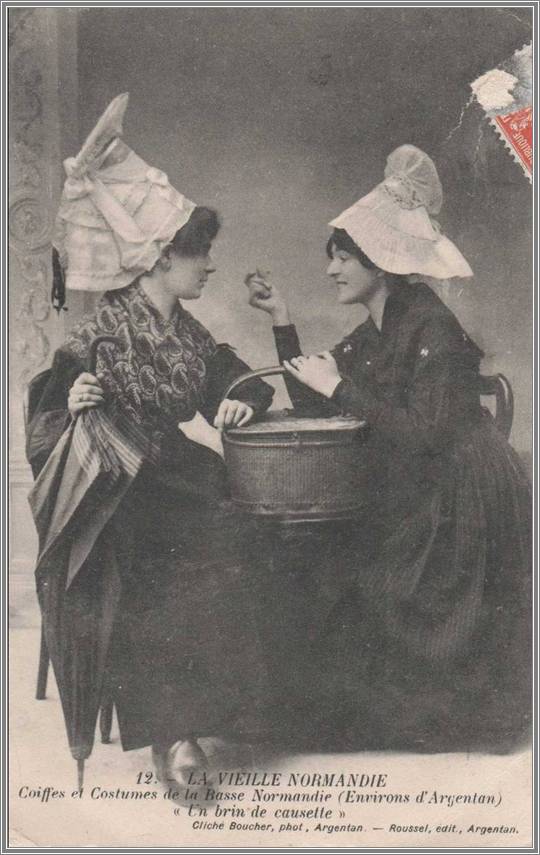 | |
|
| ||
|
| 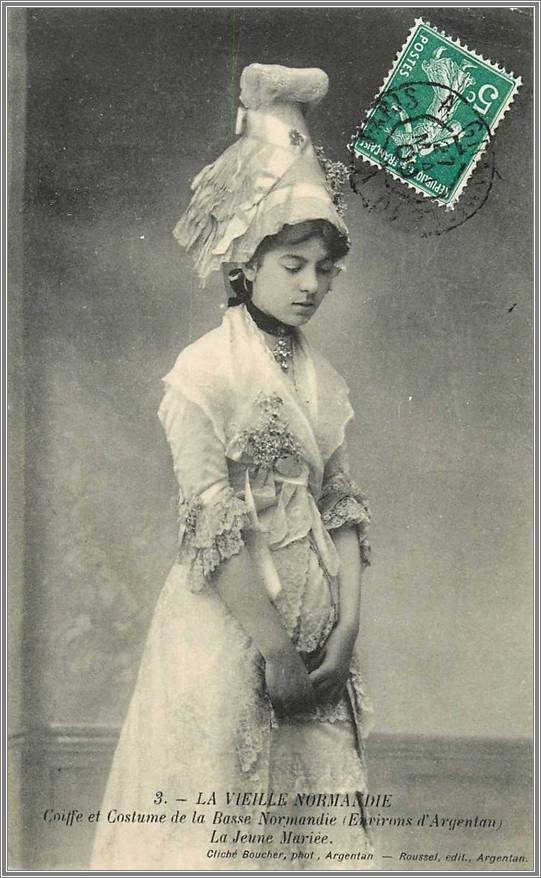 | |
|
| ||
|
| 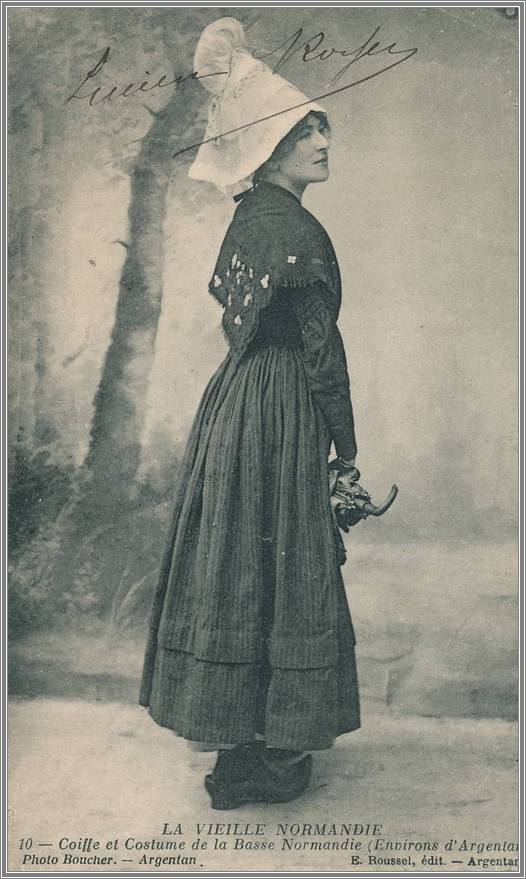 | |
|
| | |
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| | |
|
| 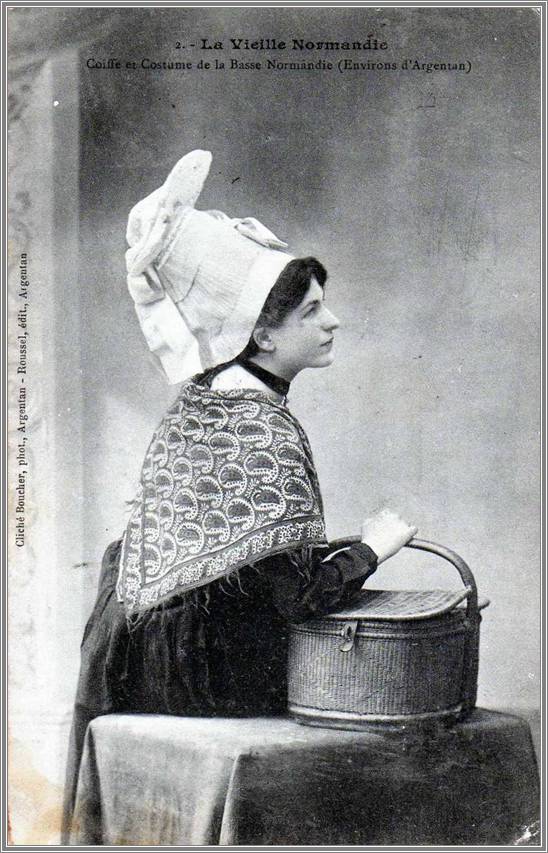 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| | |
|
| 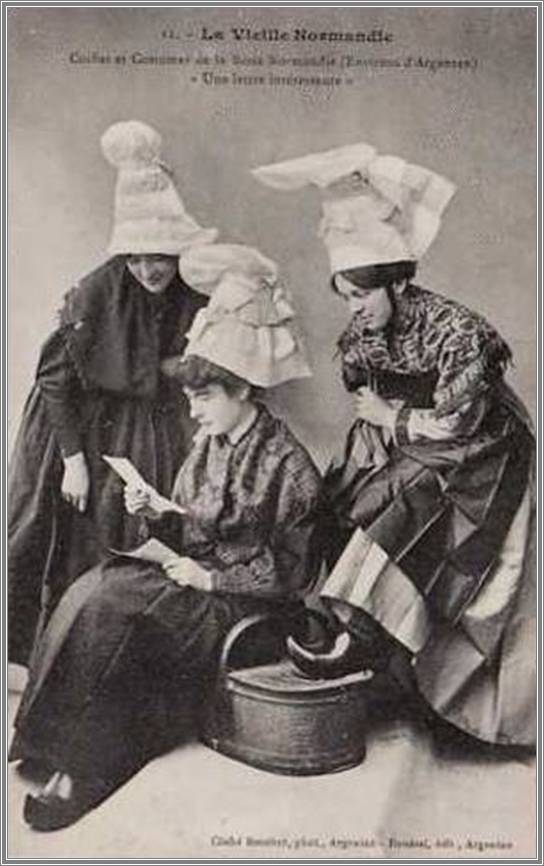 | |
|
| | |
|
|  | |
|
| ||
|
| 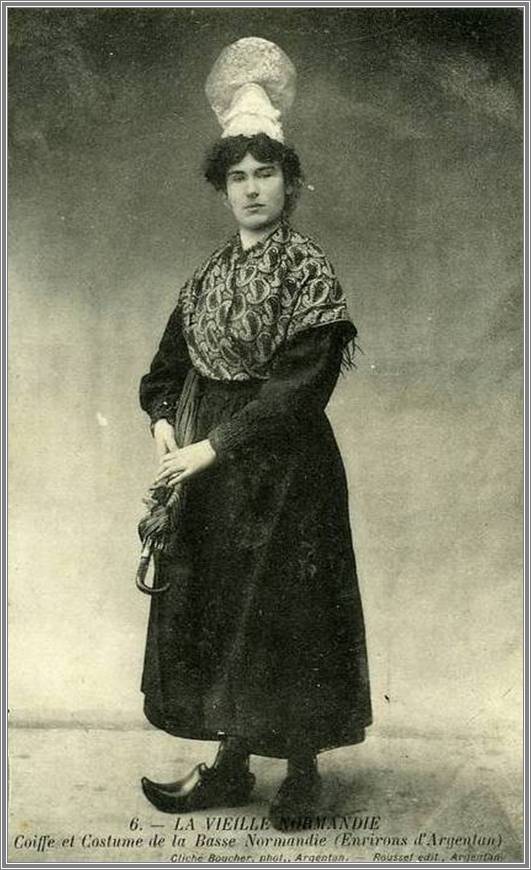 | |
|
| ||
 | ||
|
|
|
| ||||
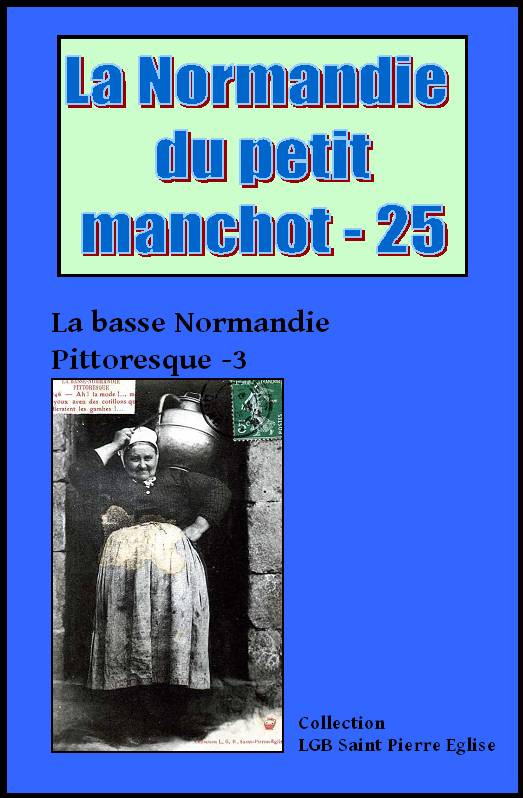 | ||||
|
|
Editeur LGB - Saint-Pierre-Eglise Jean-Baptiste Le Goubey
Différentes signatures rencontrées sur les cartes postales :
Coll. L. G. B., St-Pierre Eglise - Cliché A. V., série "La Basse-Normandie Pittoresque" (avec la mention "Imprimerie A. Thiriat & Cie, Toulouse" dans un logo circulaire au dos, fin des années 1910)
Le Goubey, édit. St-Pierre-Eglise, série "La Basse-Normandie Pittoresque" (avec la mention "Imp.-Phot. A. Thiriat & Cie, Toulouse" au dos, fin des années 1910)
Editions Normandes Le Goubey, St-Pierre-Eglise (inscrit au dos), série "La Normandie Pittoresque" (années 1930) | |||
|
| ||||
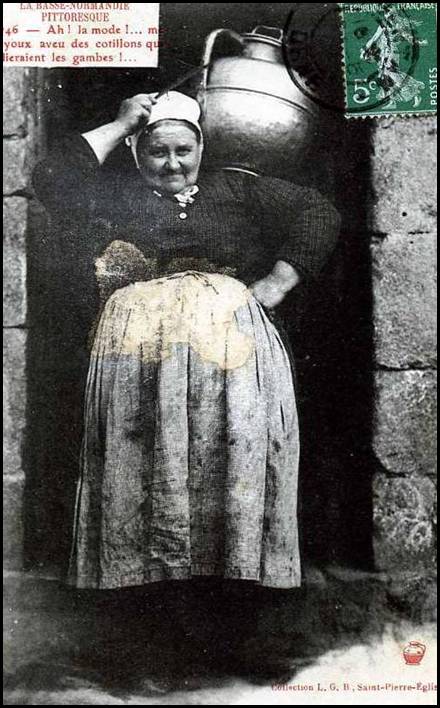 | ||||
|
| ||||
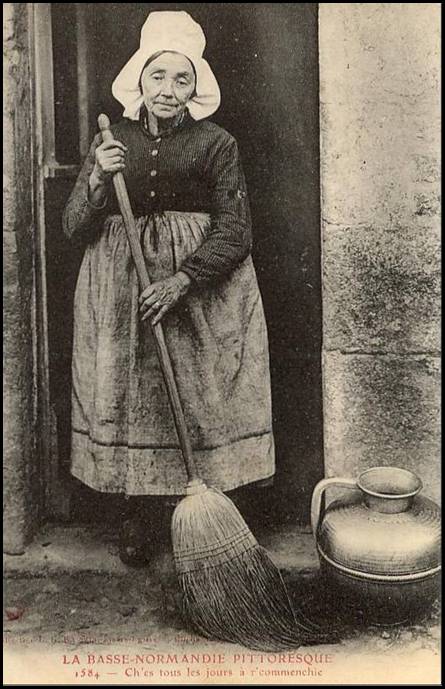 | ||||
|
| ||||
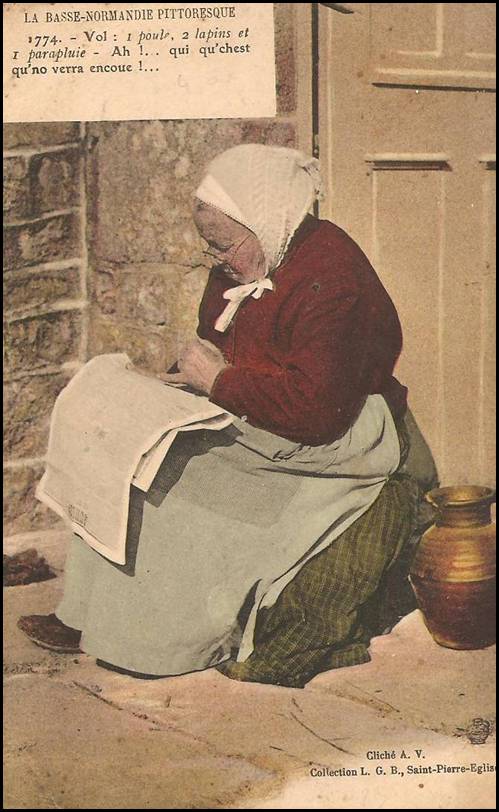 | ||||
|
| ||||
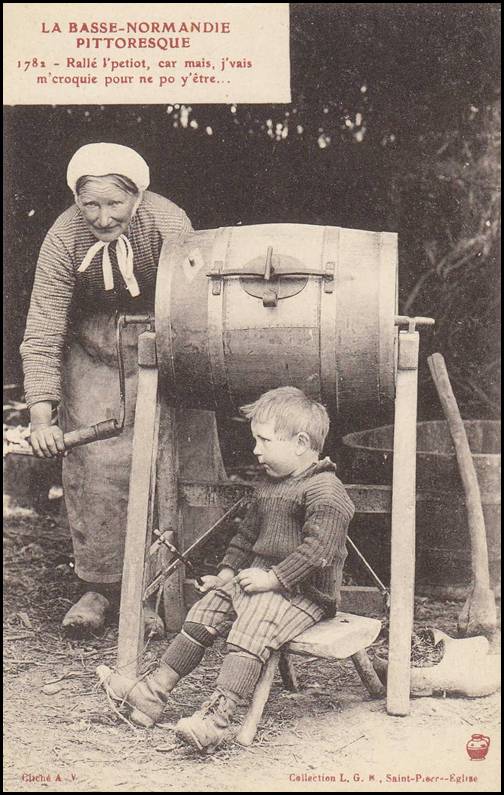 | ||||
|
| ||||
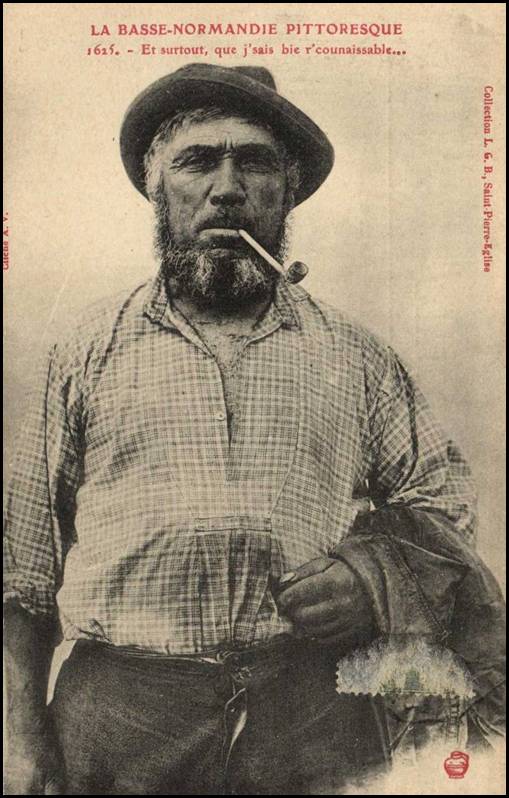 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
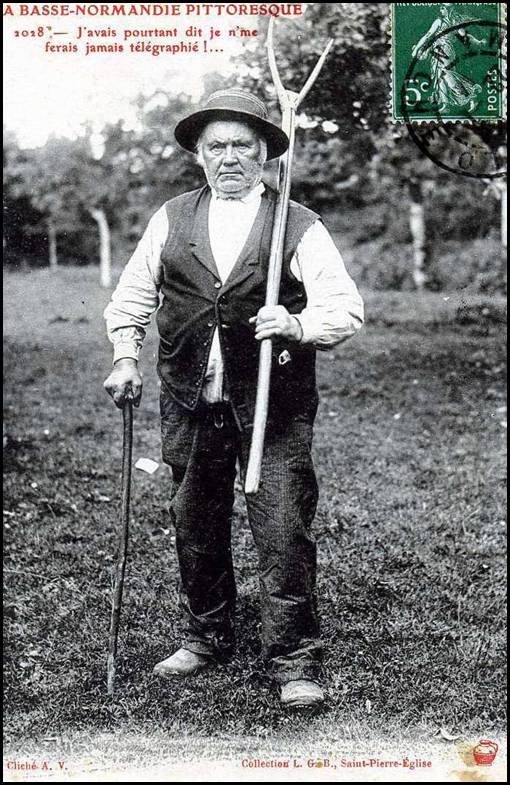 | ||||
|
| ||||
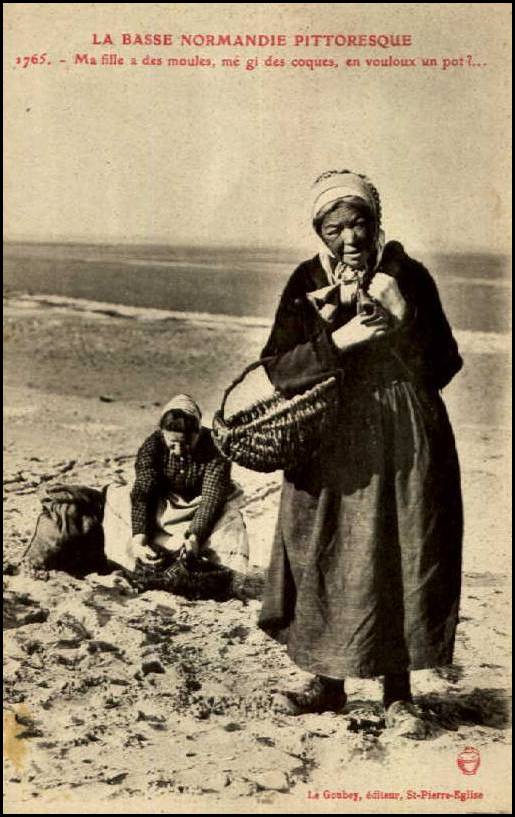 | ||||
|
| ||||
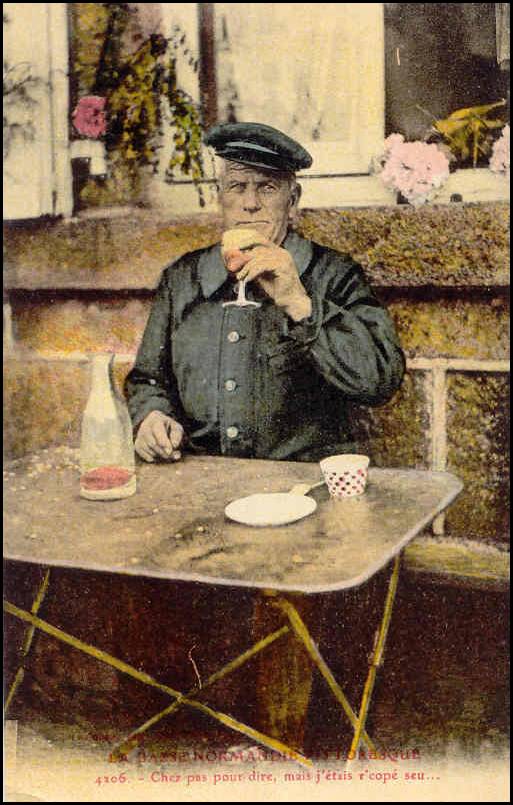 | ||||
|
| ||||
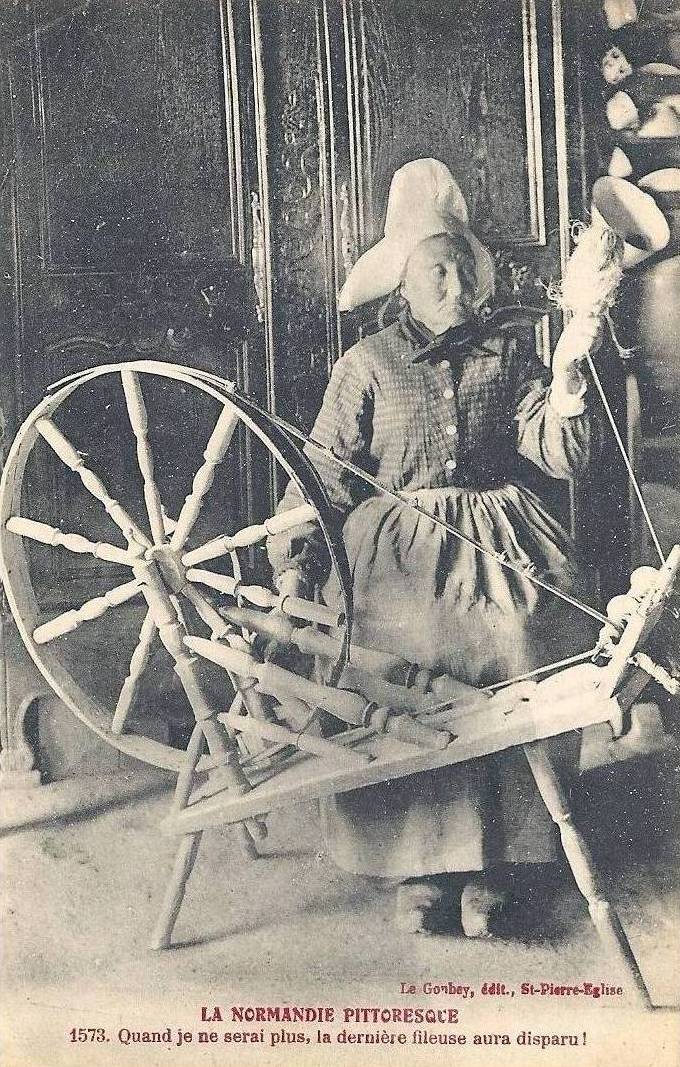 | ||||
|
|
|
| ||
|
| 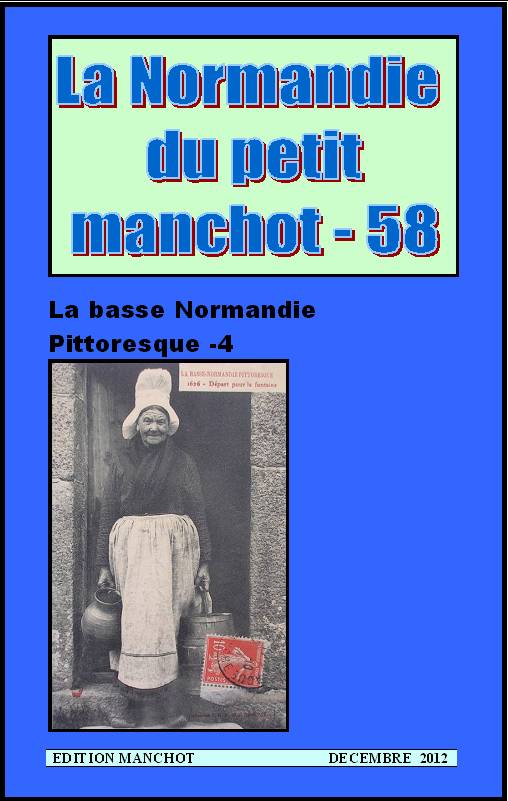 | |
|
| ||
|
| 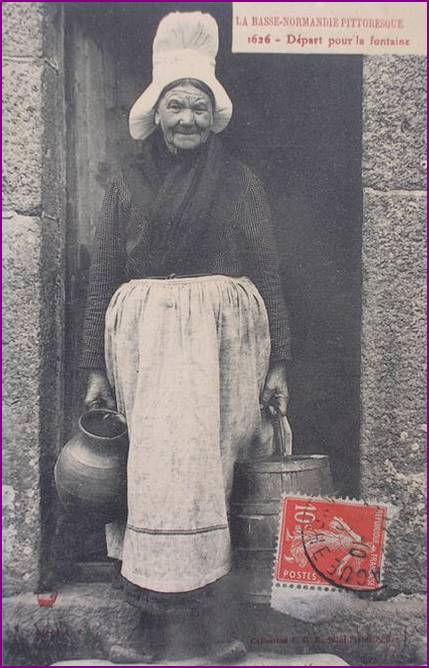 | |
|
| ||
|
| 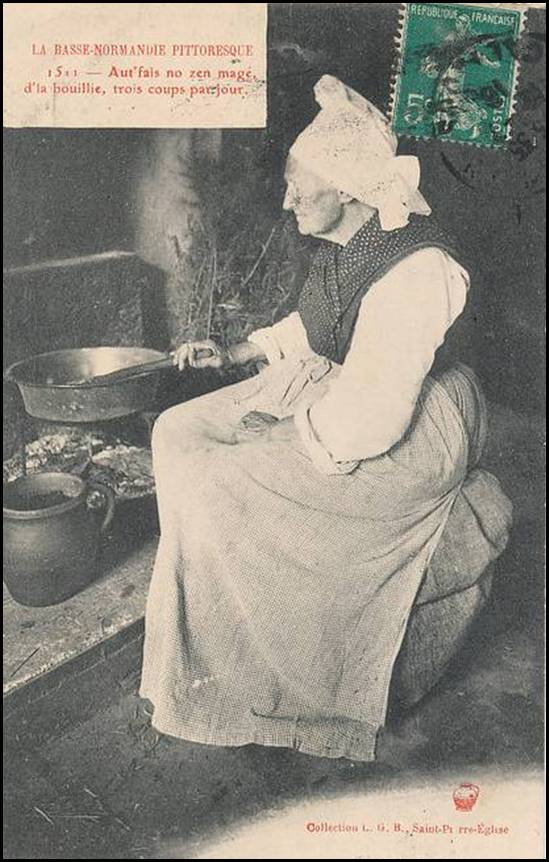 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 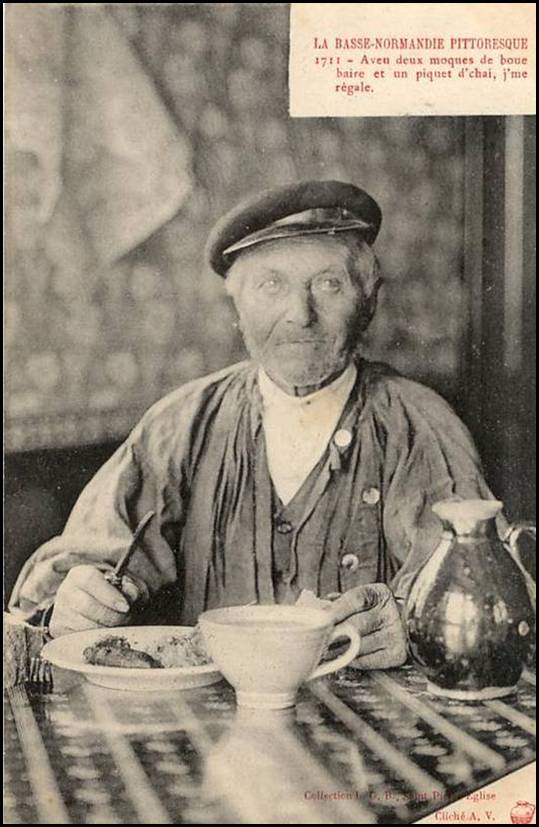 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 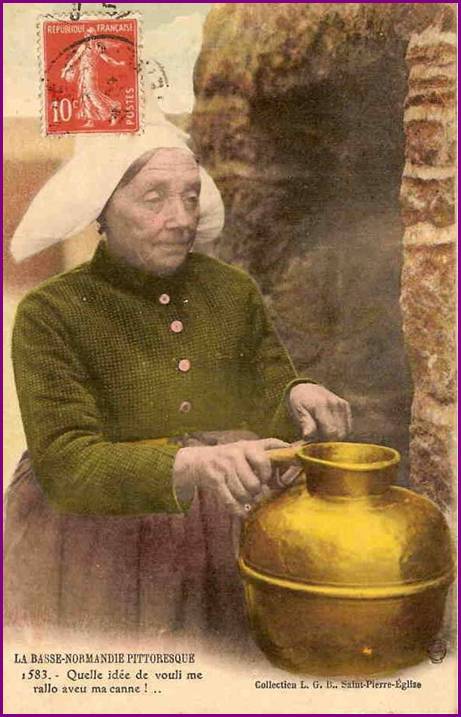 | |
|
| ||
|
| 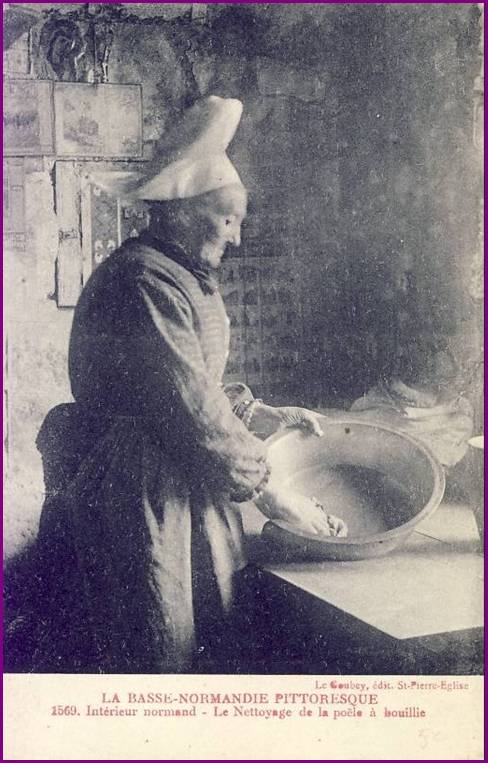 | |
|
| ||
|
| 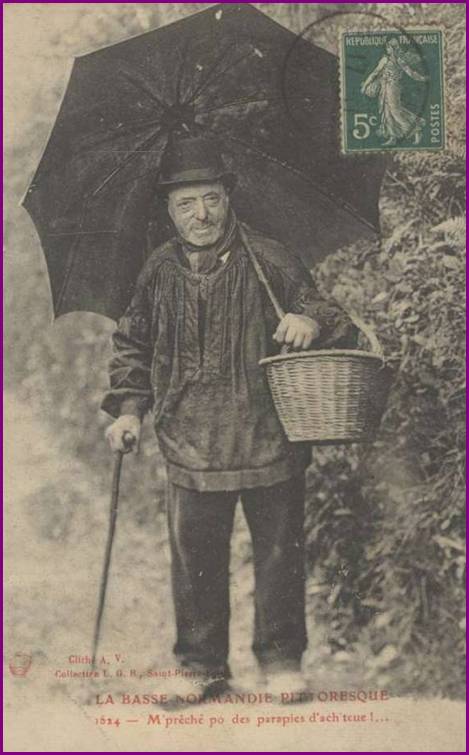 | |
|
| ||
|
| 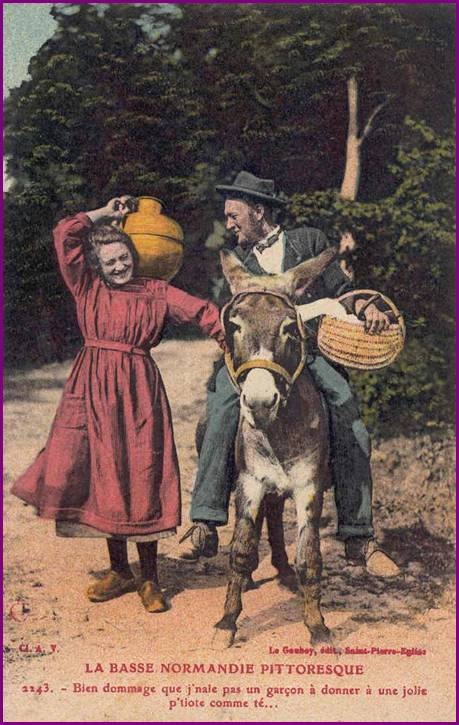 | |
|
| ||
|
| 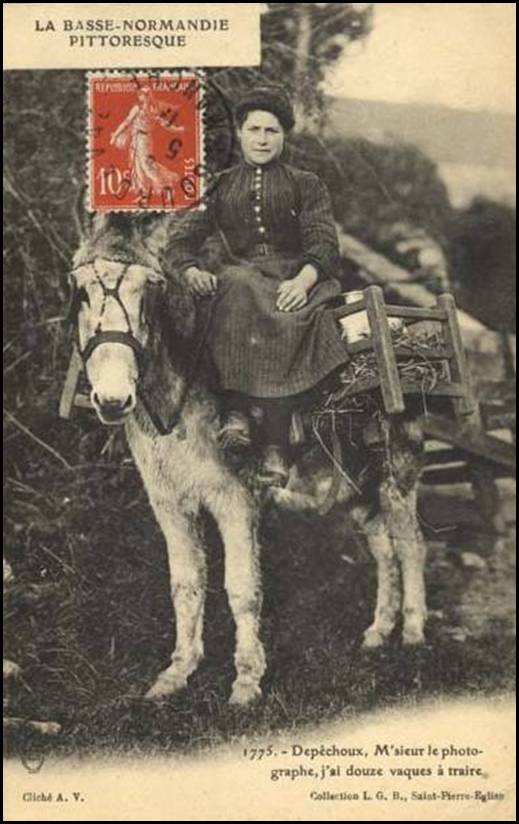 | |
|
|
|
| ||
|
| 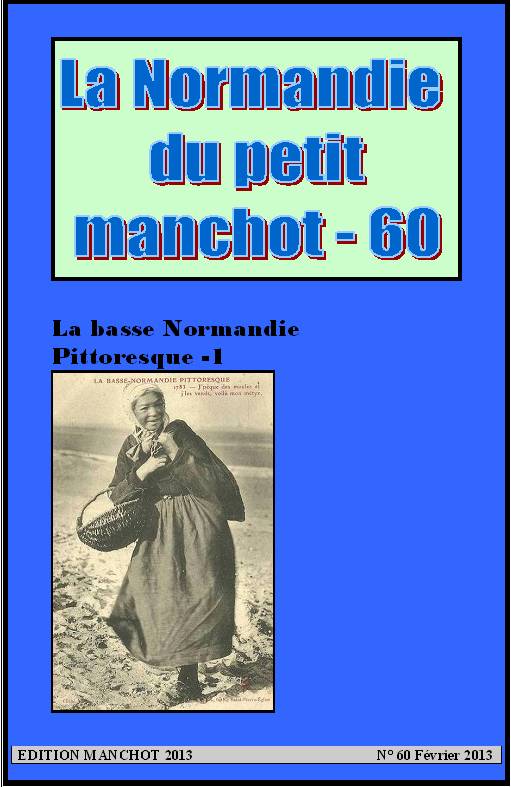 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 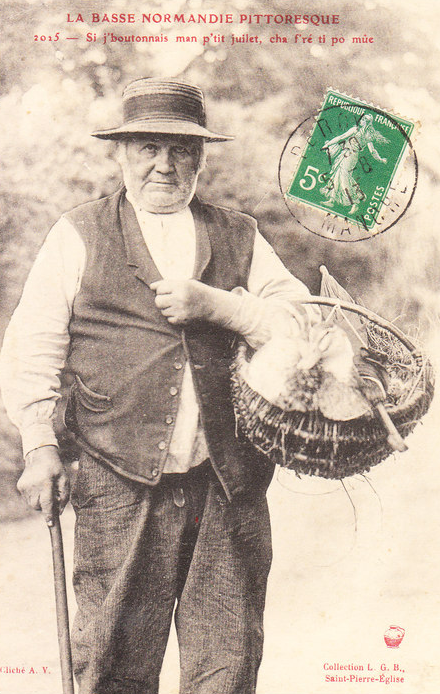 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 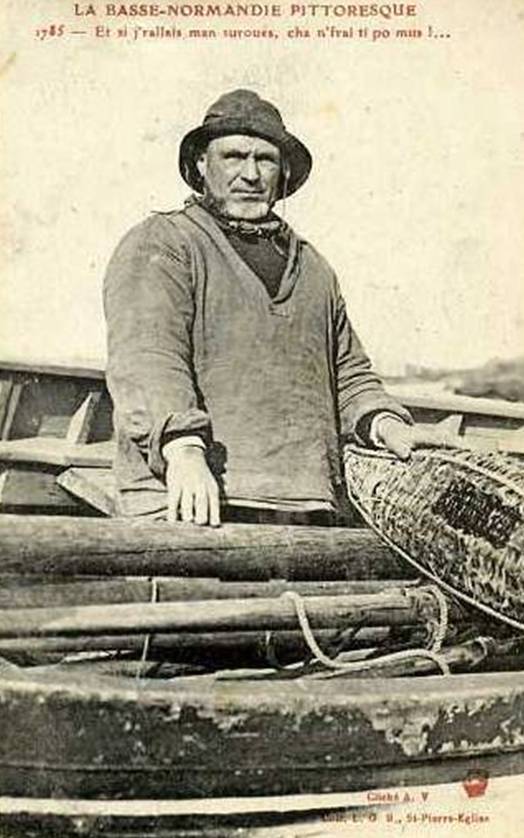 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 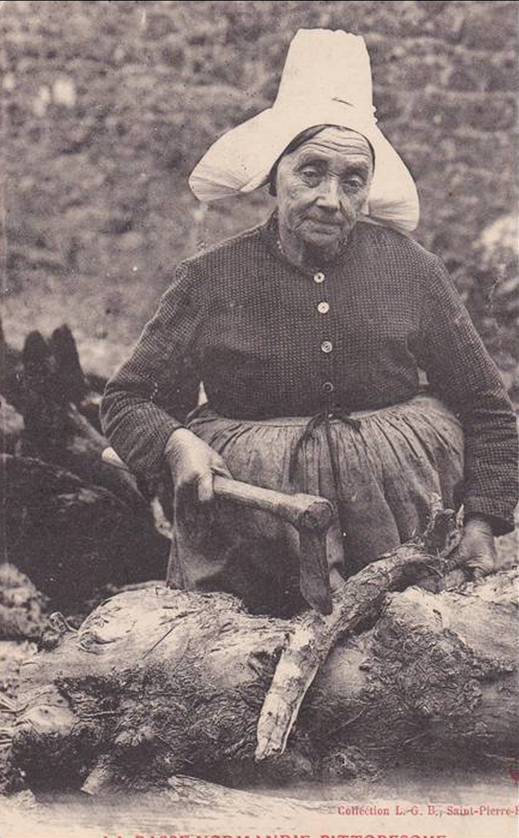 | |
|
| ||
|
| 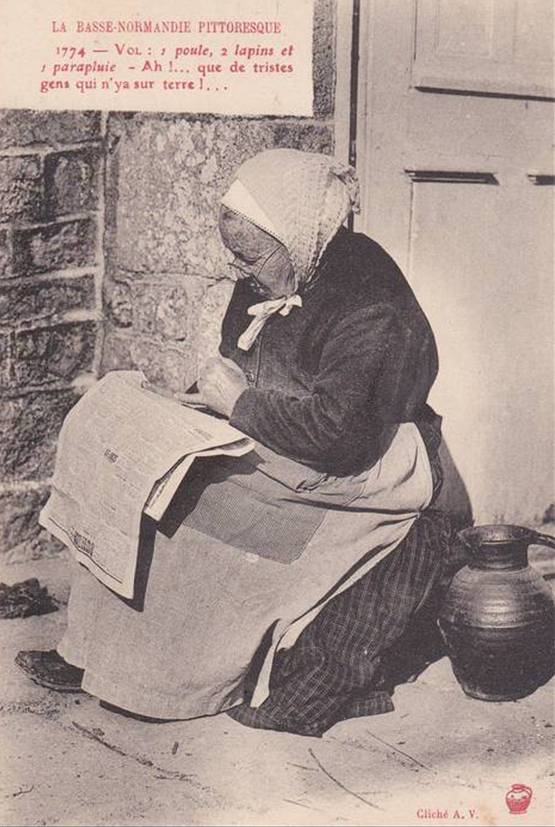 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 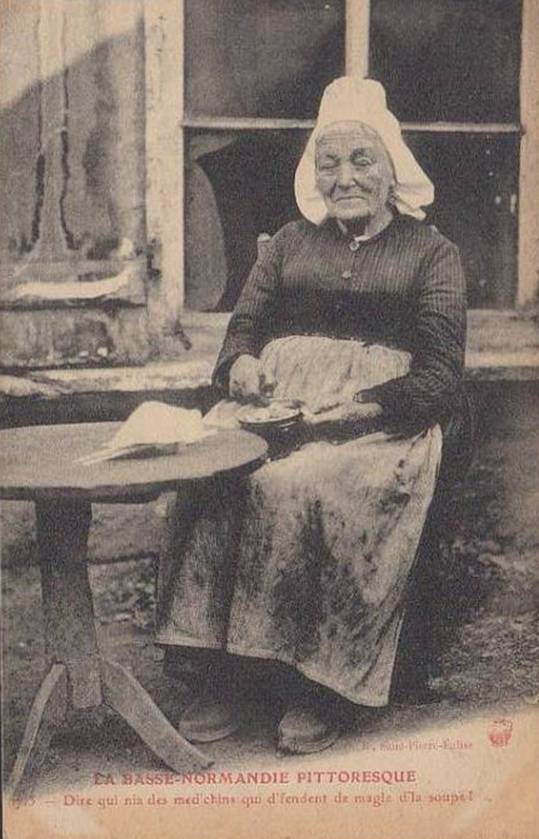 | |
|
| ||
|
| 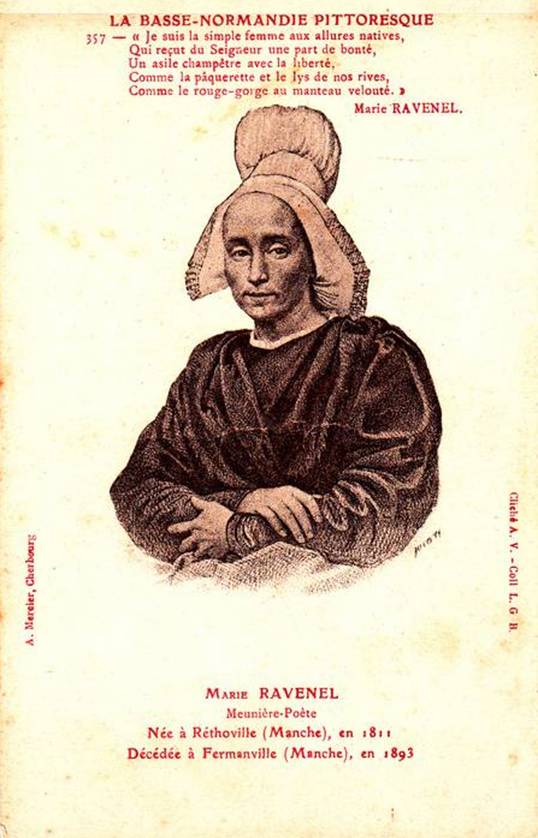 | |
|
|
|
| ||
|
| 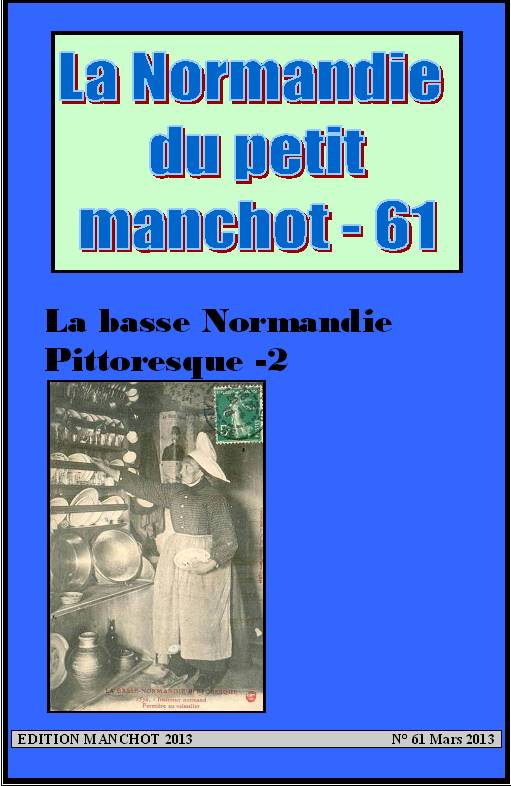 | |
|
| ||
|
| 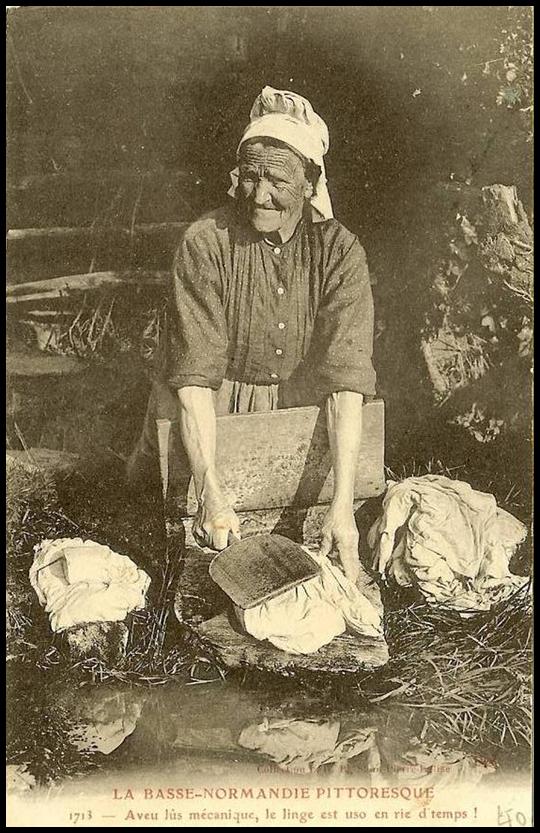 | |
|
| ||
|
| 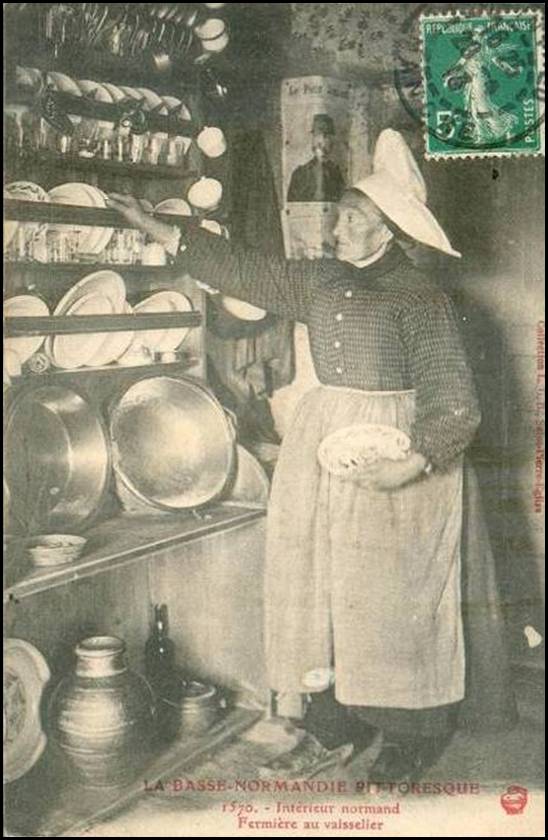 | |
|
| ||
|
| 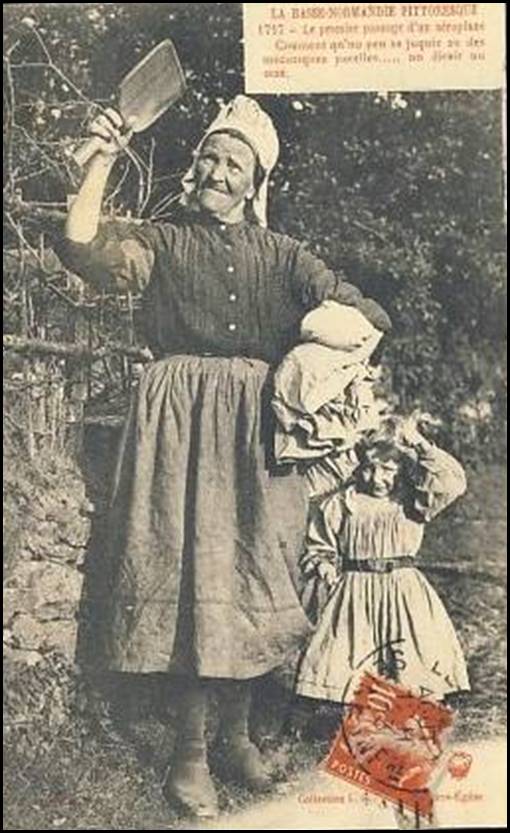 | |
|
| ||
|
| 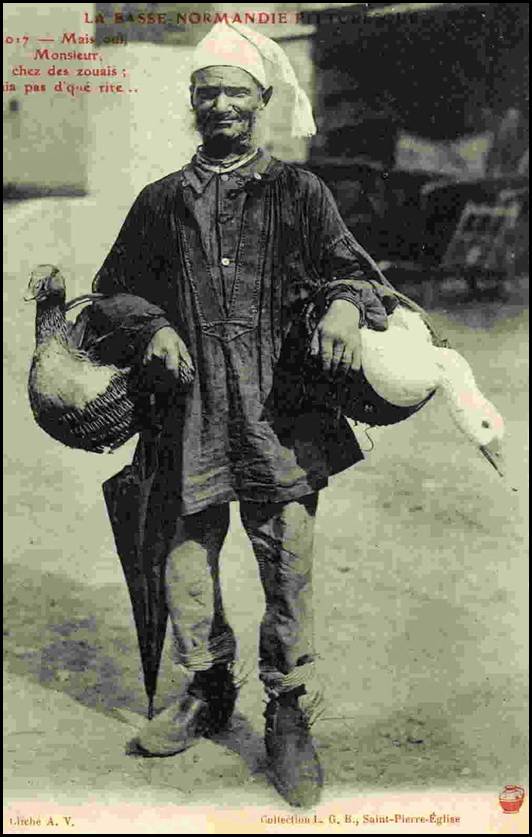 | |
|
| ||
|
| 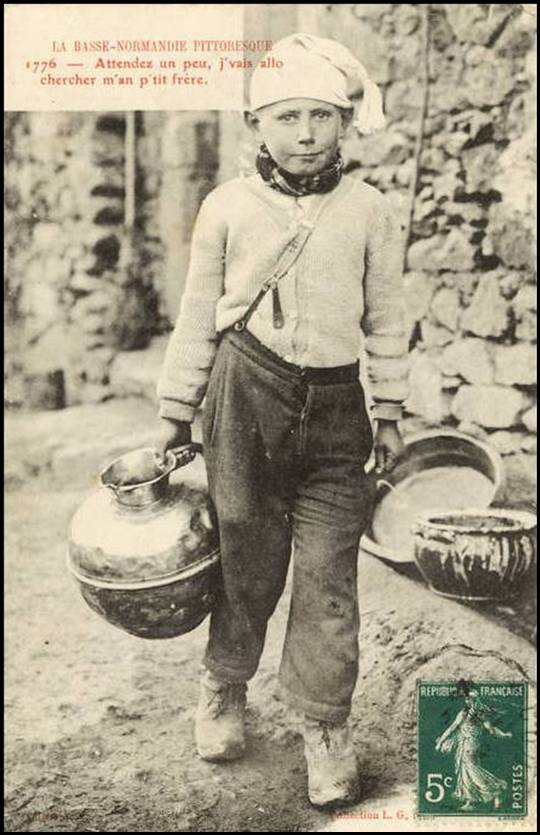 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 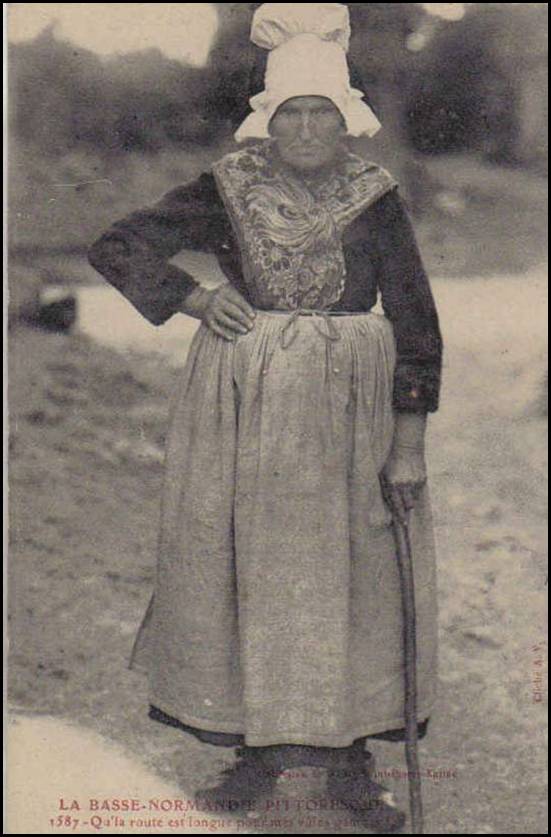 | |
|
| ||
|
| 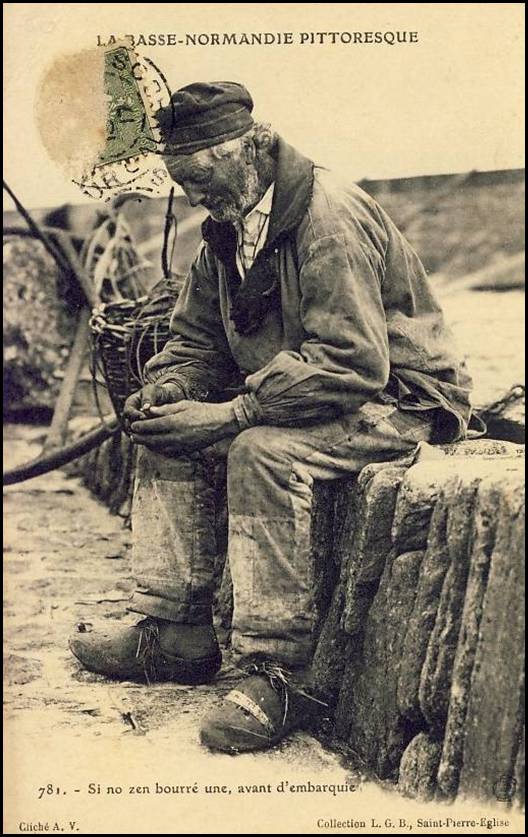 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 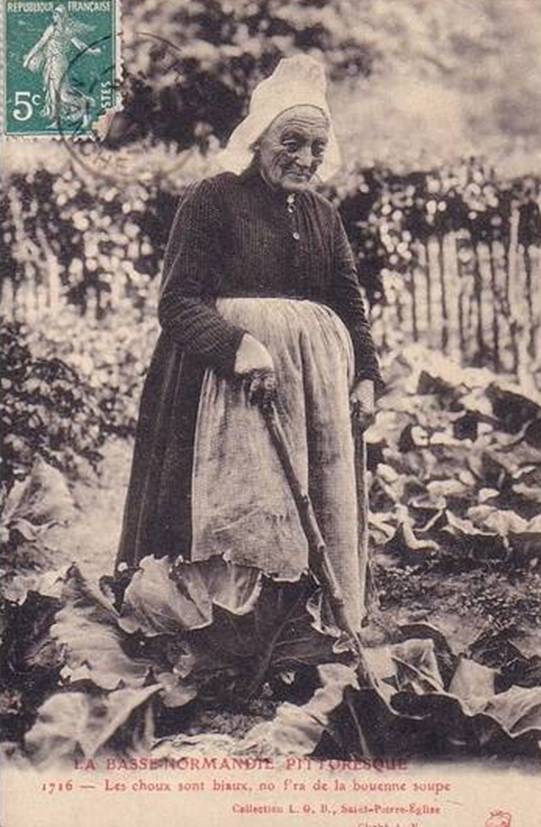 | |
|
|
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°71 Mars 2014 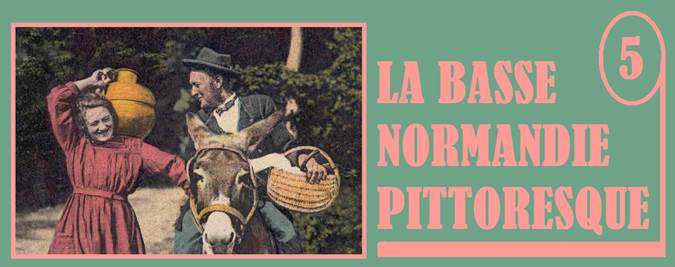
| ||||||||
| ||||||||
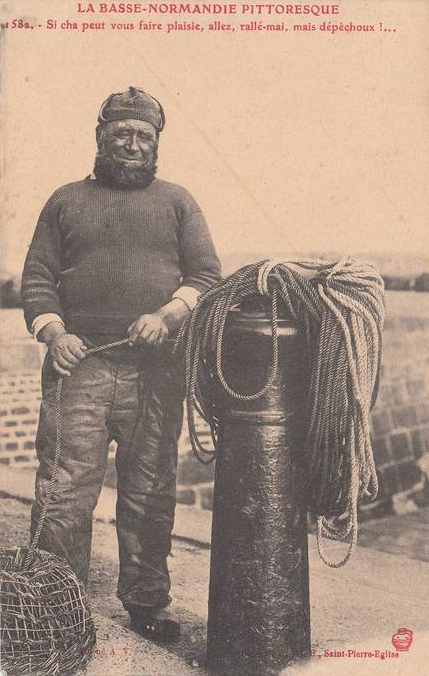 | ||||||||
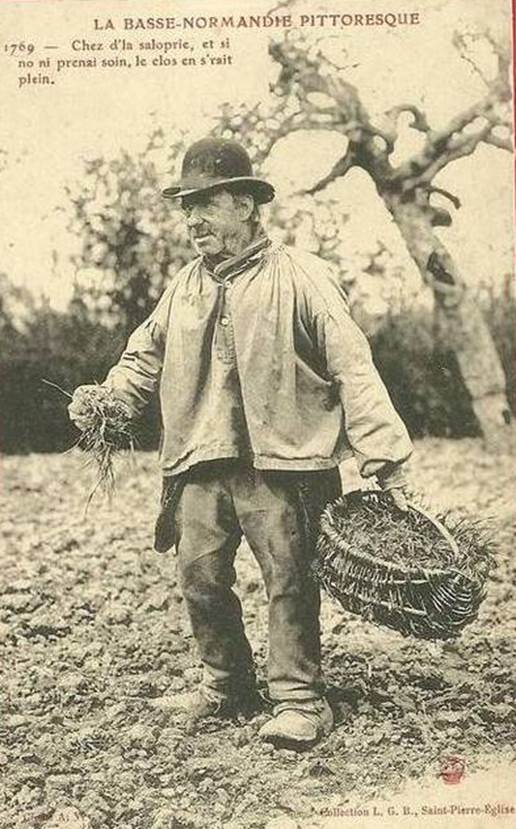 | ||||||||
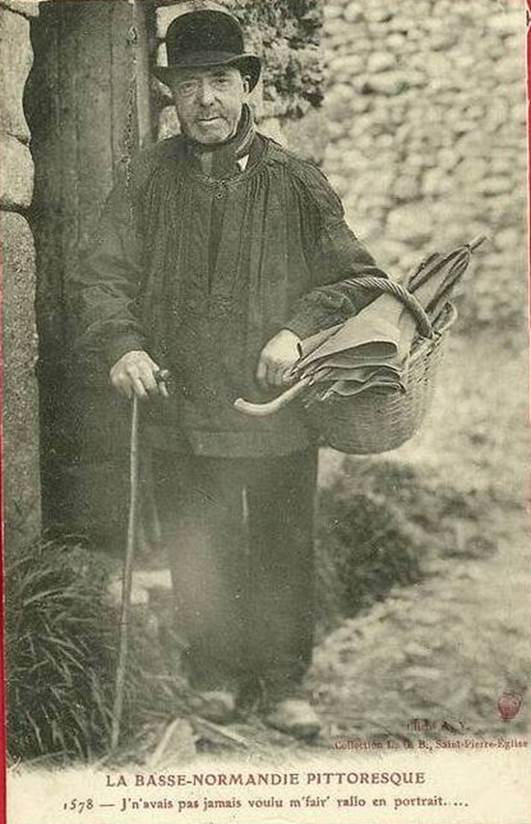 | ||||||||
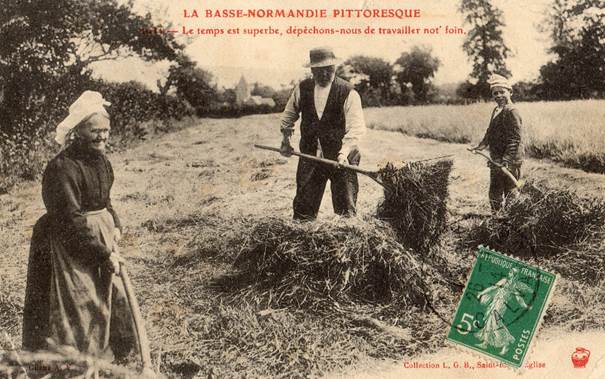 | ||||||||
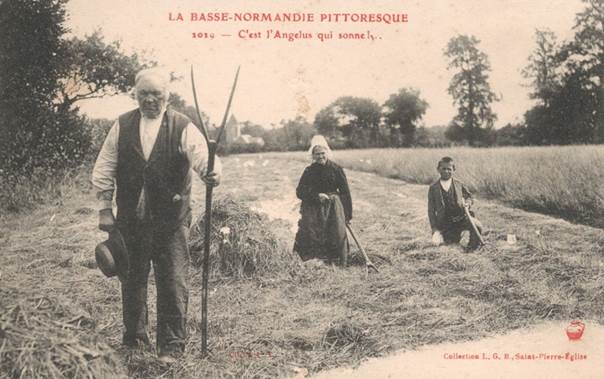 | ||||||||
 | ||||||||
 | ||||||||
 | ||||||||
 | ||||||||
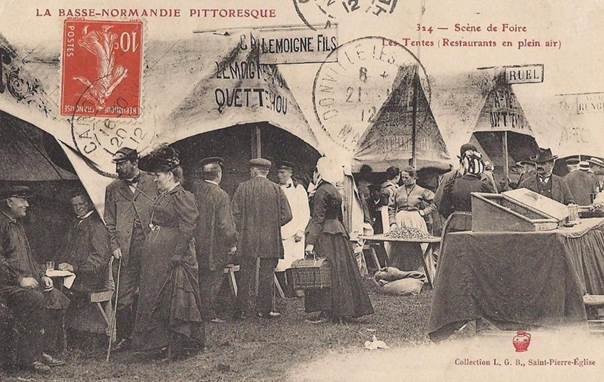 | ||||||||
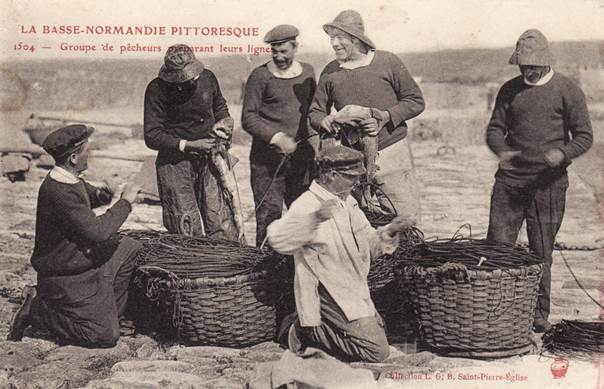 | ||||||||
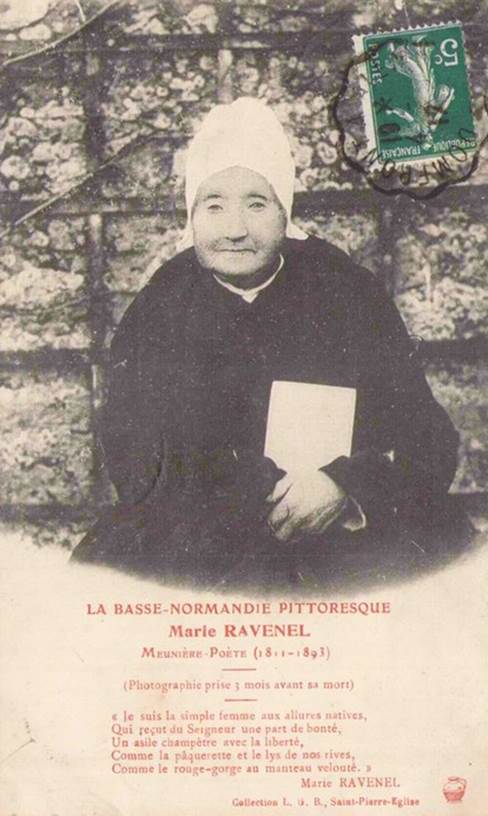 | ||||||||
 | ||||||||
 | ||||||||
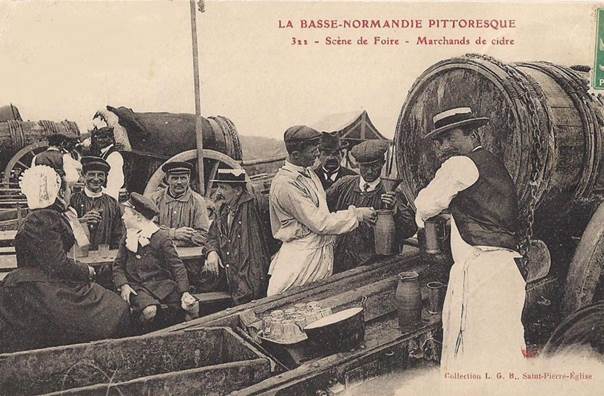 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||
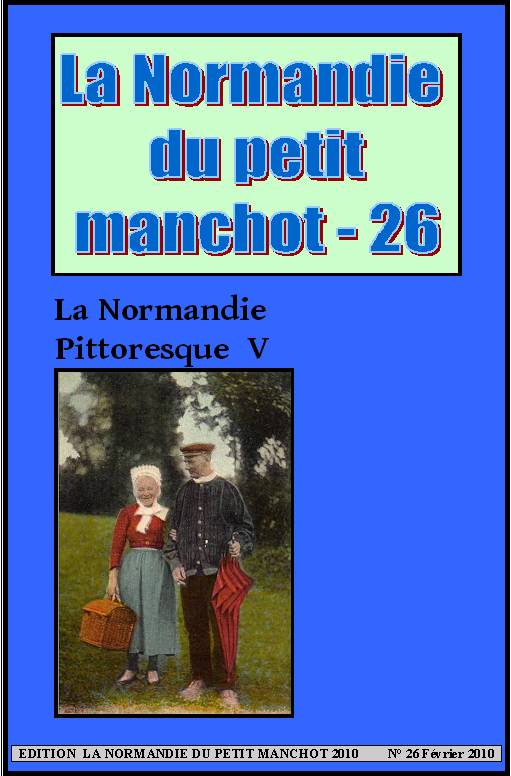 | ||
|
| ||
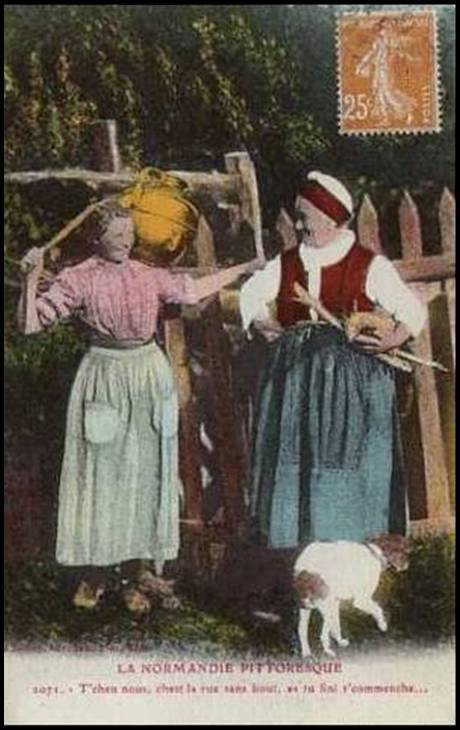 | ||
|
| ||
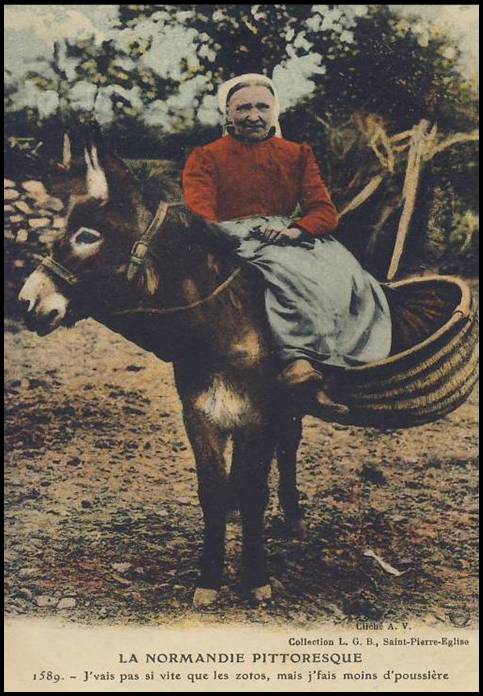 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
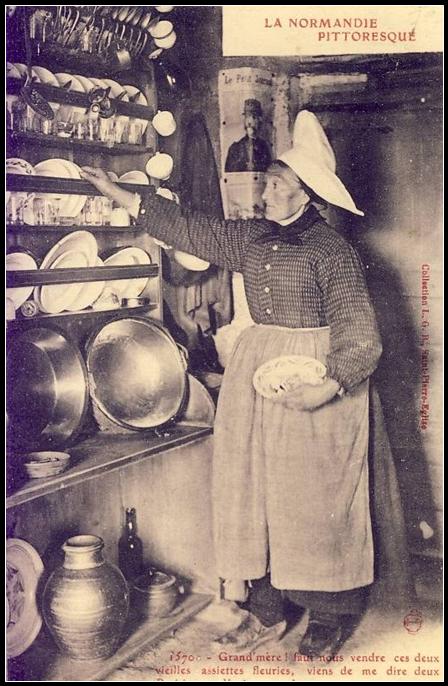 | ||
|
| ||
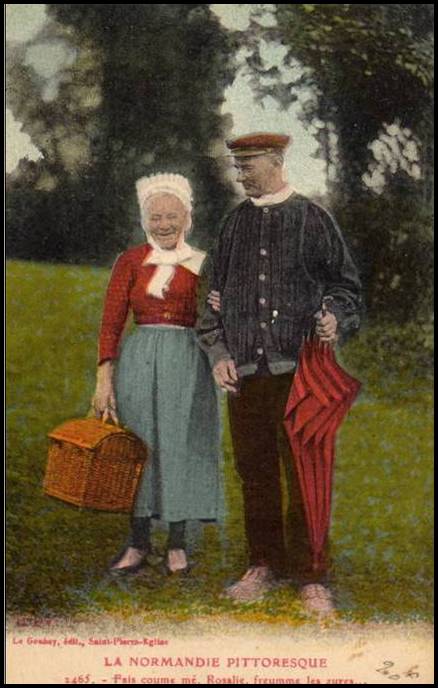 | ||
|
| ||
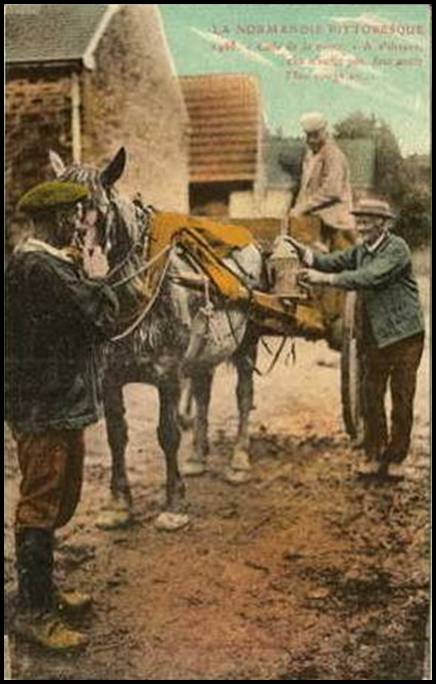 | ||
|
| ||
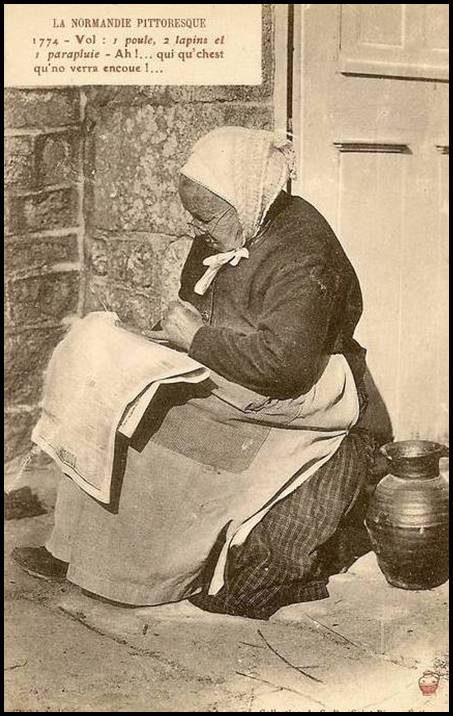 | ||
|
| ||
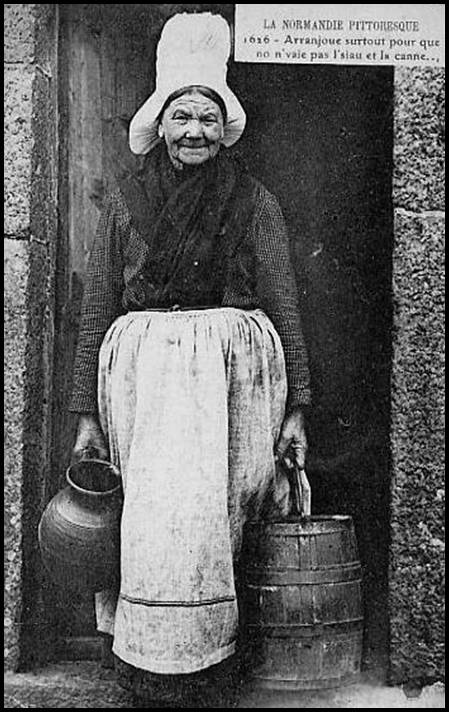 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
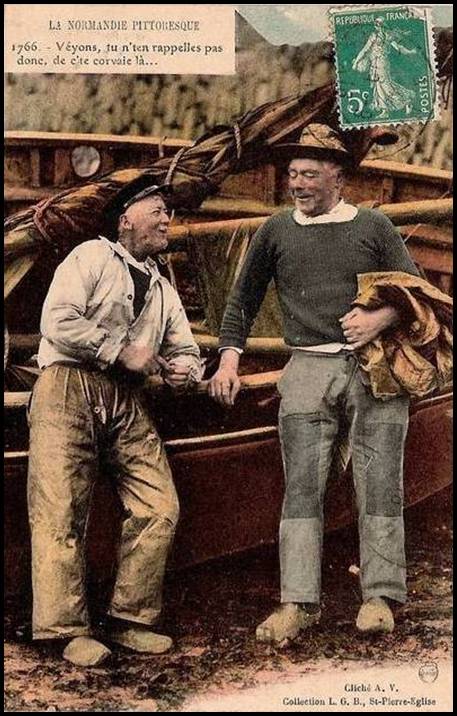 | ||
|
|
|
| ||
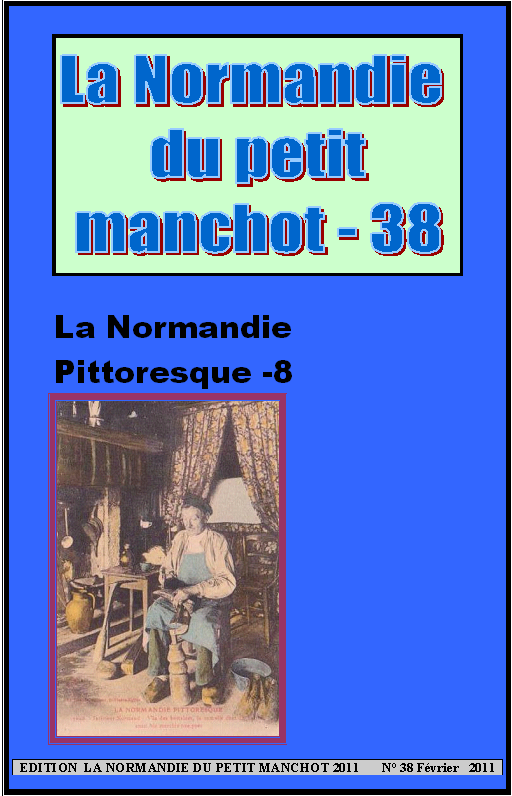 | ||
|
| ||
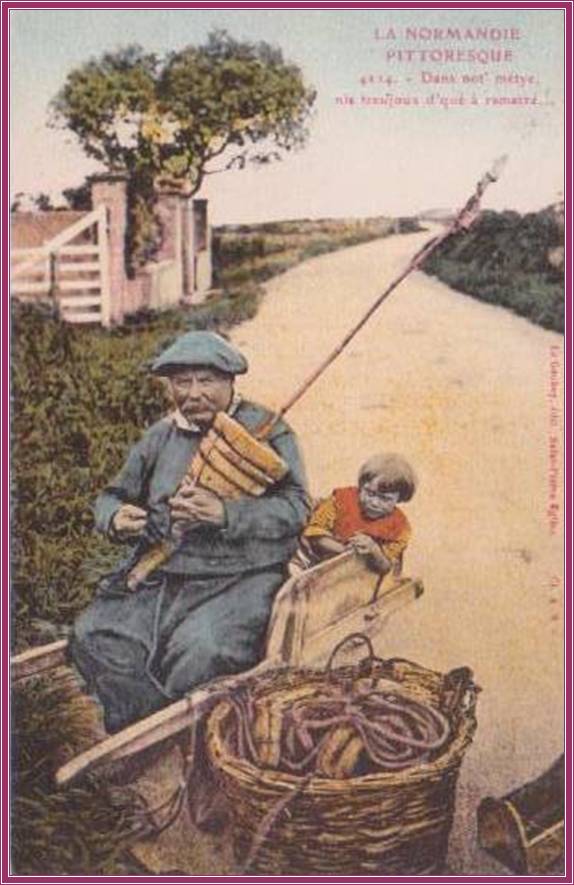 | ||
|
| ||
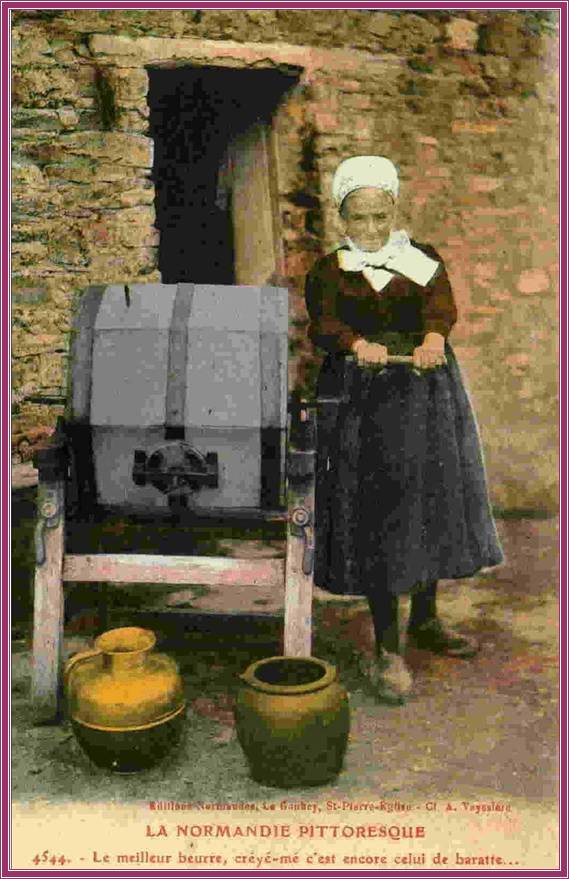 | ||
|
| ||
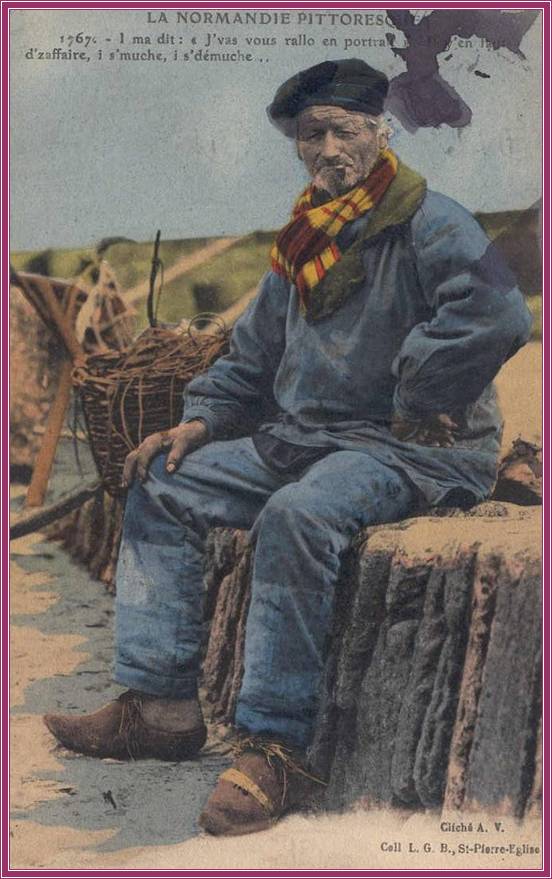 | ||
|
| ||
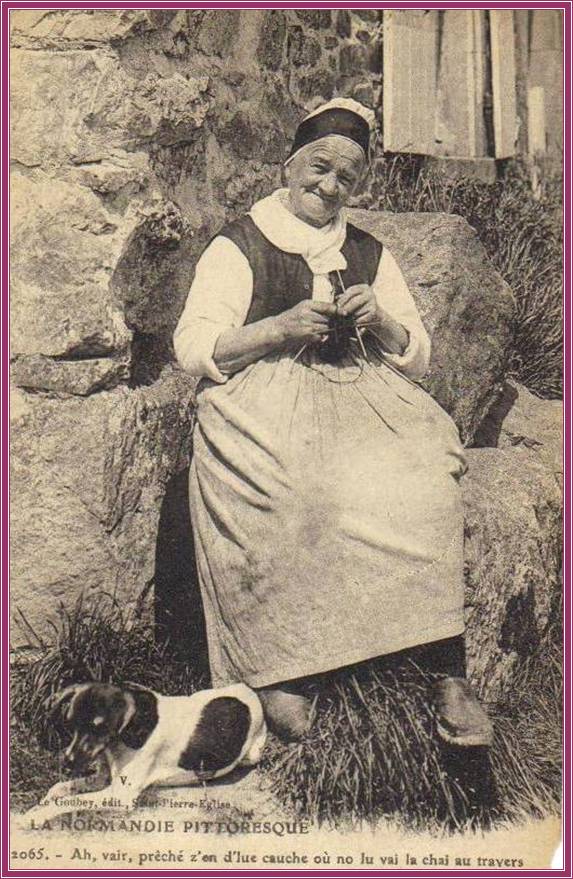 | ||
|
| ||
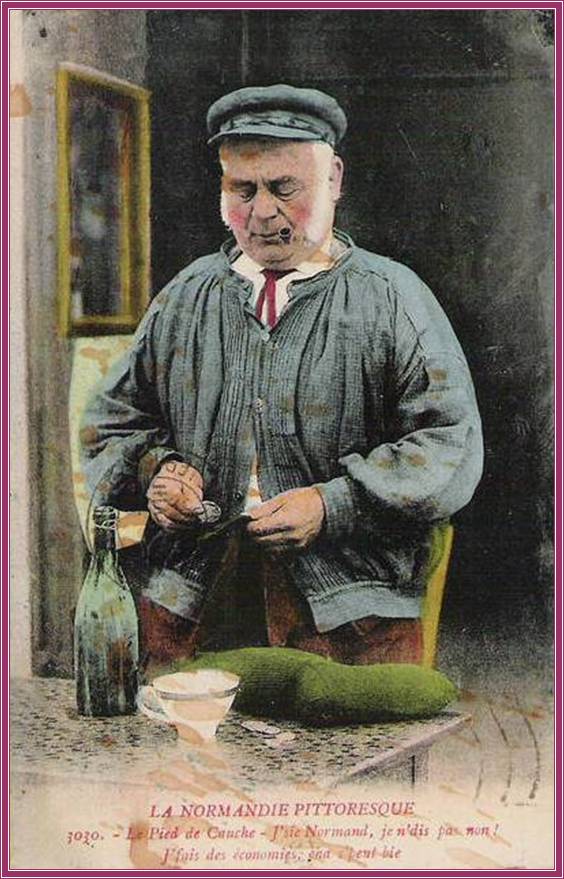 | ||
|
| ||
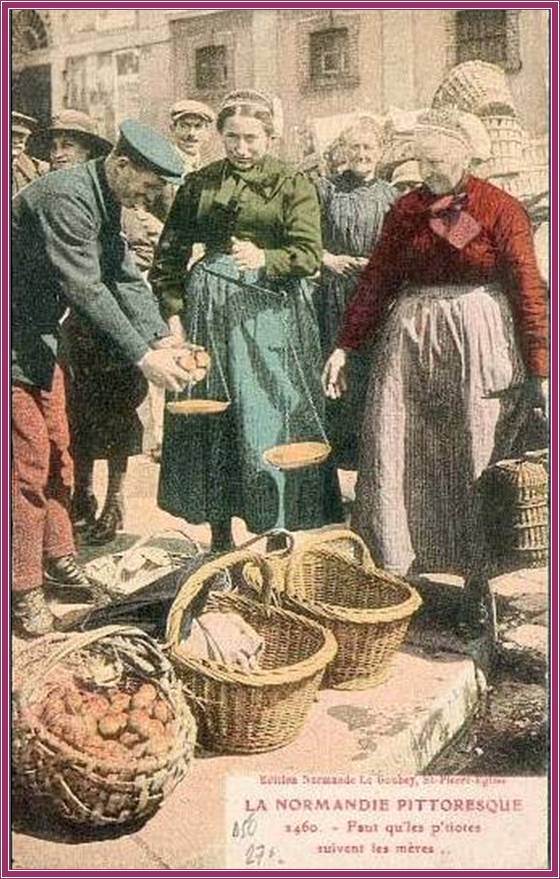 | ||
|
| ||
|
| 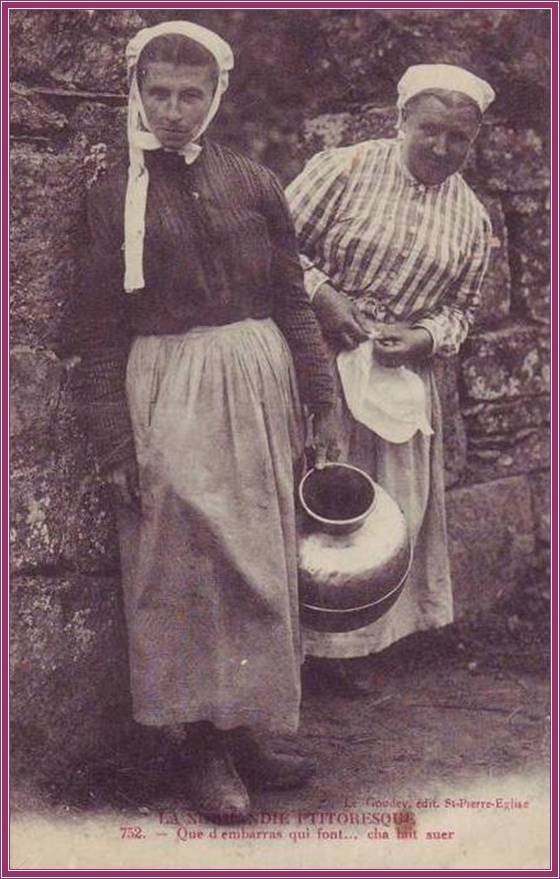 | |
|
| ||
|
| 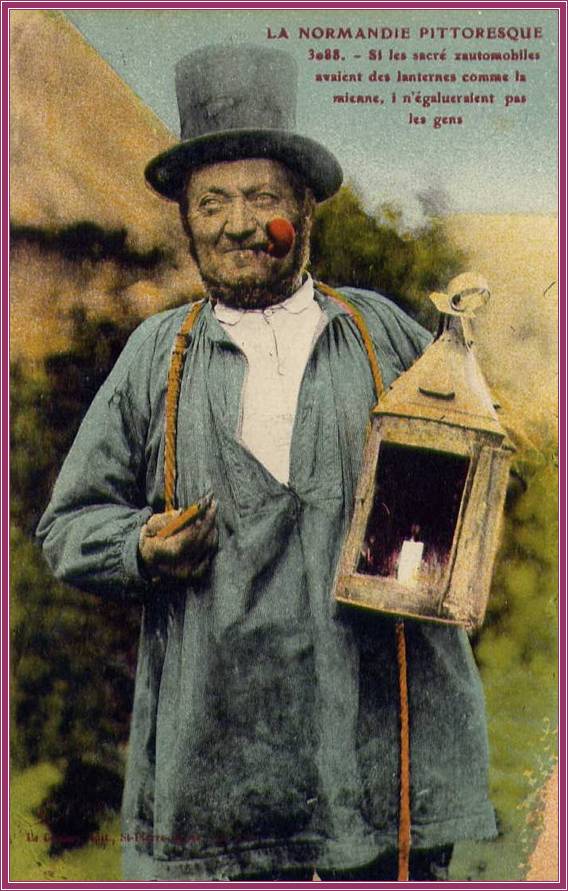 | |
|
| ||
|
| 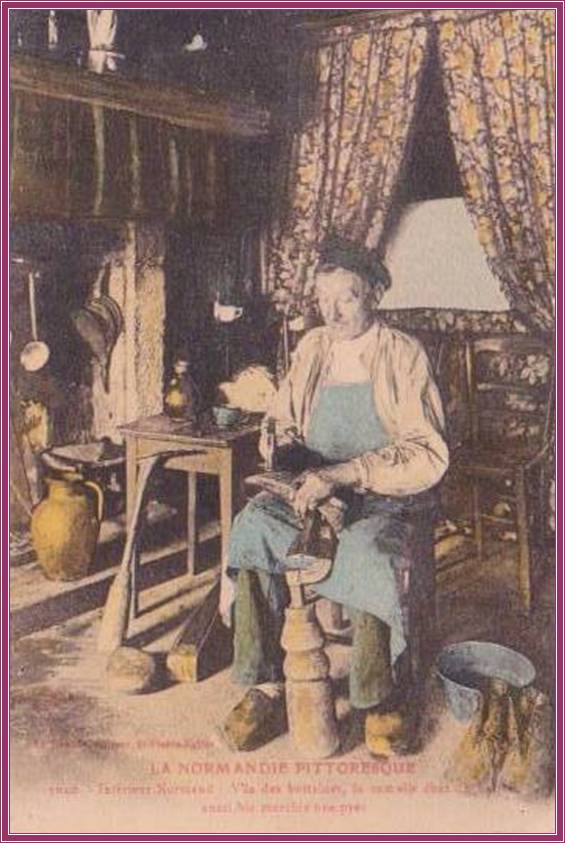 | |
|
| ||
|
| 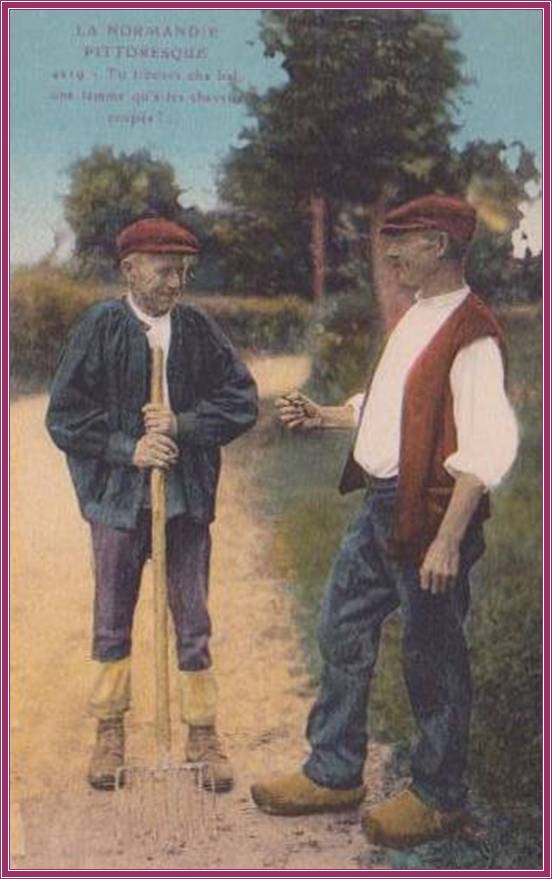 | |
|
| ||
|
| 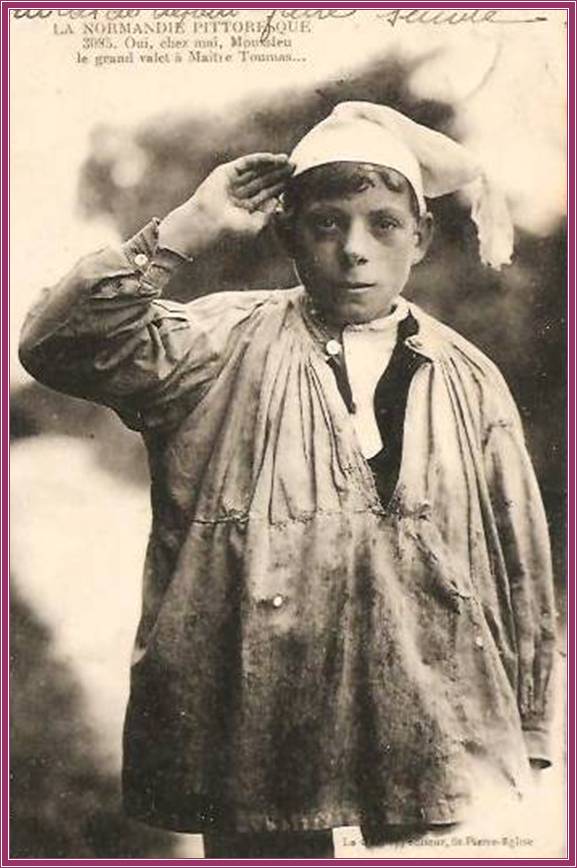 | |
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 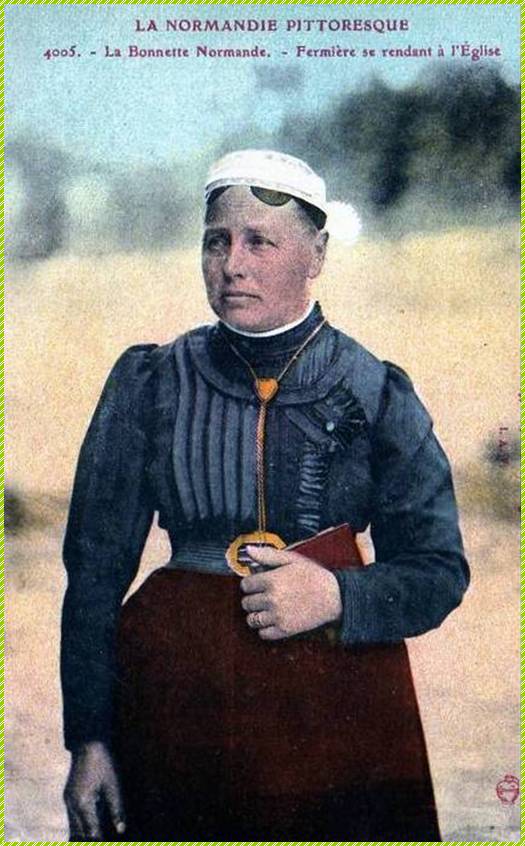 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 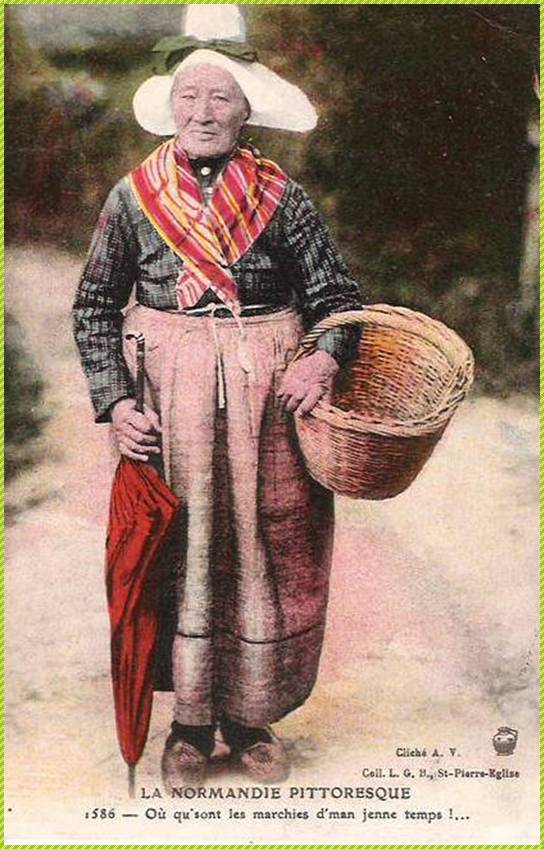 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 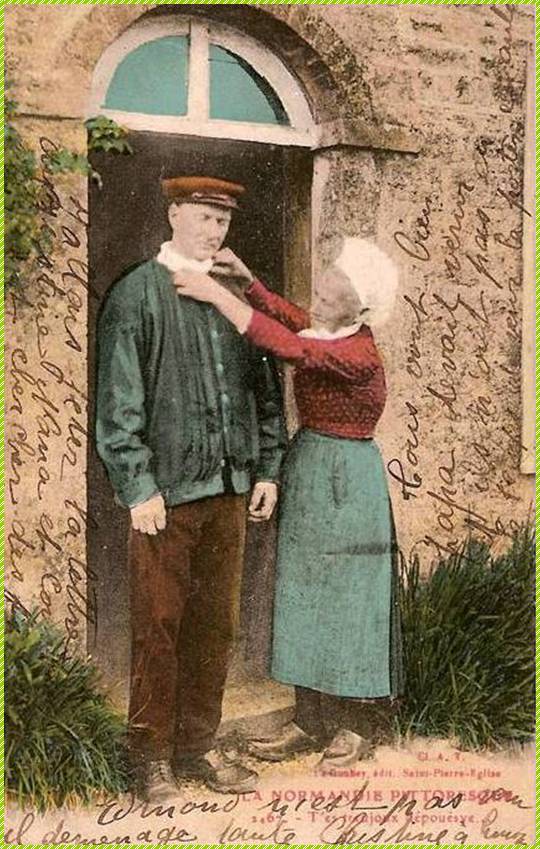 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 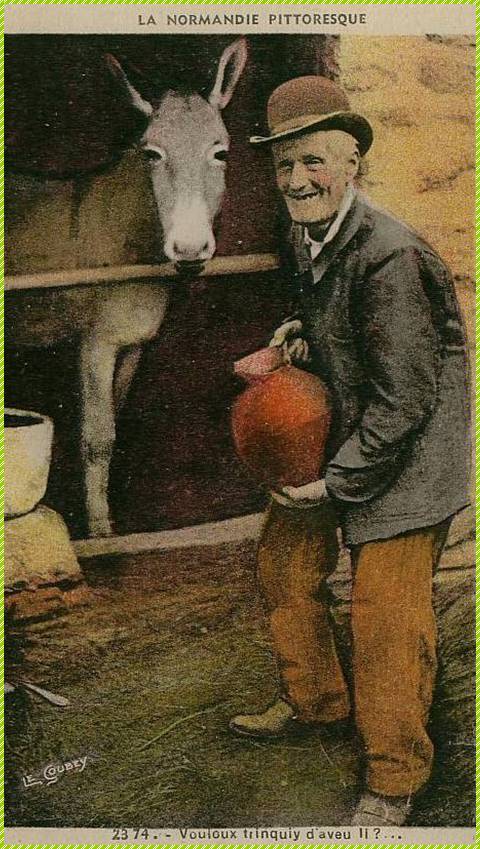 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 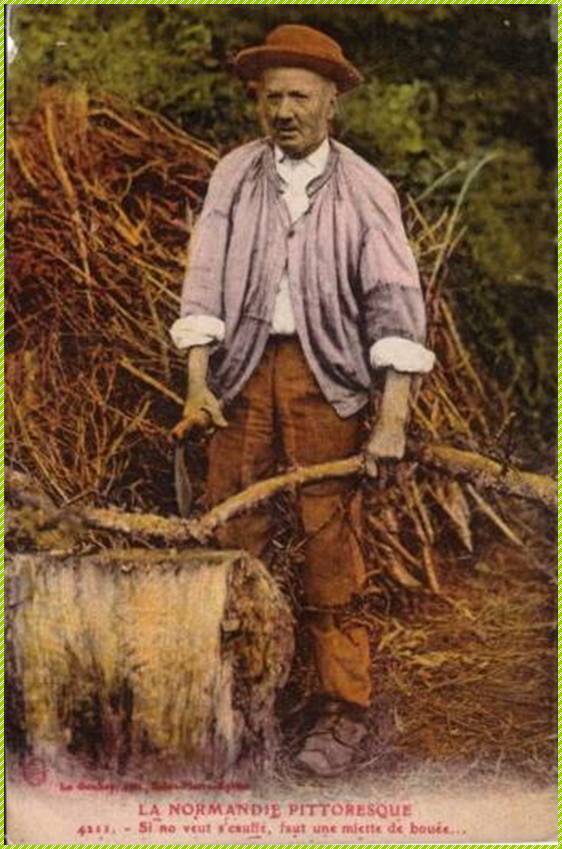 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 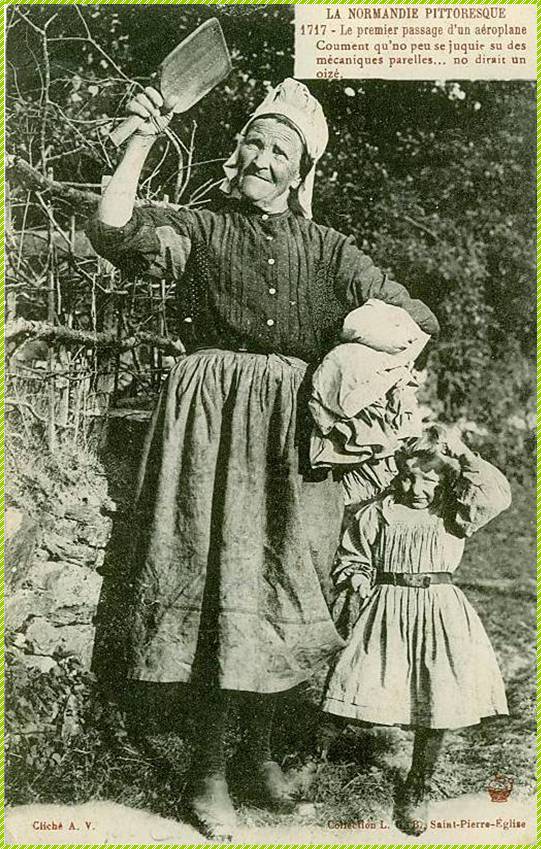 | |||||||||||||
|
|
|
| ||
|
| 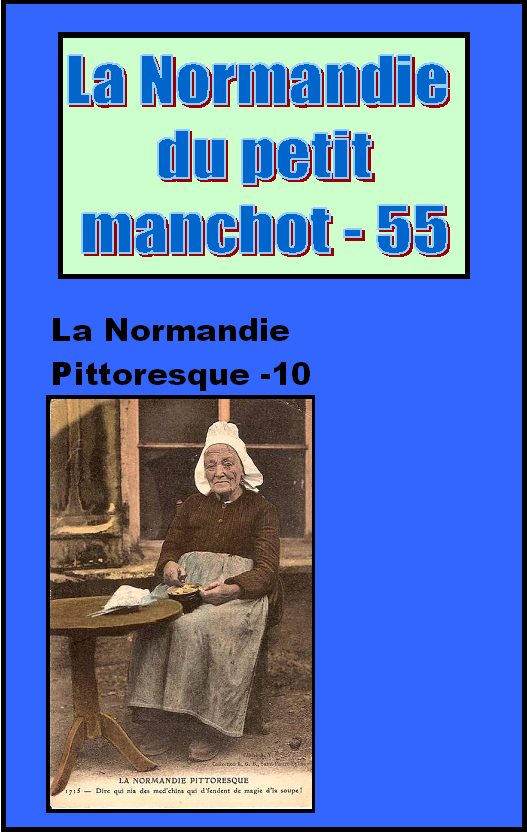 | |
|
| ||
|
| 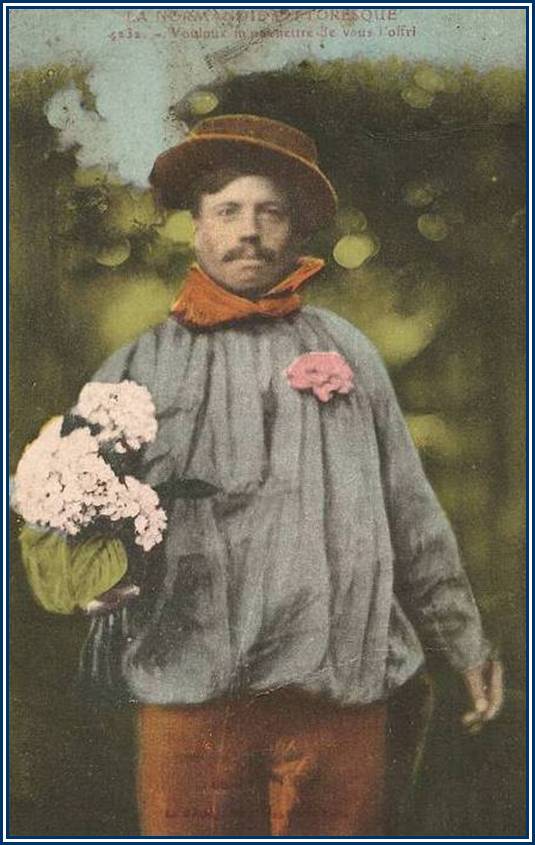 | |
|
| ||
|
| 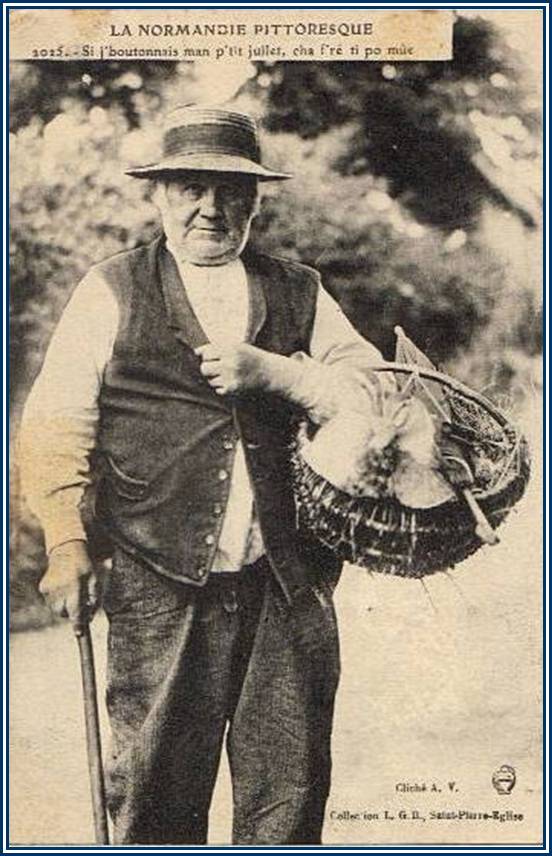 | |
|
| ||
|
| 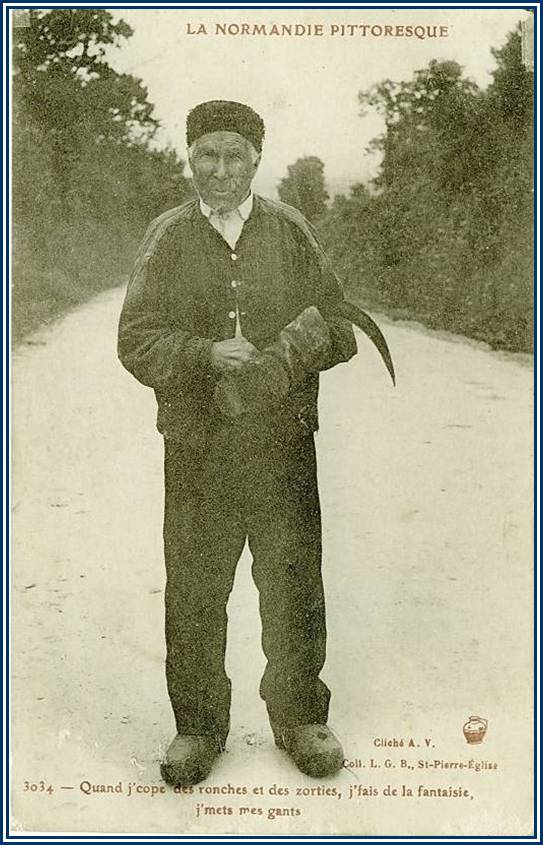 | |
|
| ||
|
| 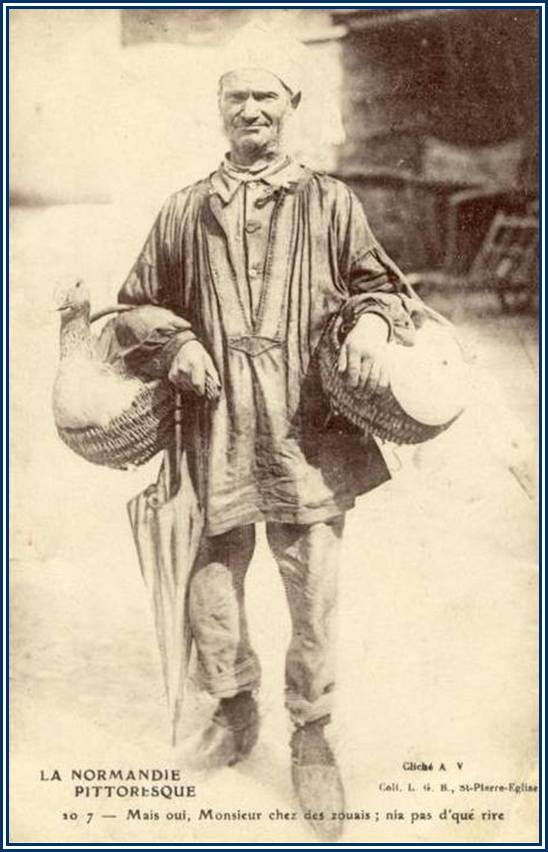 | |
|
| ||
|
| 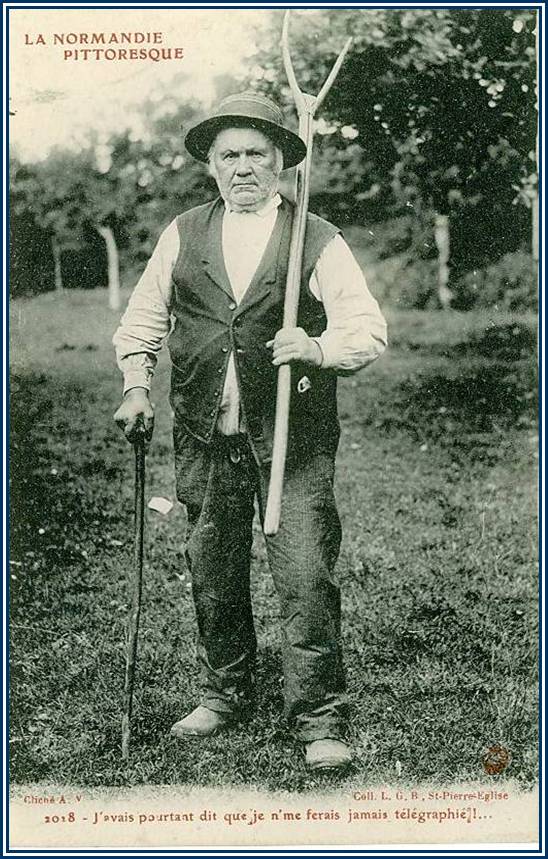 | |
|
| ||
|
| 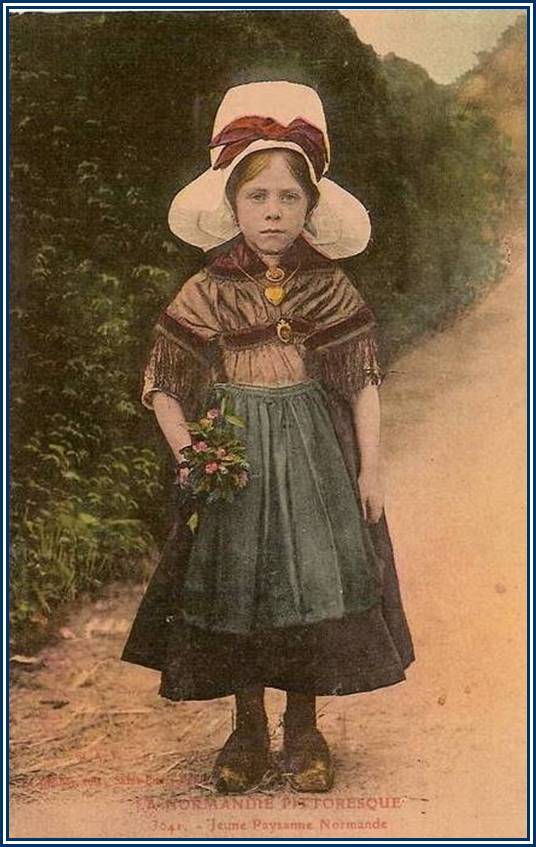 | |
|
| ||
|
| 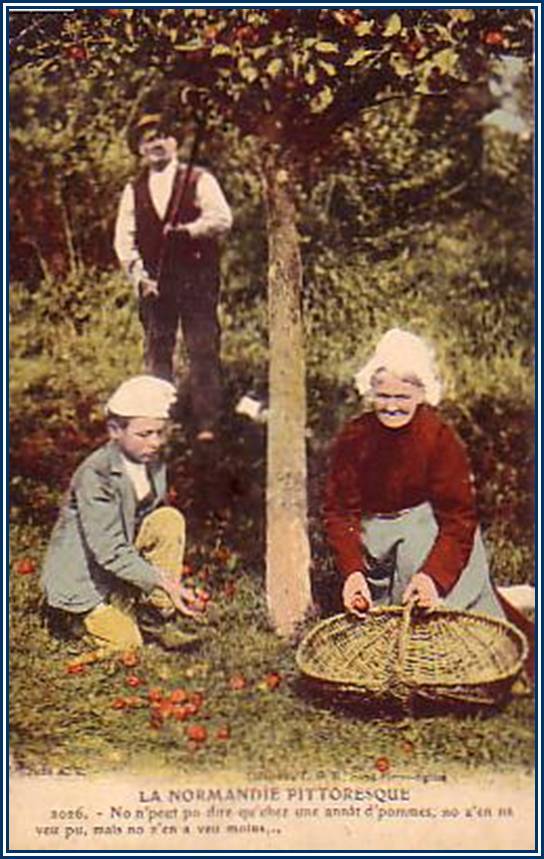 | |
|
| ||
|
| 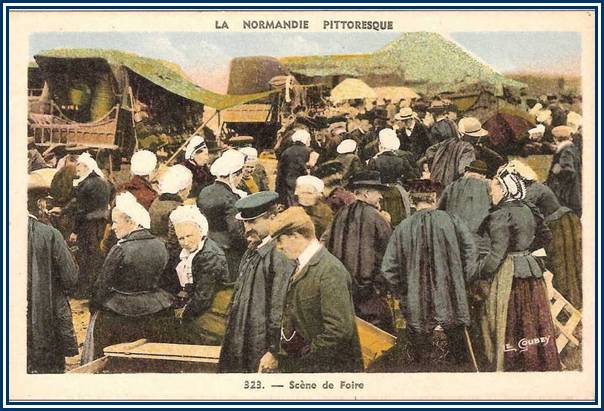 | |
|
| ||
|
| 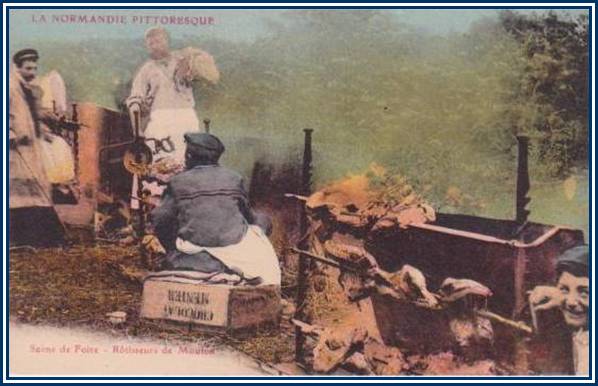 | |
|
| ||
|
| 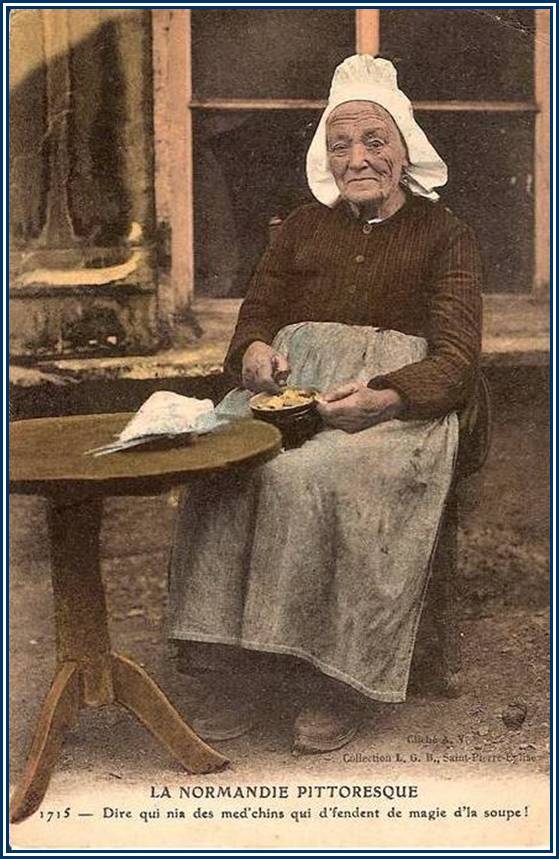 | |
|
| ||
|
| 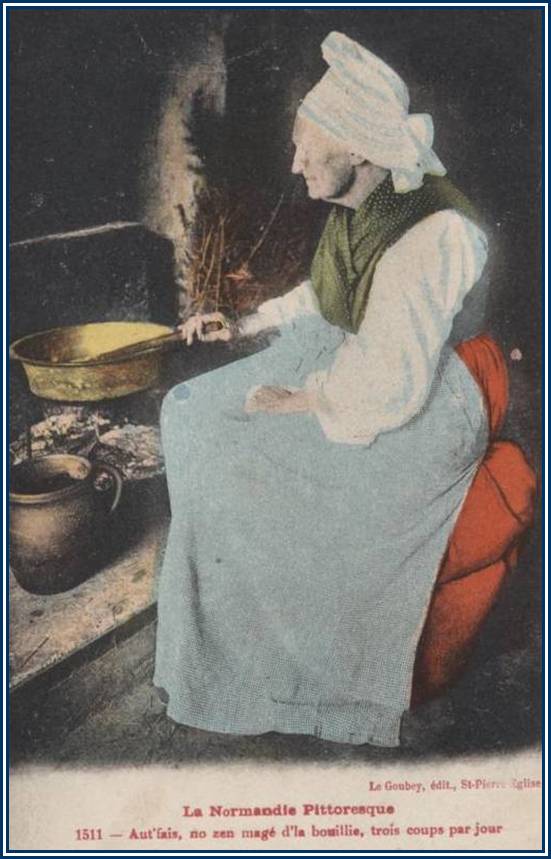 | |
|
| ||
|
| 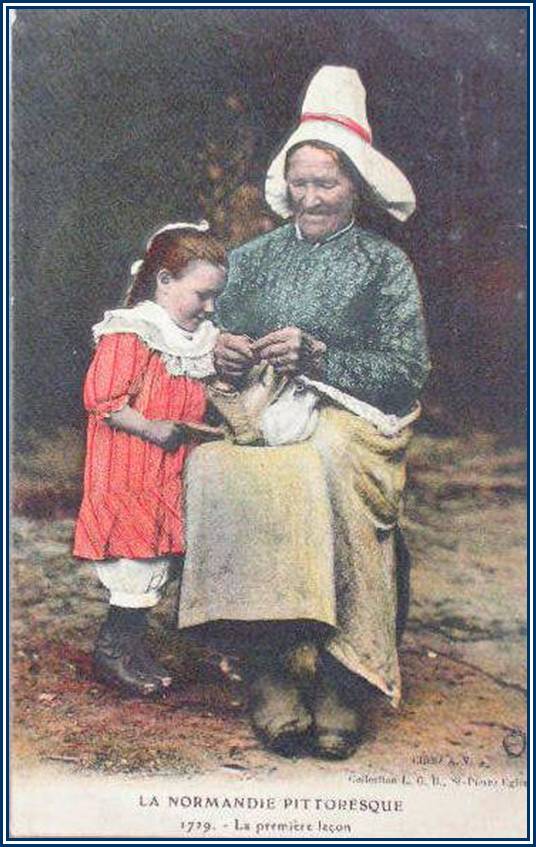 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
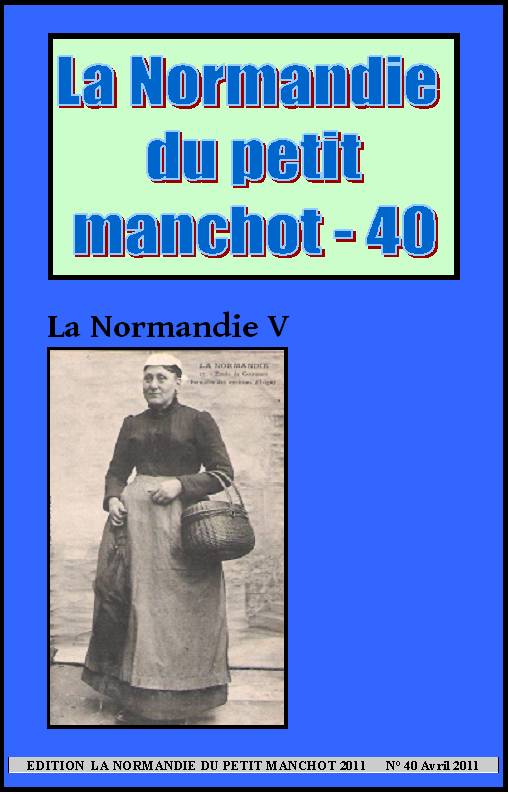 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
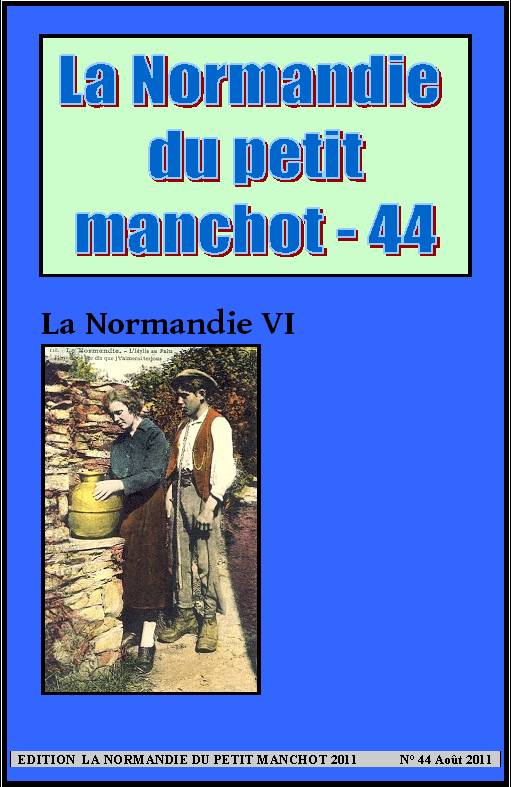 | ||
|
| ||
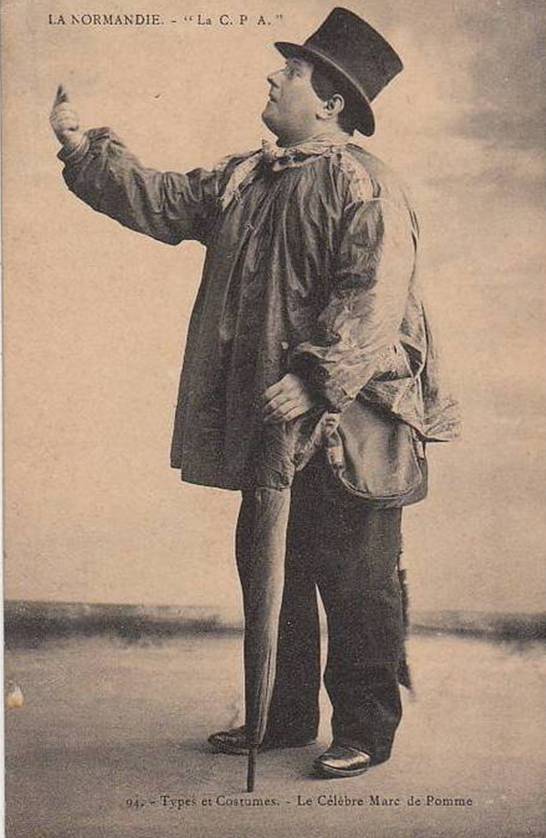 | ||
|
| ||
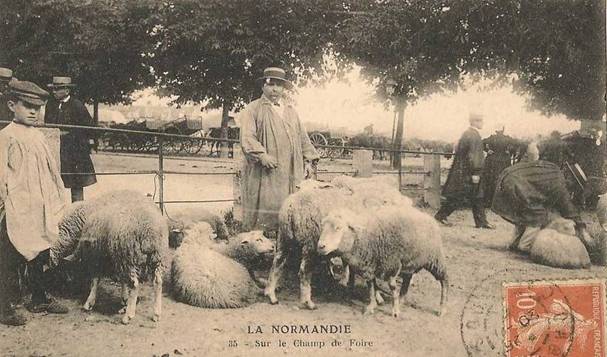 | ||
|
| ||
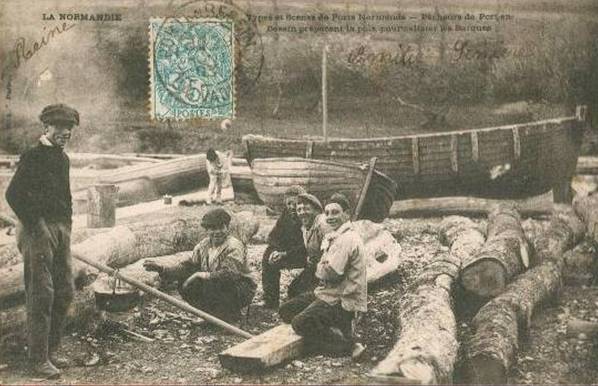 | ||
|
| ||
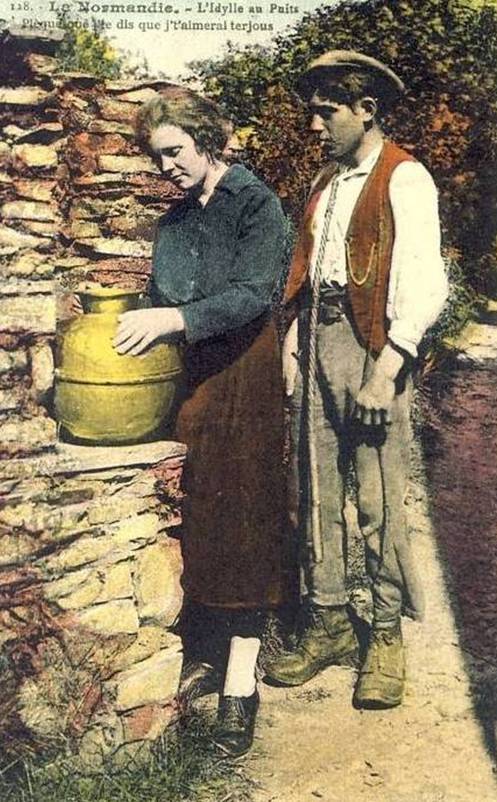 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
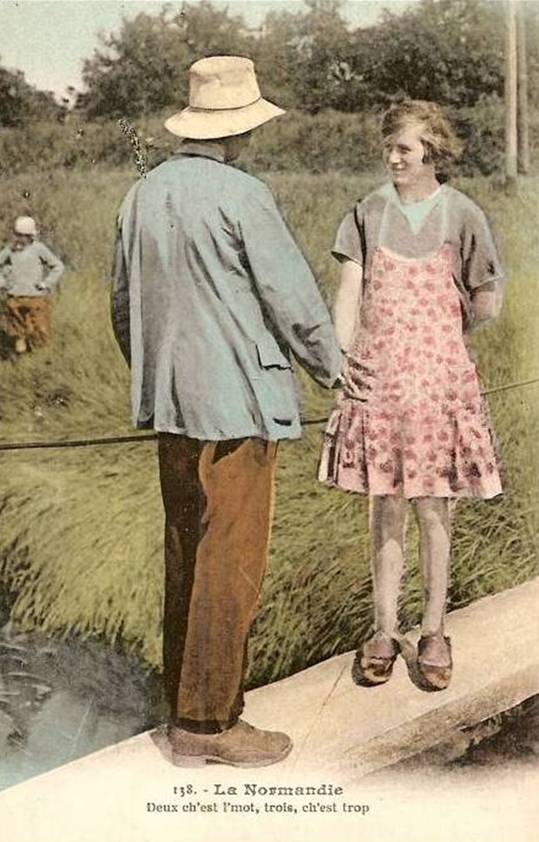 | ||
|
| ||
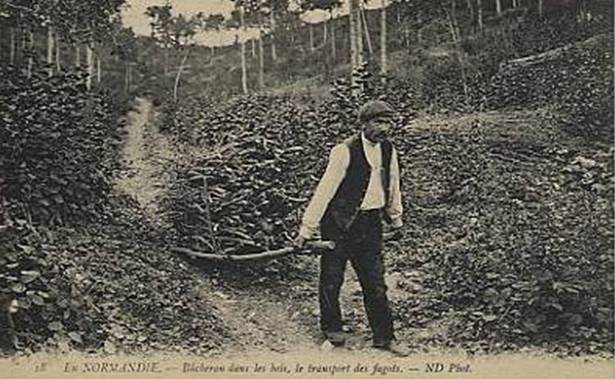 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
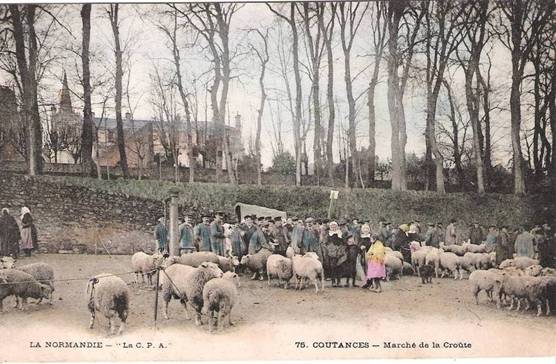 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
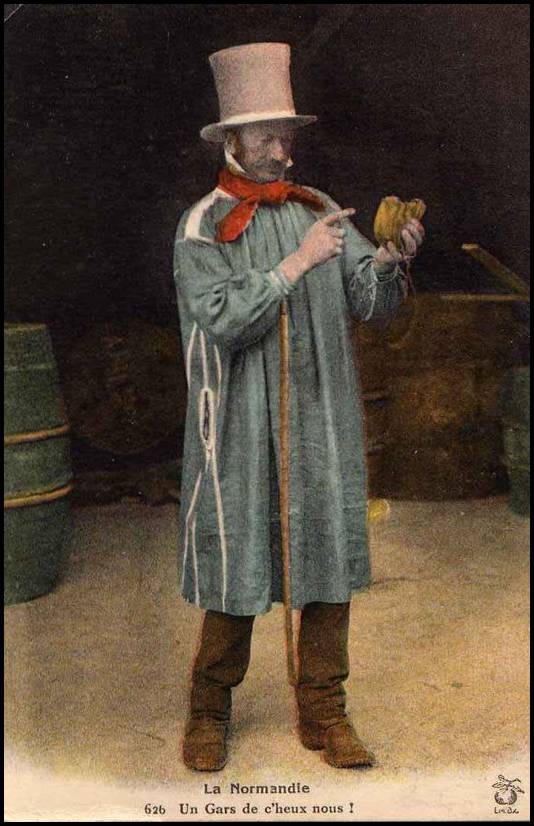 | ||
|
| ||
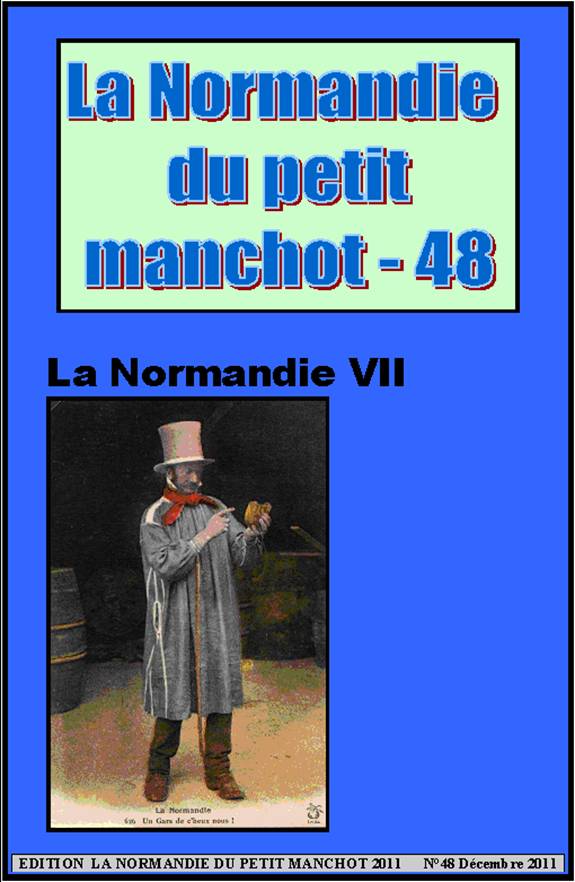 | ||
|
| ||
|
| 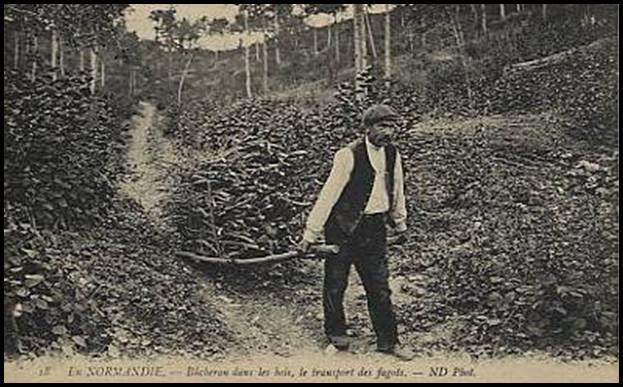 | |
|
| ||
|
| 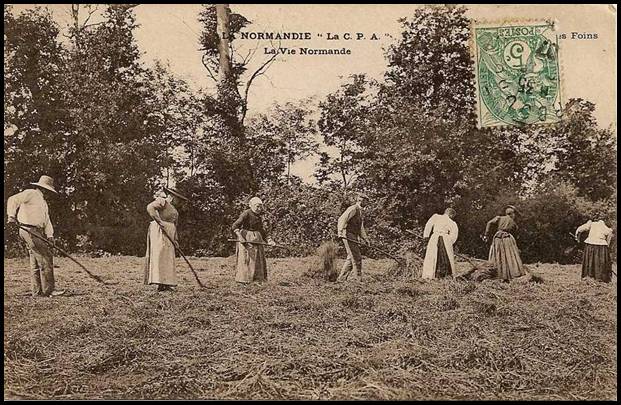 | |
|
| ||
|
| 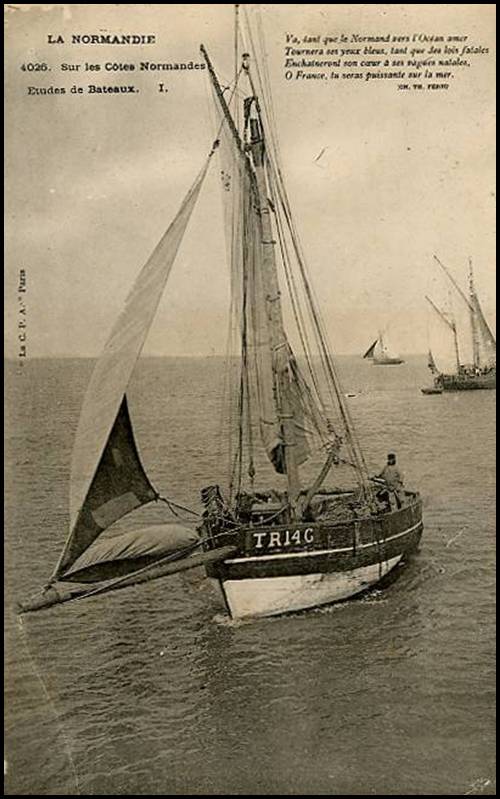 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 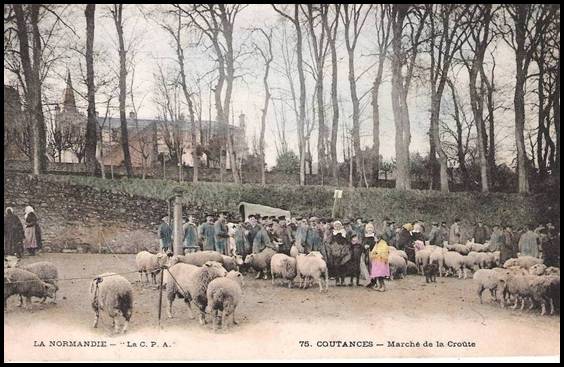 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
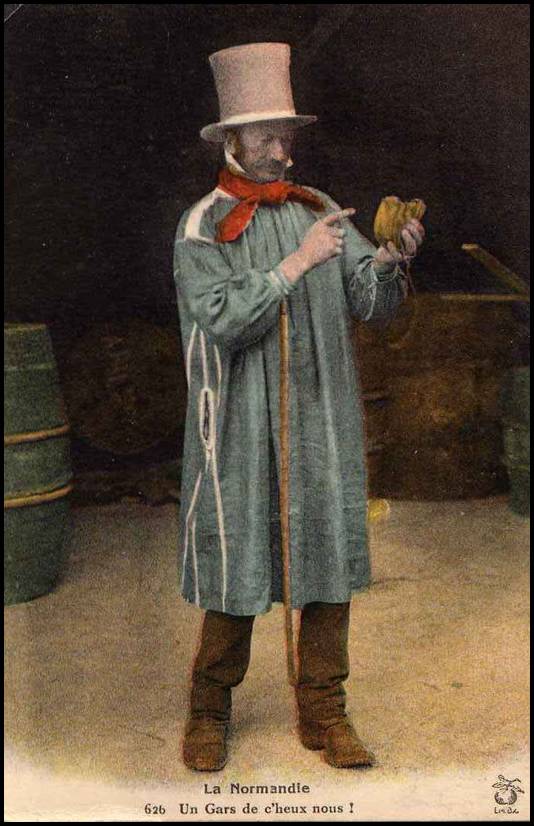 | ||
|
| ||
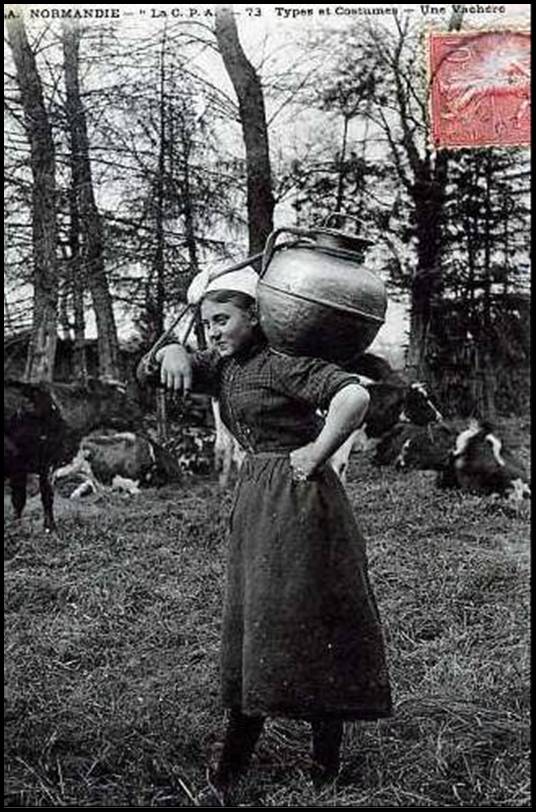 | ||
|
| ||
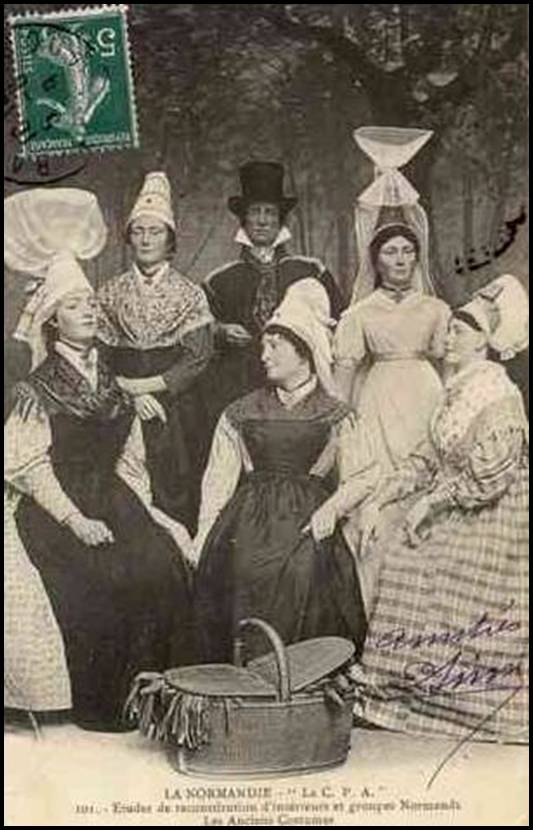 | ||
|
| ||
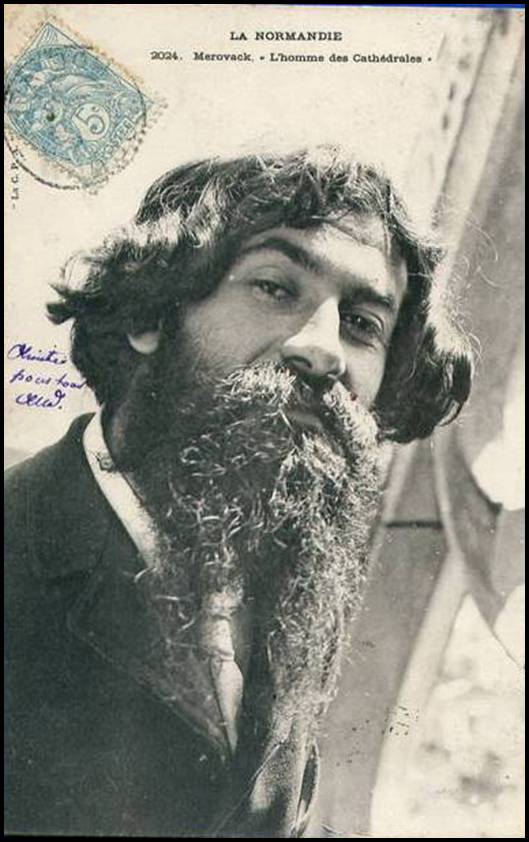 | ||
|
| ||
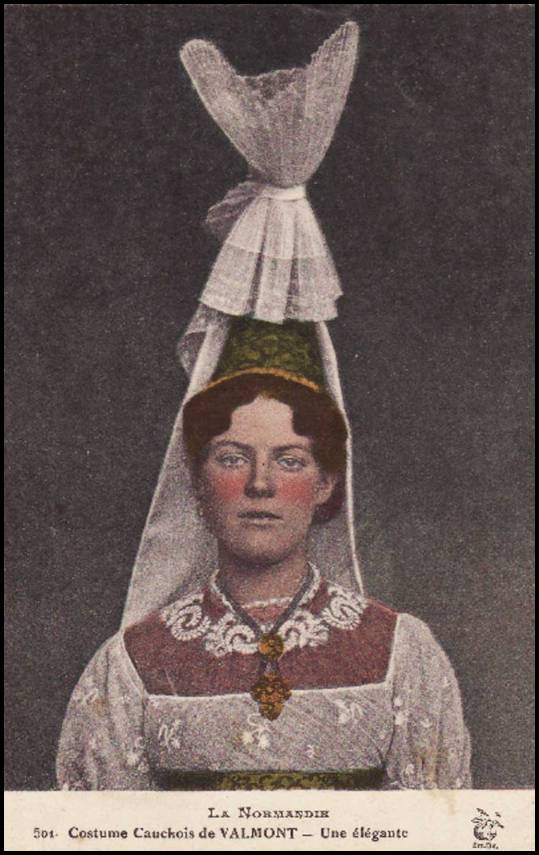 | ||
|
| ||
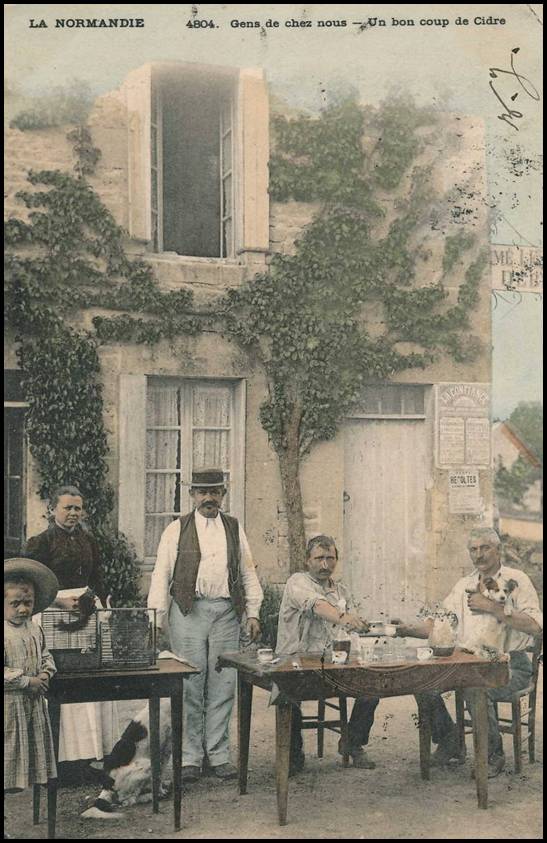 | ||
|
| ||
 | ||
|
|
|
| ||
|
| 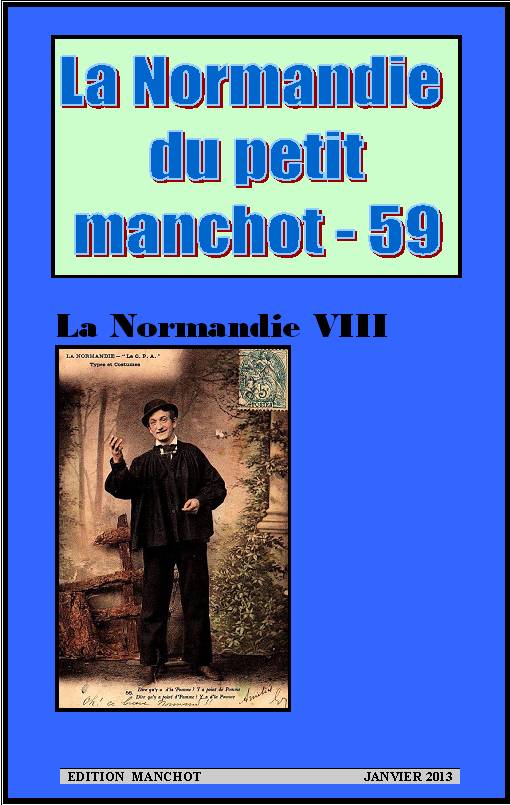 | |
|
| ||
|
| 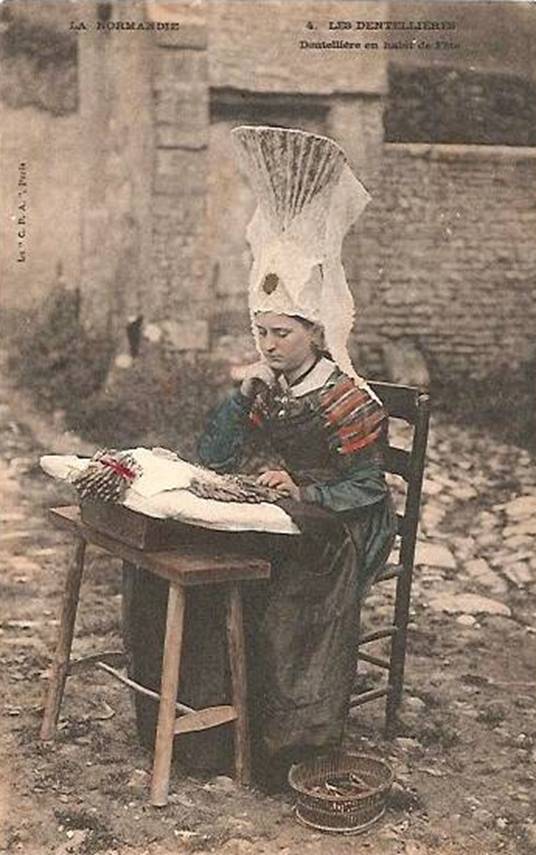 | |
|
| ||
|
| 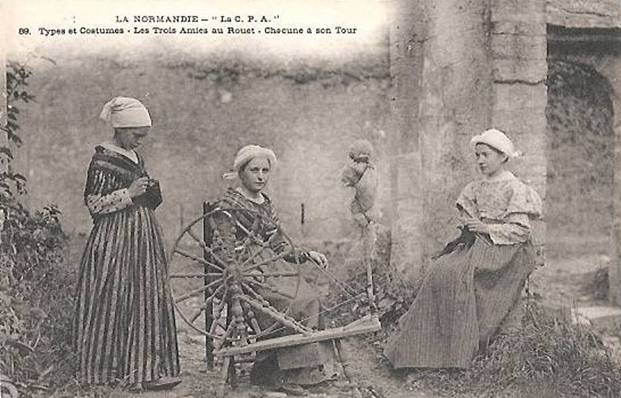 | |
|
| ||
|
| 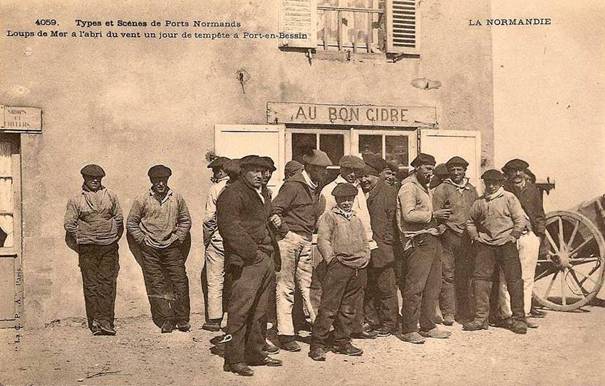 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 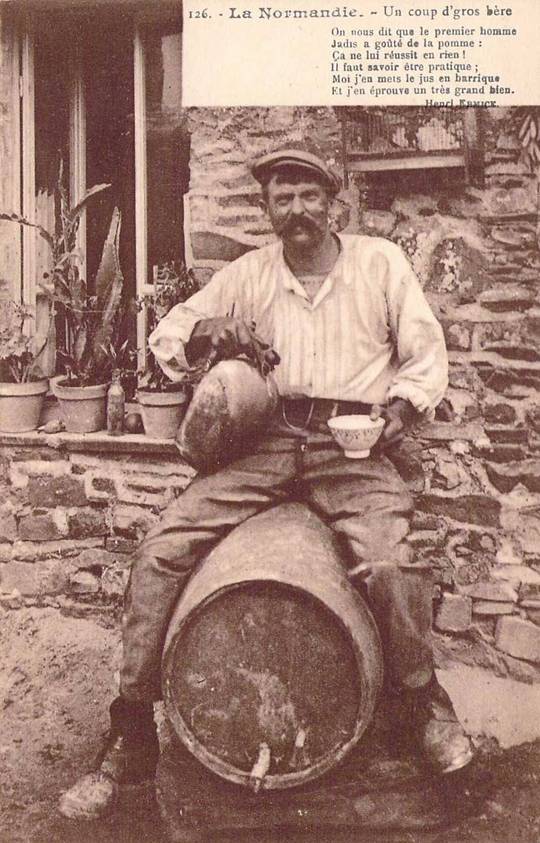 | |
|
| ||
|
| 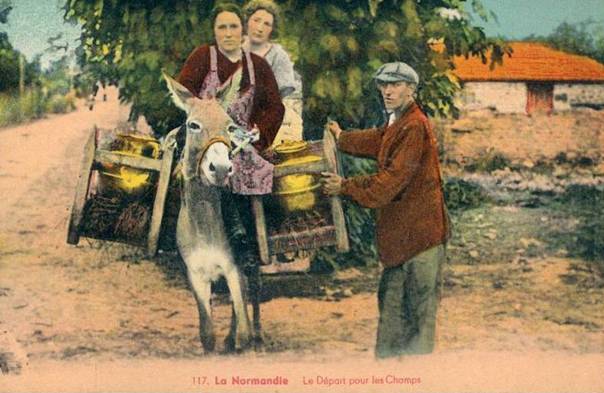 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 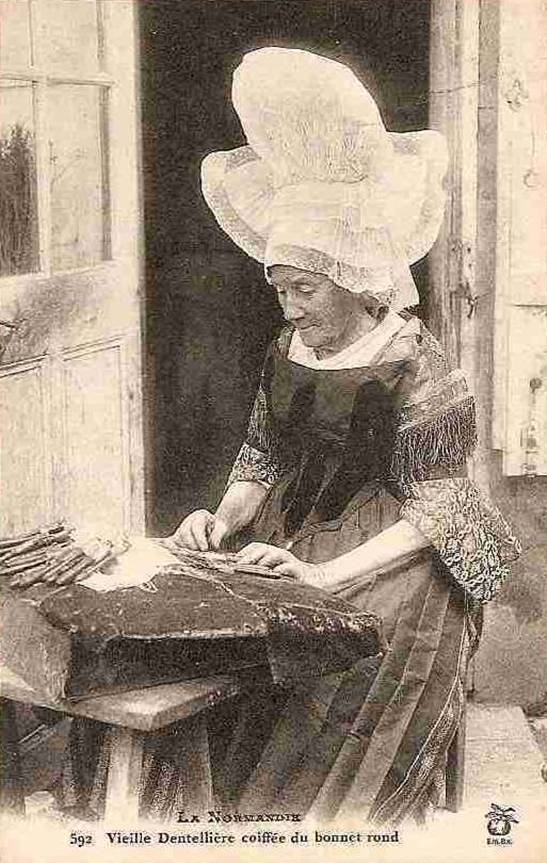 | |
|
| ||
|
| 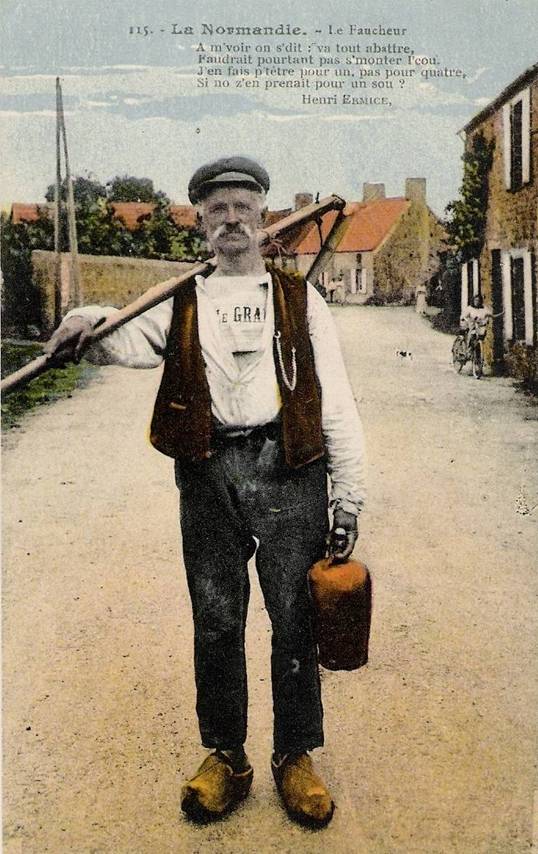 | |
|
| ||
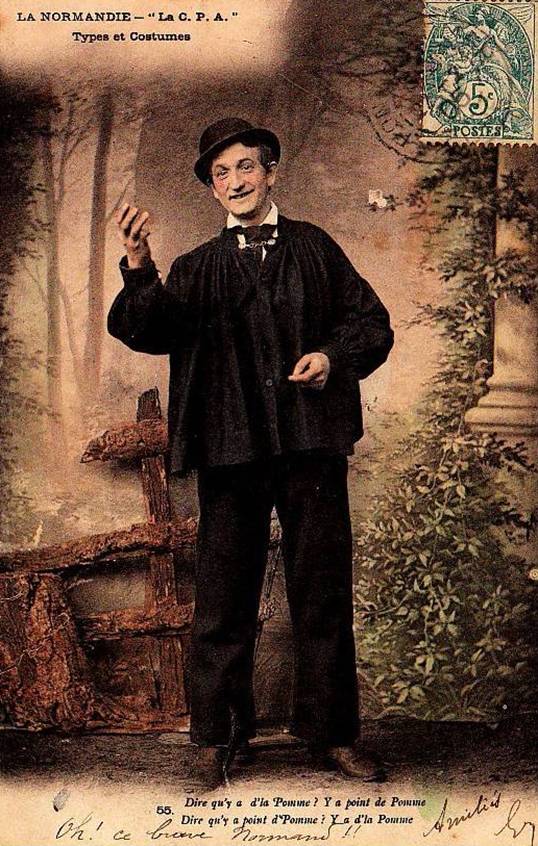 | ||
|
|
|
| ||
|
| 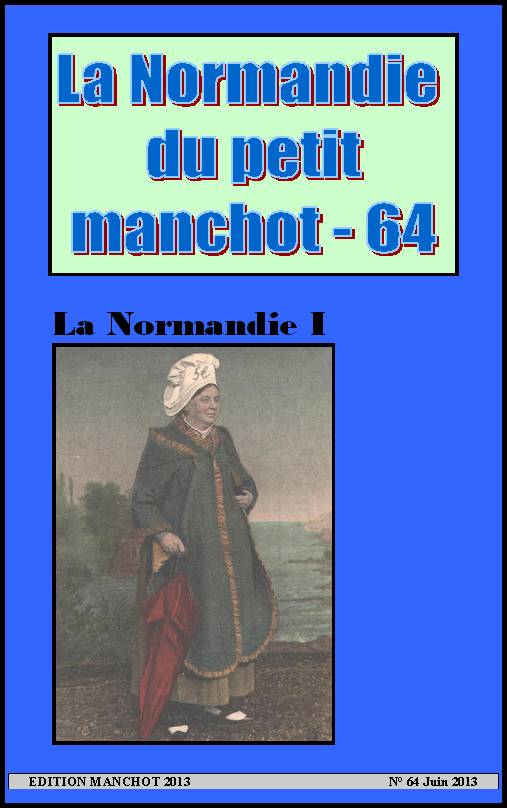 | |
|
| ||
|
| 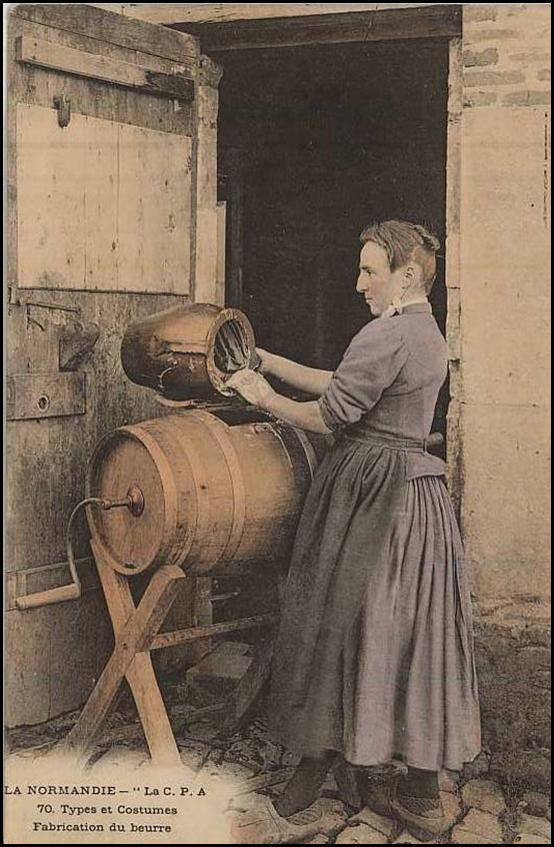 | |
|
| ||
|
| 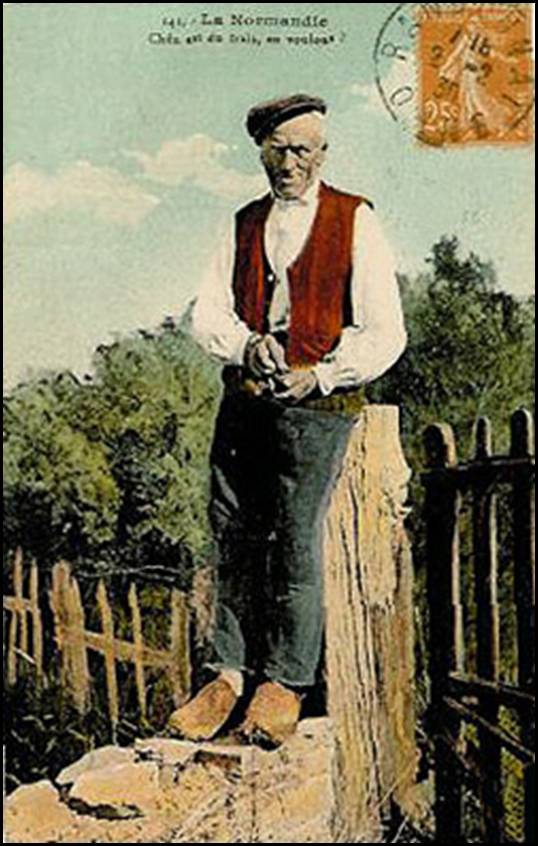 | |
|
| ||
|
| 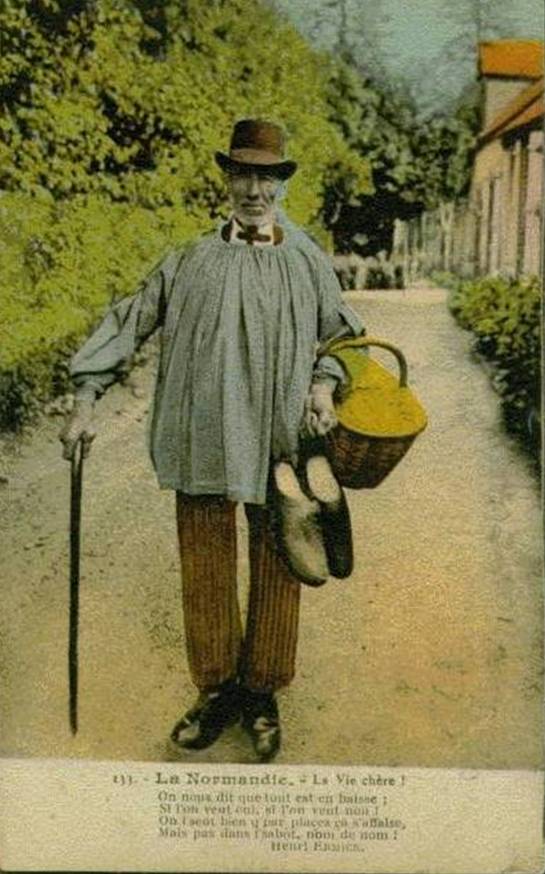 | |
|
| ||
|
| 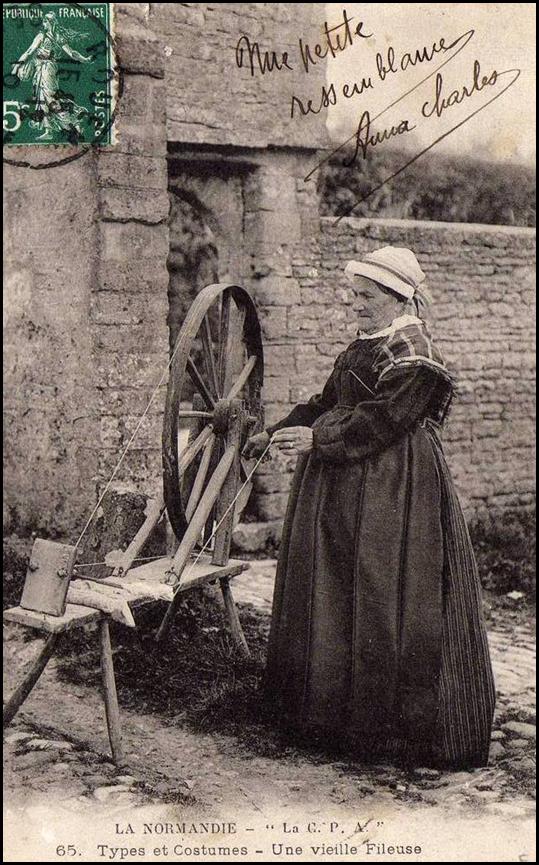 | |
|
| ||
|
| 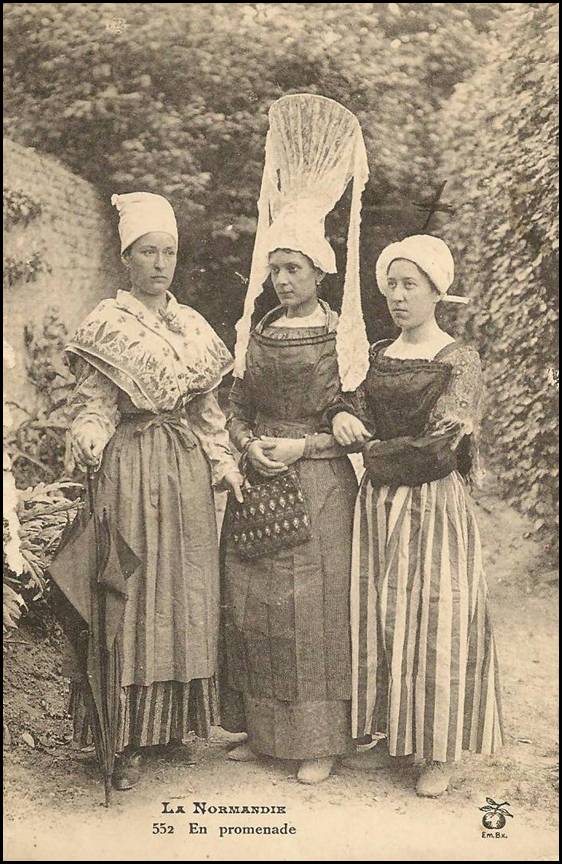 | |
|
| ||
|
| 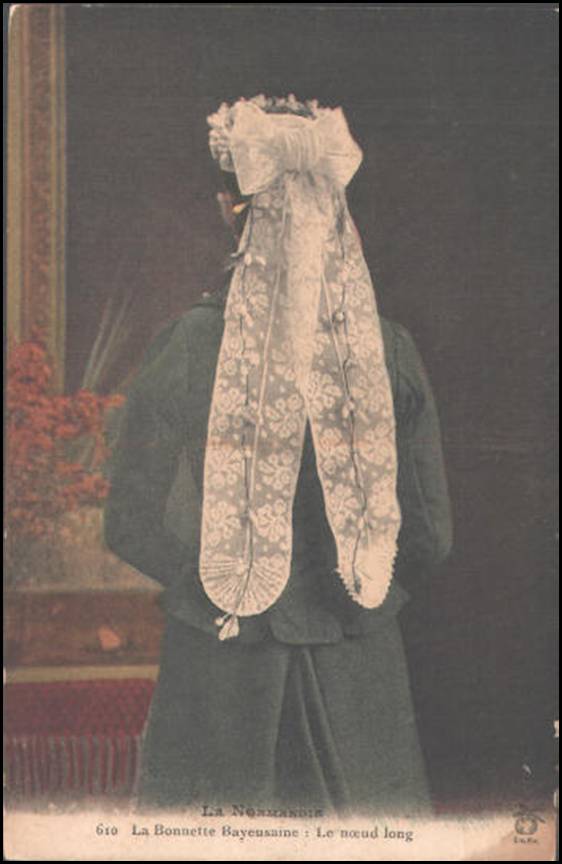 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 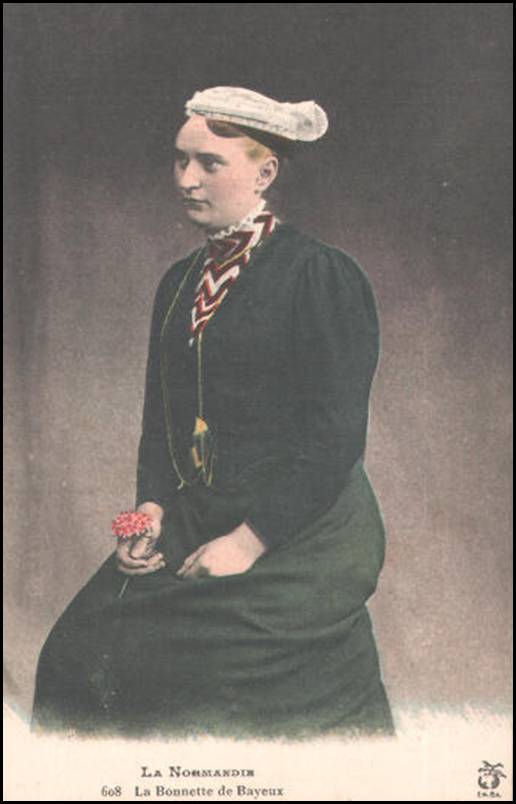 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
|
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°46 Octobre 2011
| ||||
|
 Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 09-13-32-43-46-49-56-60-62-65-68-86
| ||||
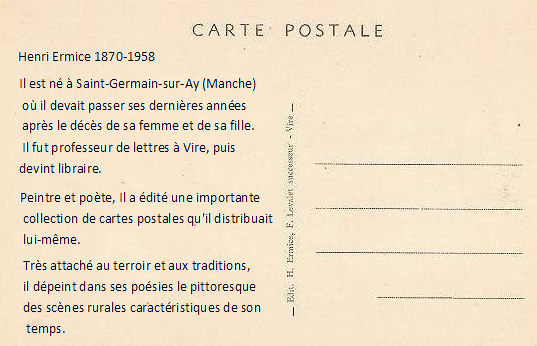 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
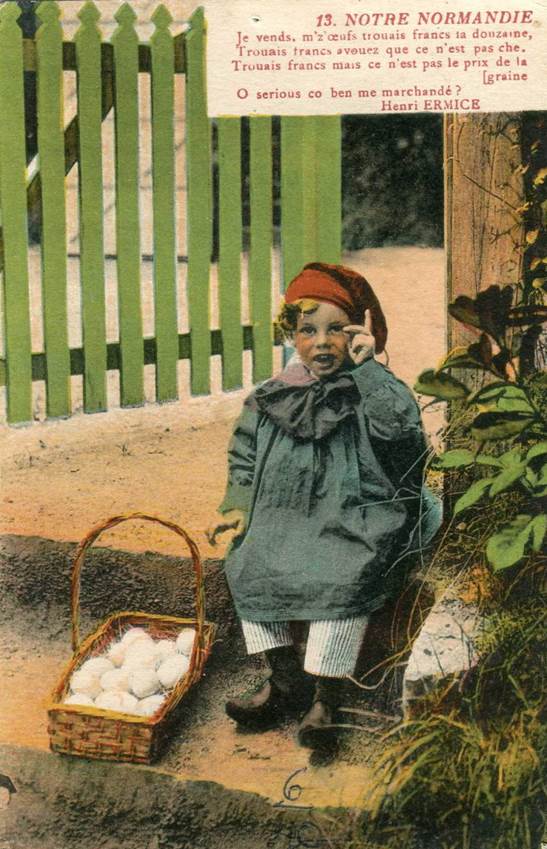 | ||||
|
| ||||
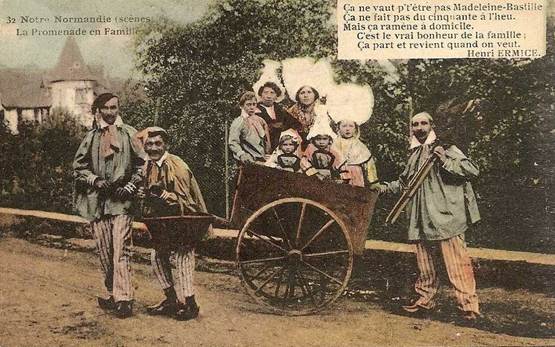 | ||||
|
| ||||
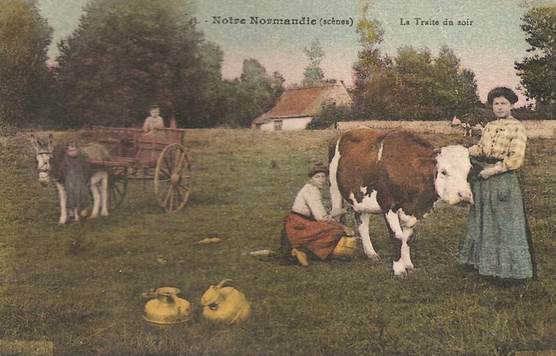 | ||||
|
| ||||
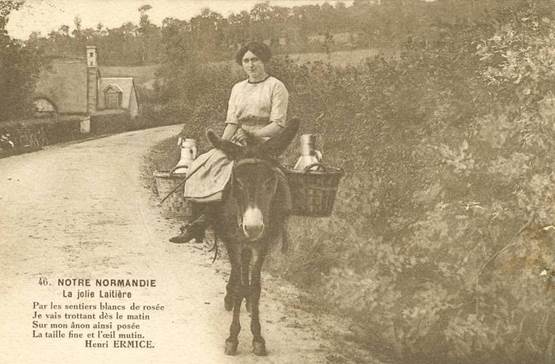 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
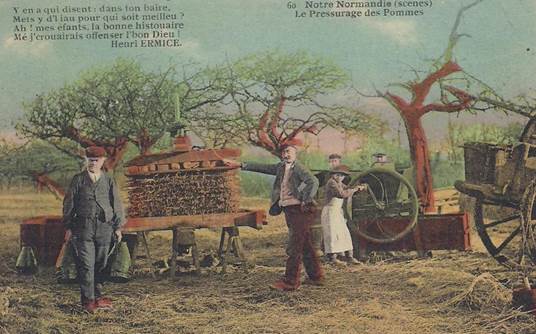 | ||||
|
| ||||
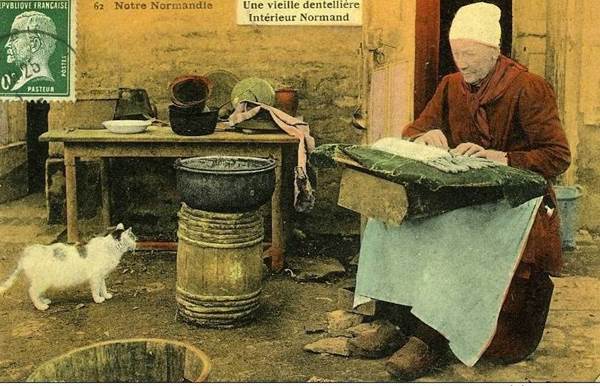 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°52 Avril 2012
| ||||
|
 Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 14-17-26-33-35-44-50-54-82-104-105-106 111-157
| ||||
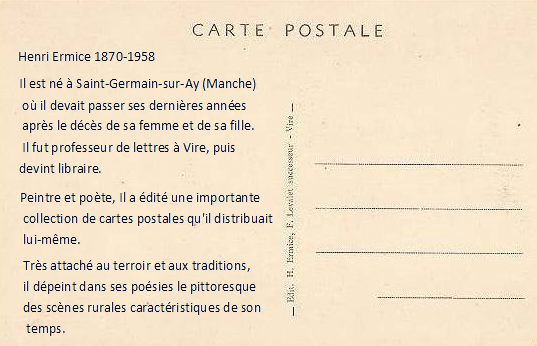 | ||||
|
| ||||
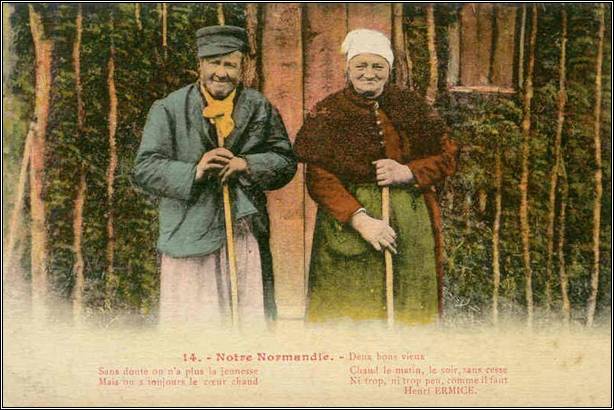 | ||||
|
| ||||
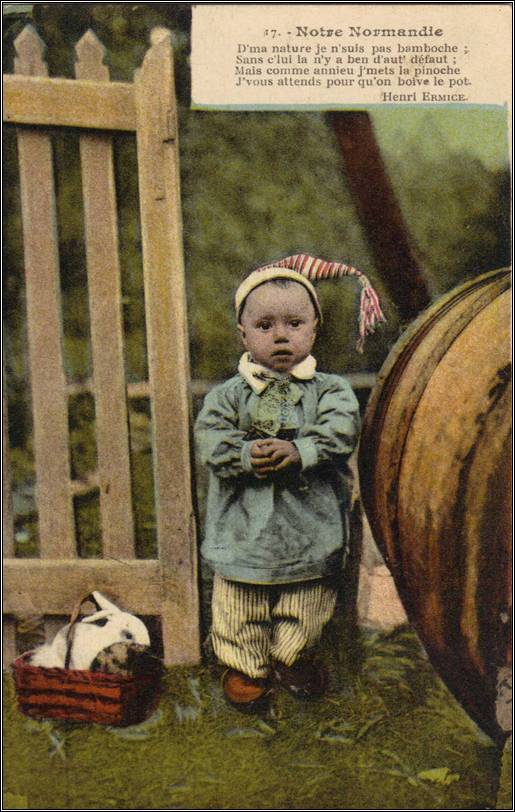 | ||||
|
| ||||
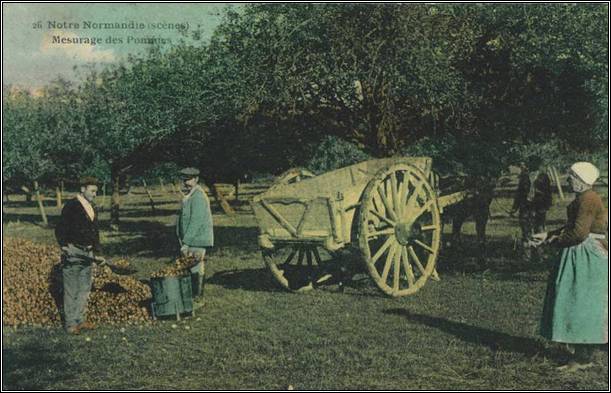 | ||||
|
| ||||
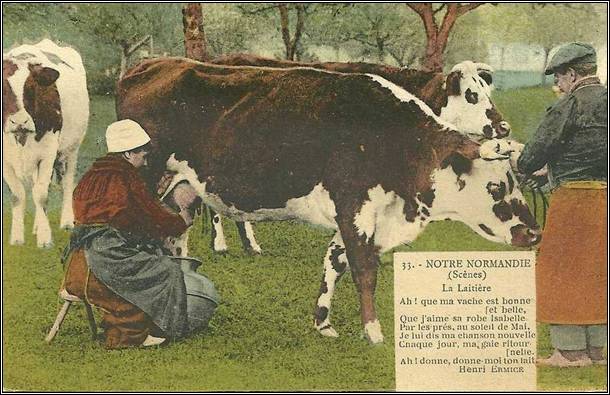 | ||||
|
| ||||
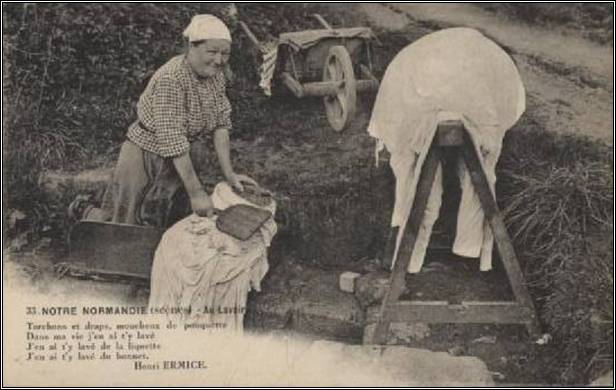 | ||||
|
| ||||
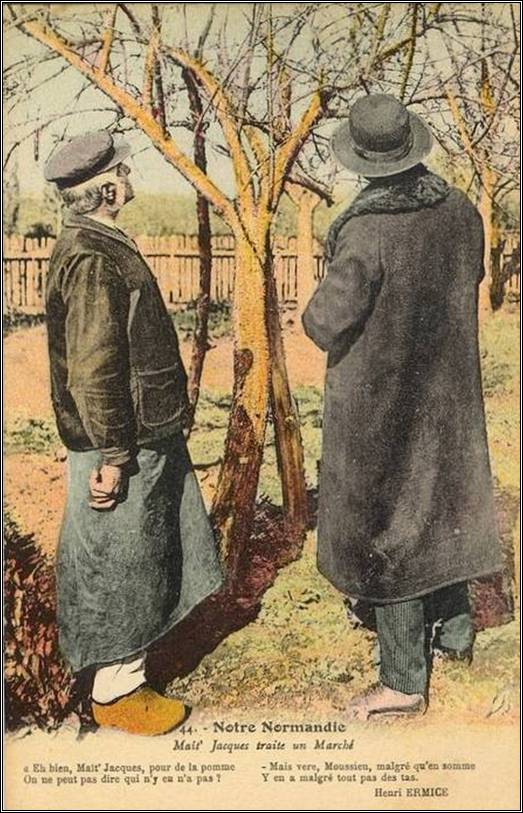 | ||||
|
| ||||
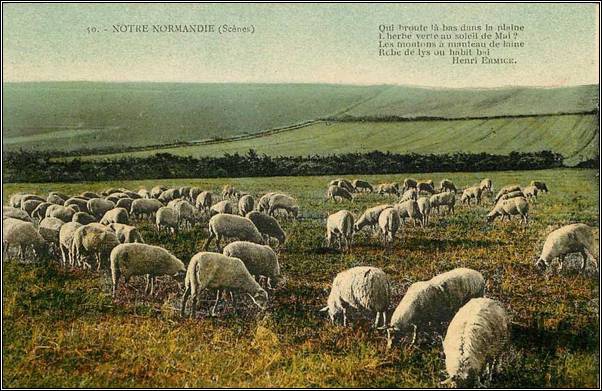 | ||||
|
| ||||
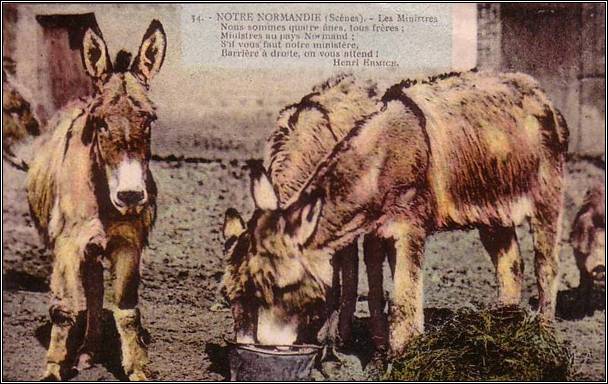 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
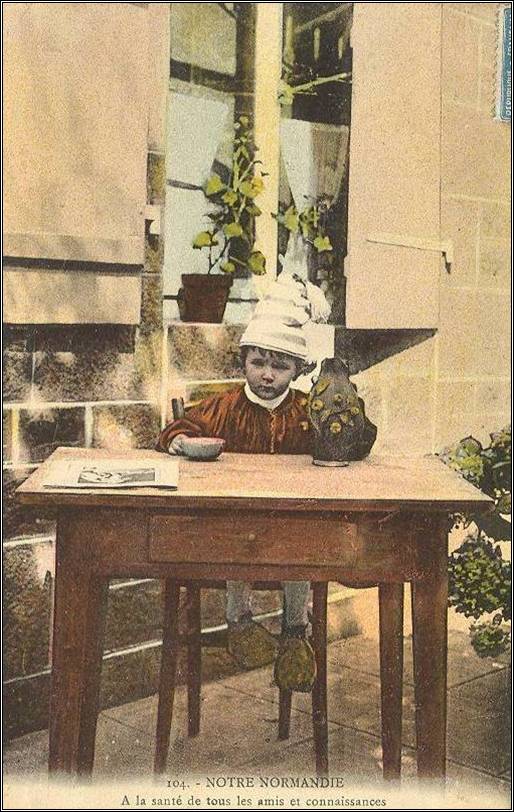 | ||||
|
| ||||
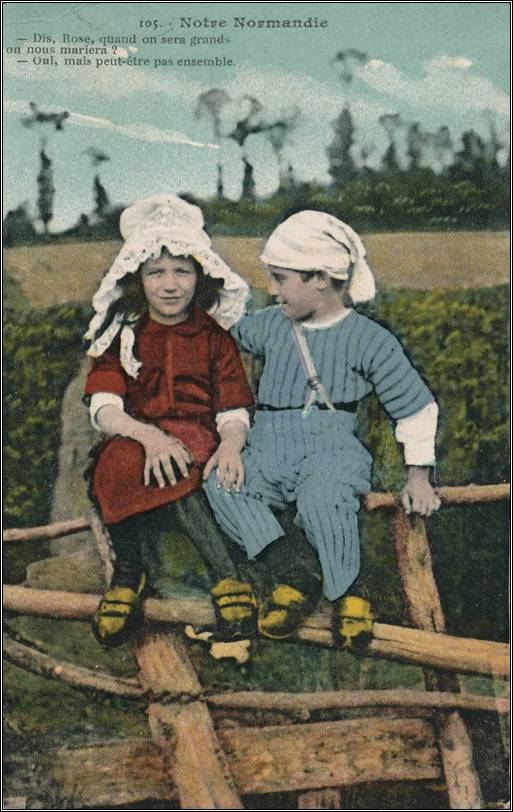 | ||||
|
| ||||
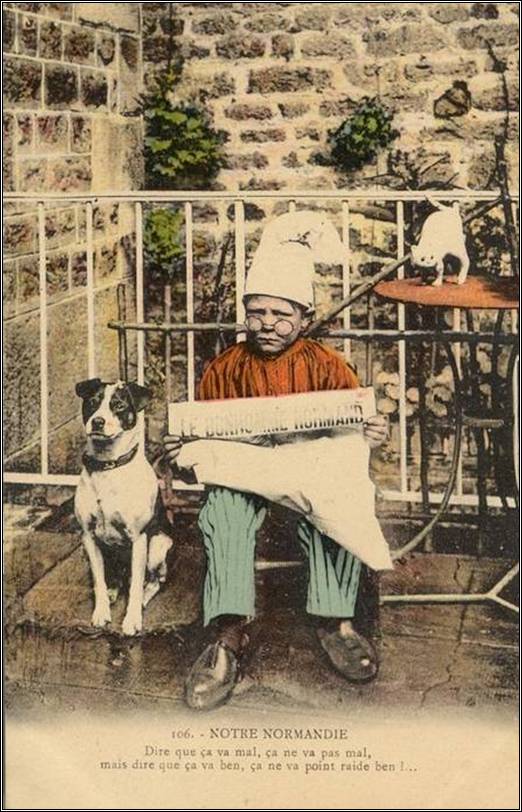 | ||||
|
| ||||
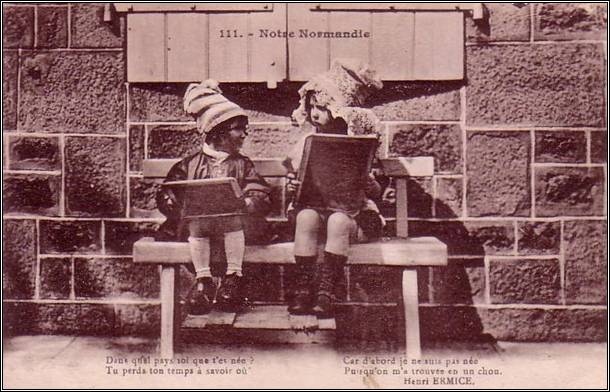 | ||||
|
| ||||
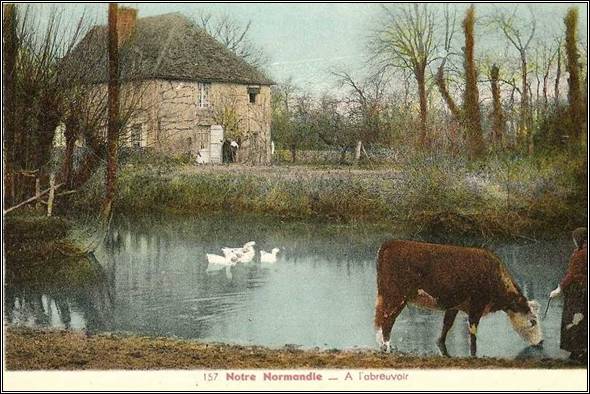 | ||||
|
| ||||
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°57 Novembre 2012
| ||||
|
 Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 04-15-18-28-38-39-52-58-76-133-146
| ||||
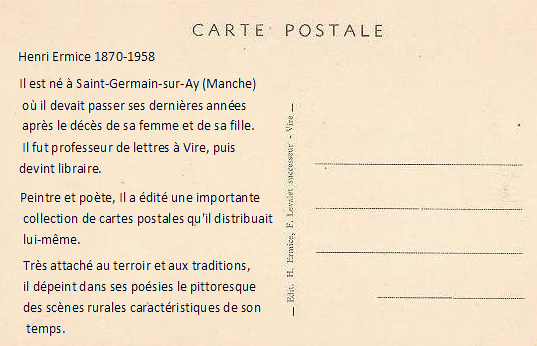 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
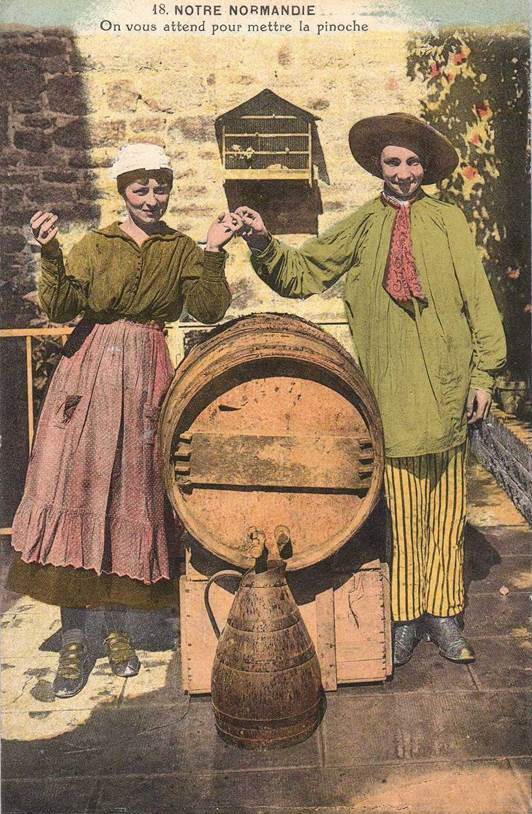 | ||||
|
| ||||
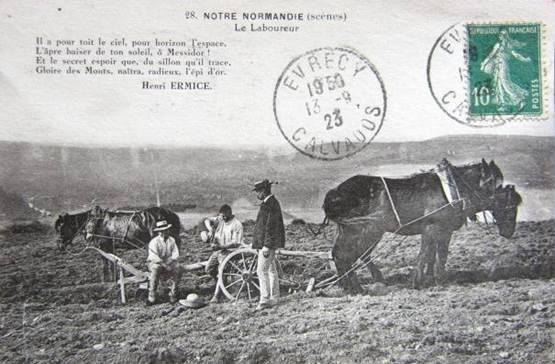 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
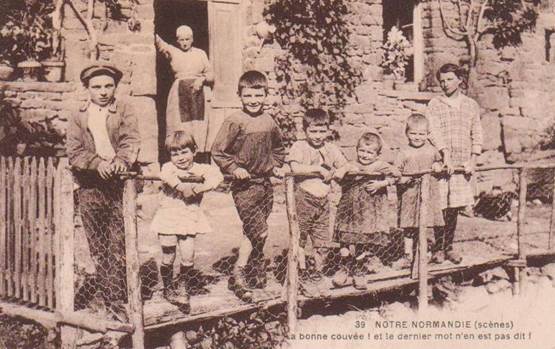 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
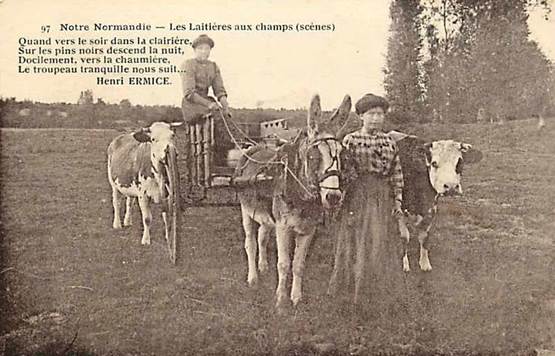 | ||||
|
| ||||
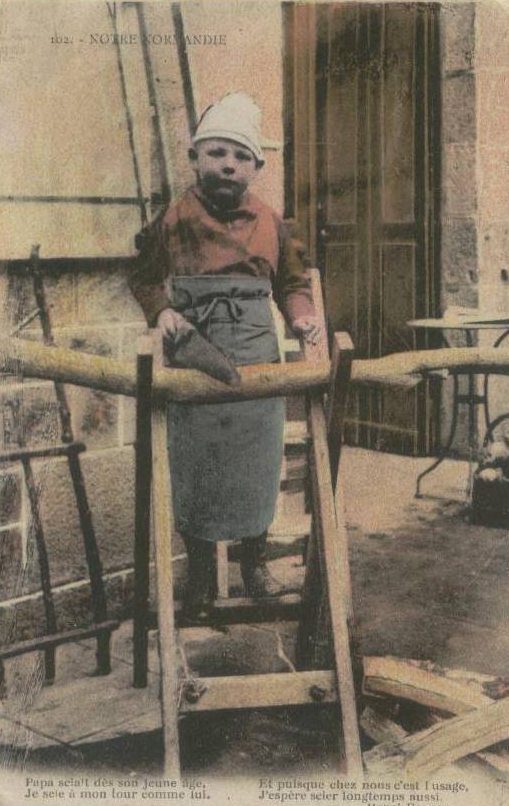 | ||||
|
| ||||
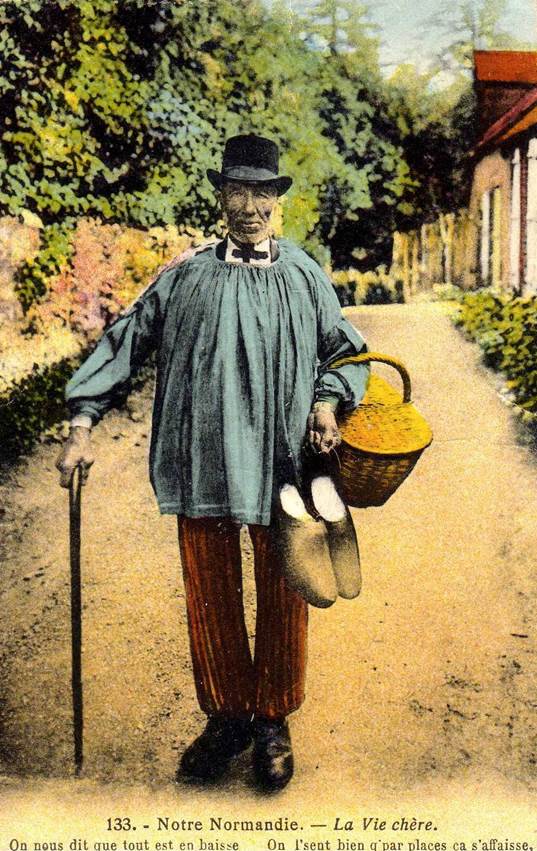 | ||||
|
| ||||
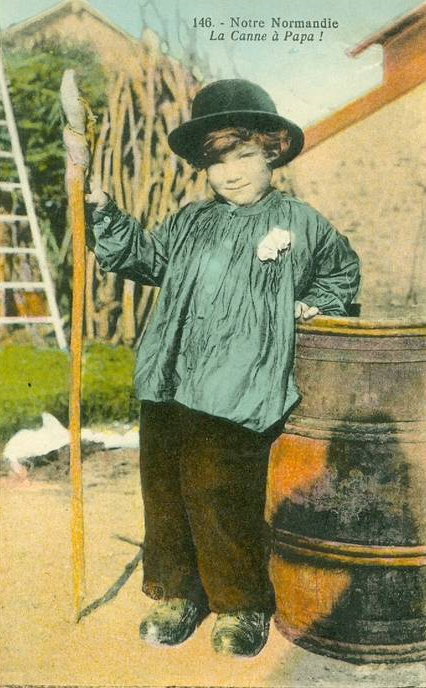 | ||||
|
| ||||
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°67 Novembre 2013
| ||||
 Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 05-08-10-19-21-22-23-40-64-115-147 | ||||
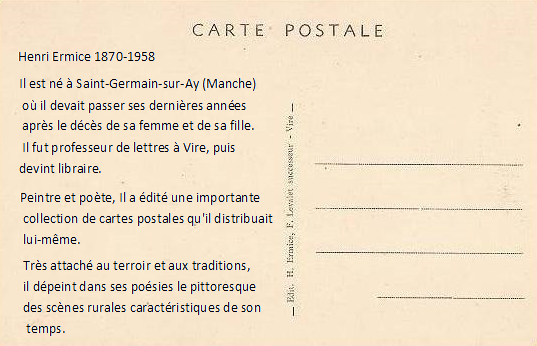 | ||||
|
| ||||
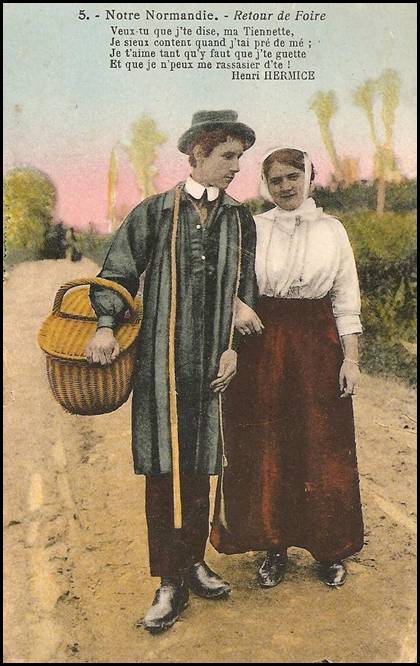 | ||||
|
| ||||
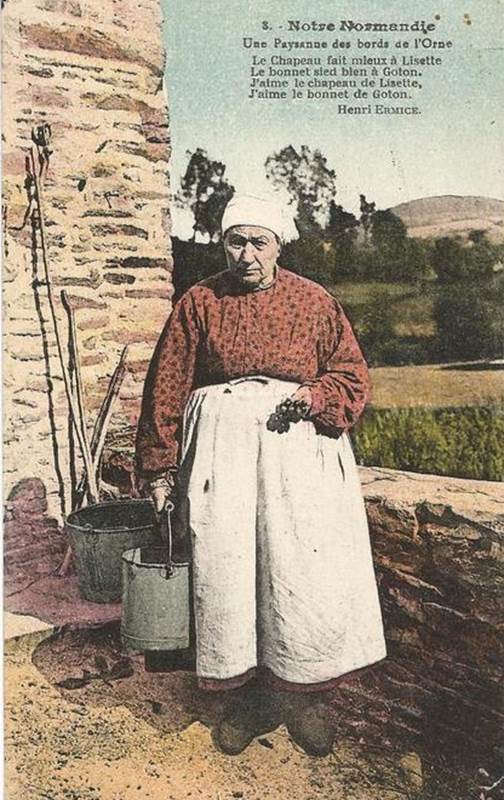 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
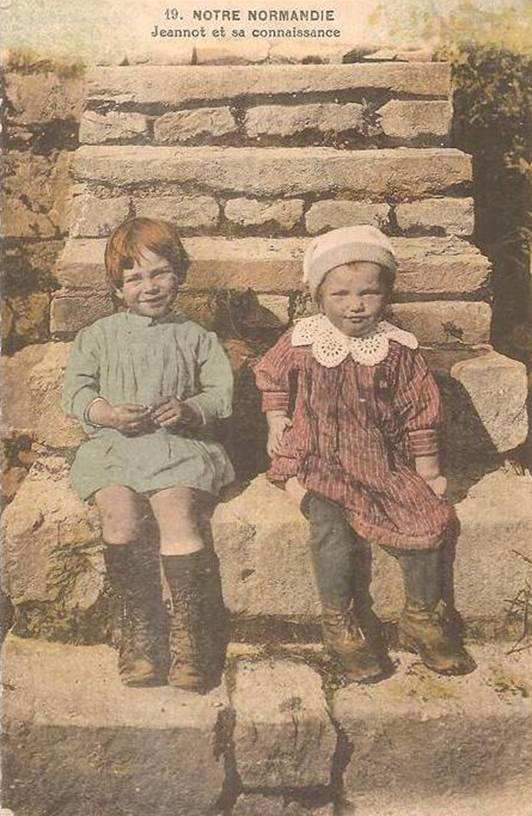 | ||||
|
| ||||
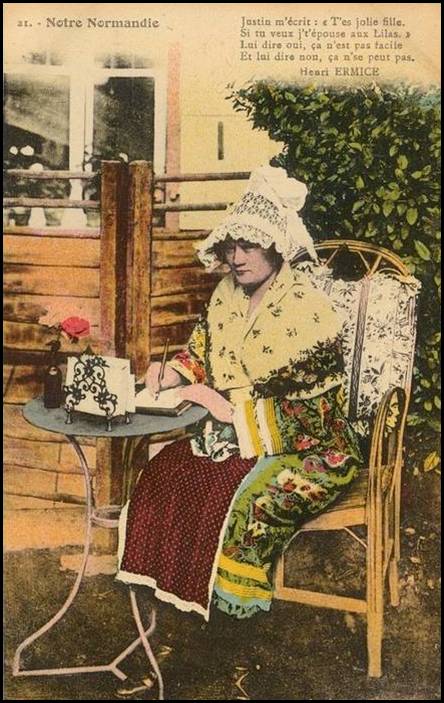 | ||||
|
| ||||
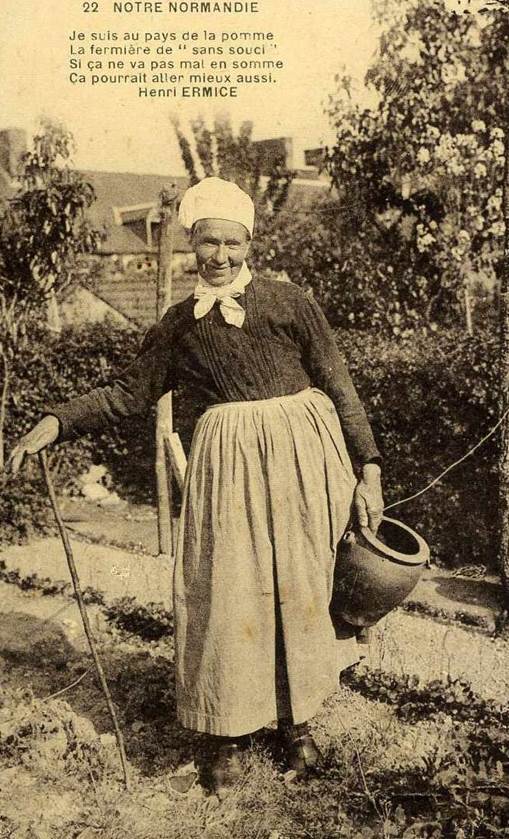 | ||||
|
| ||||
 | ||||
|
| ||||
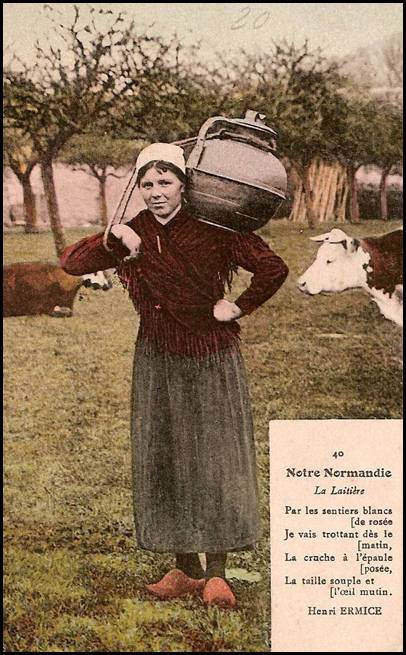 | ||||
|
| ||||
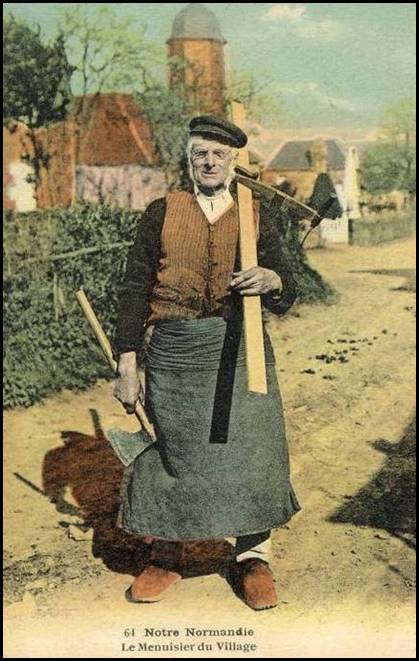 | ||||
|
| ||||
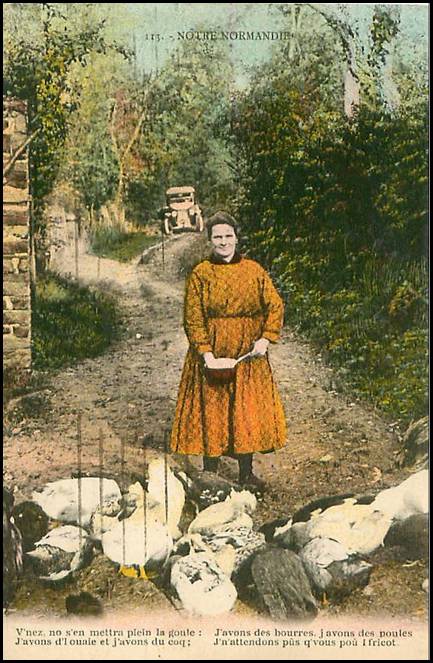 | ||||
|
| ||||
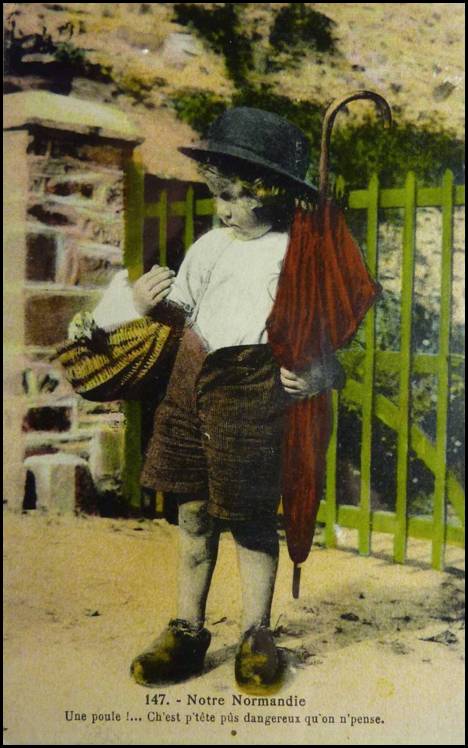 | ||||
|
| ||||
|
| ||
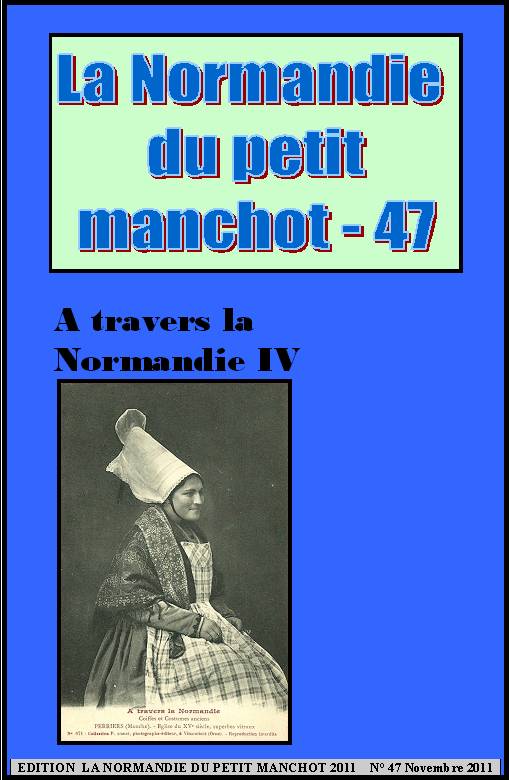 | ||
|
| ||
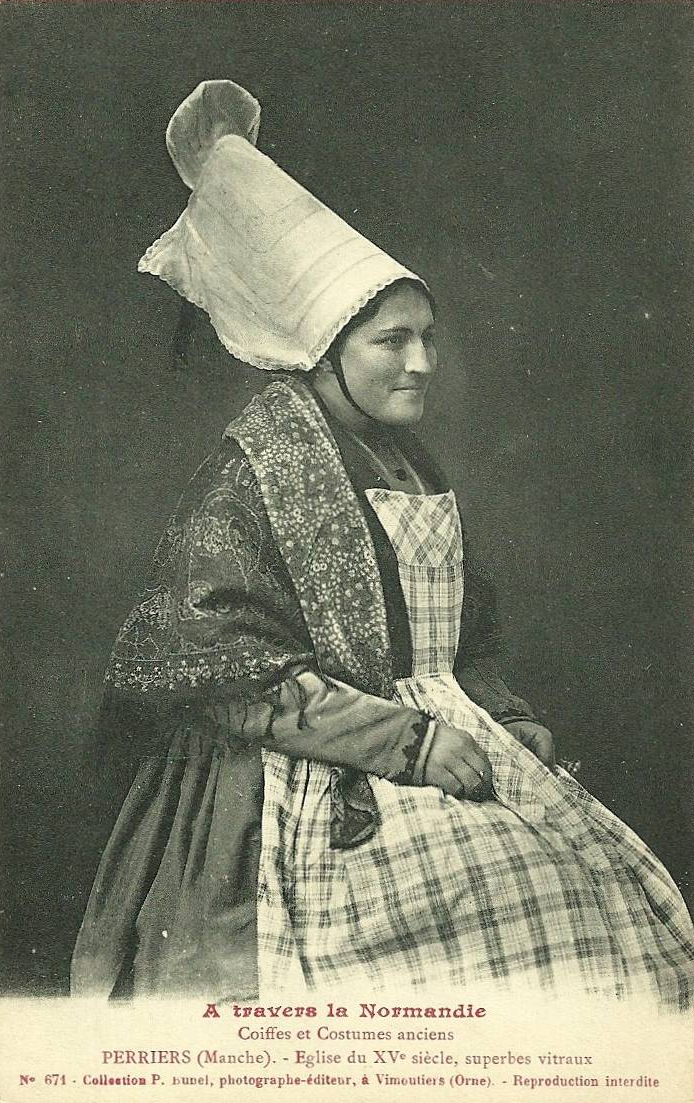 | ||
|
| ||
|
| 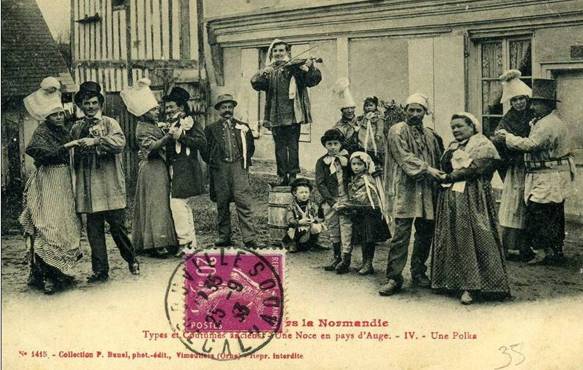 | |
|
| ||
|
| 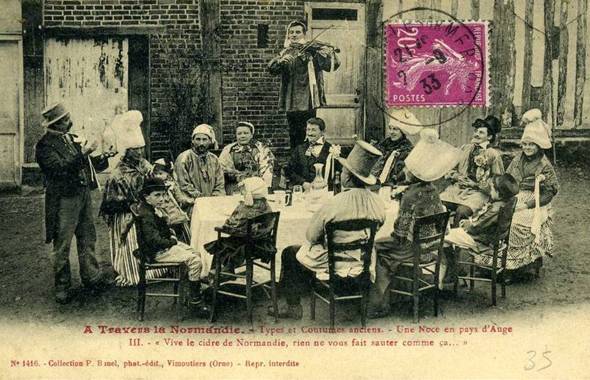 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 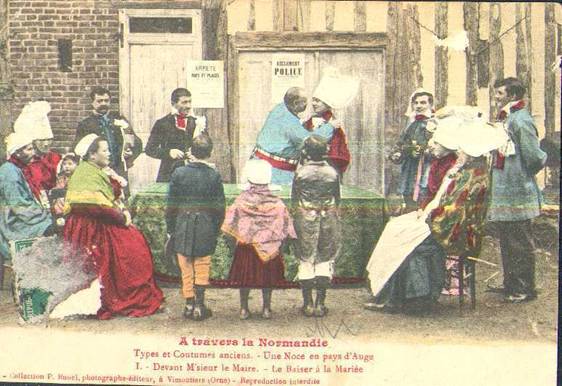 | |
|
| ||
|
| 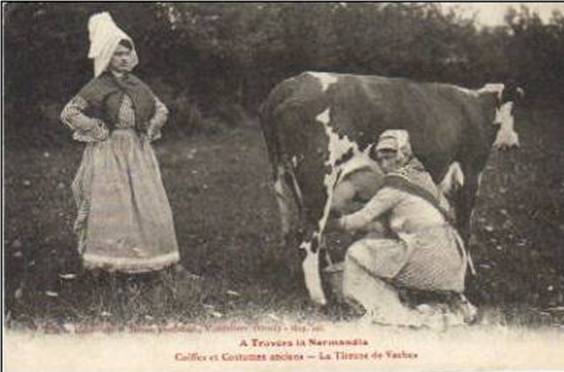 | |
|
| ||
|
| 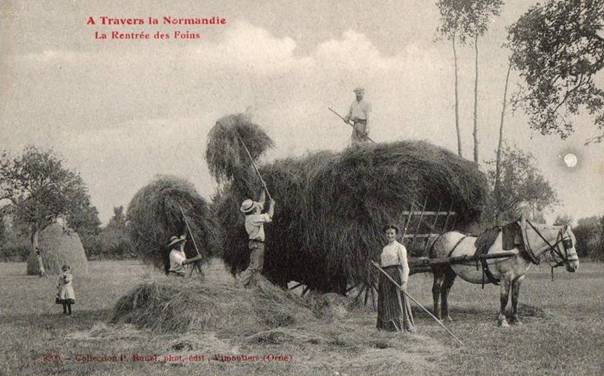 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 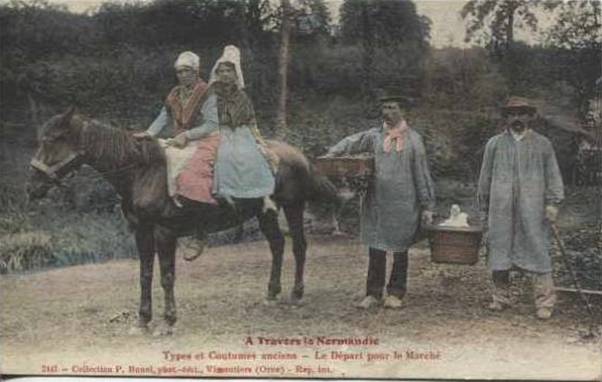 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 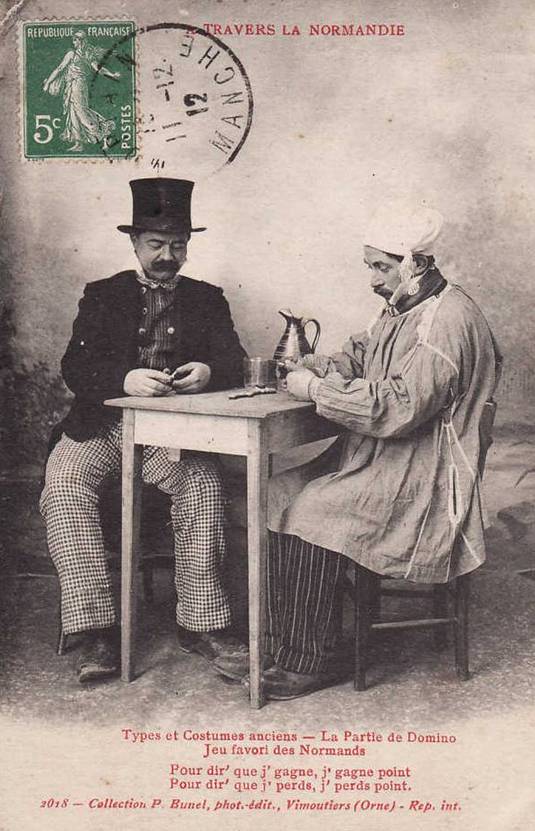 | |
|
| ||
|
| 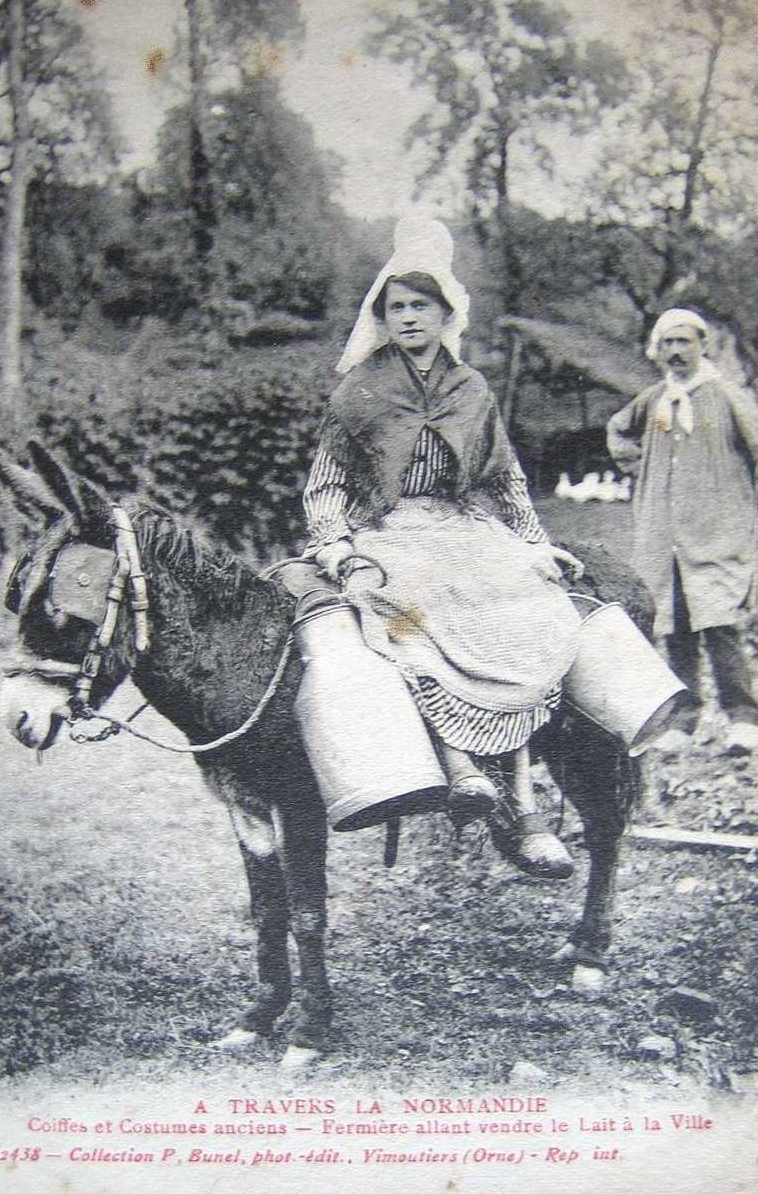 | |
|
|
|
| ||
|
| 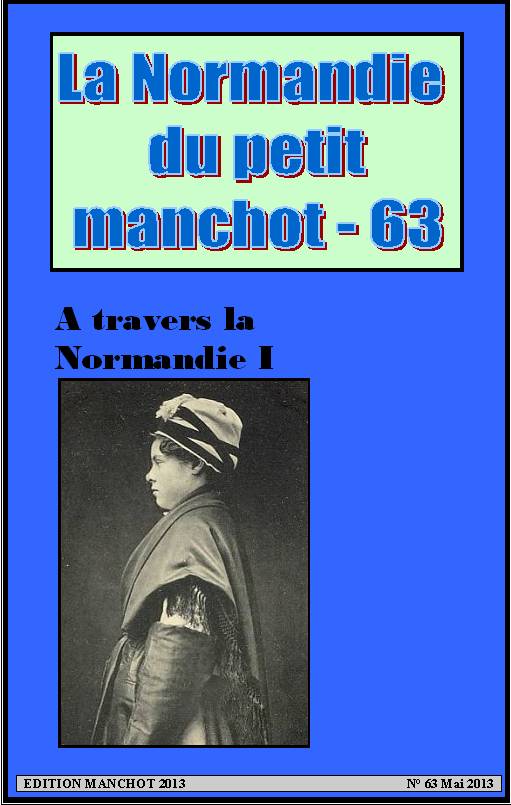 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 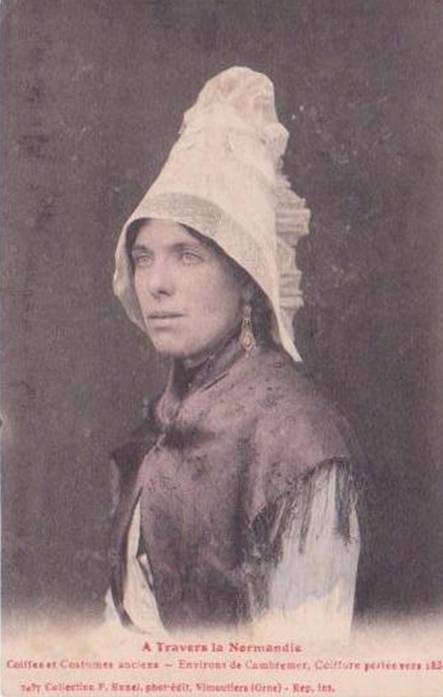 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
|
|
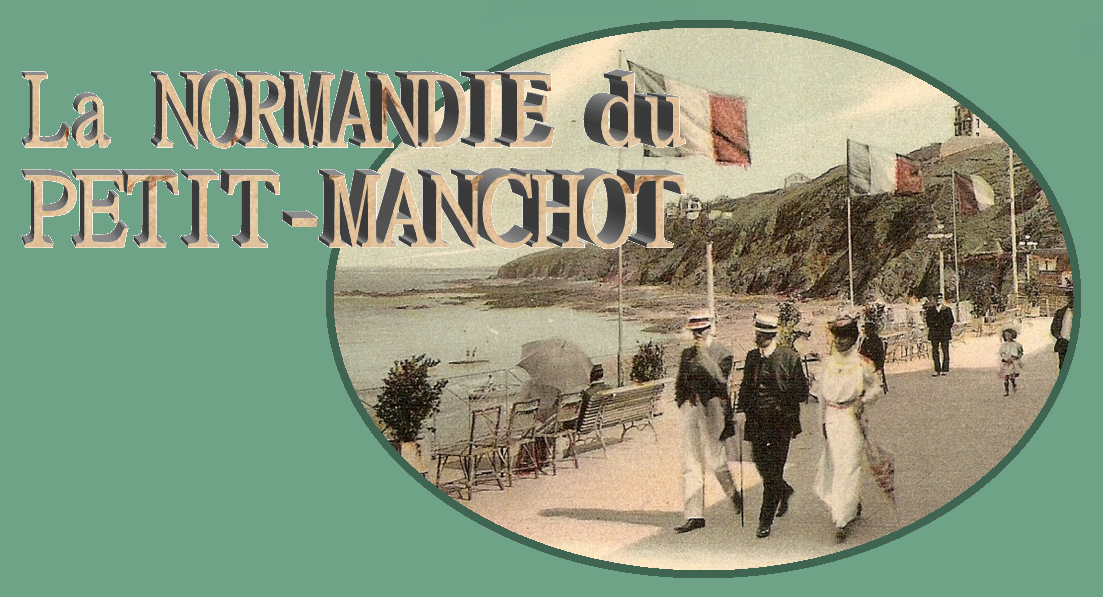 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°70 Février 2014
| ||||
|
| ||||
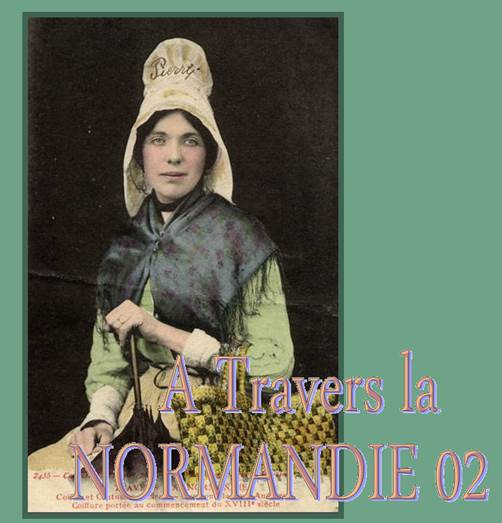 | ||||
|
| ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
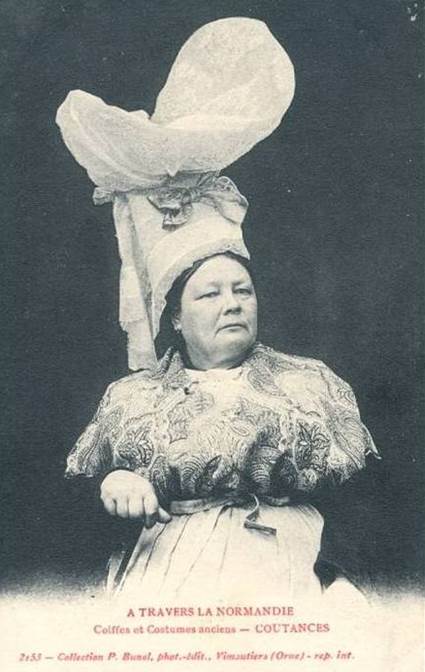 | ||||
 | ||||
 | ||||
 | ||||
|
| ||||
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 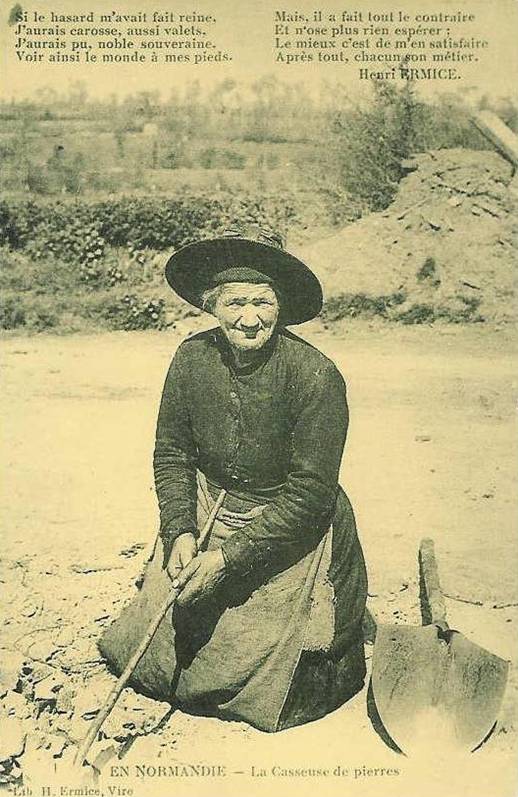 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 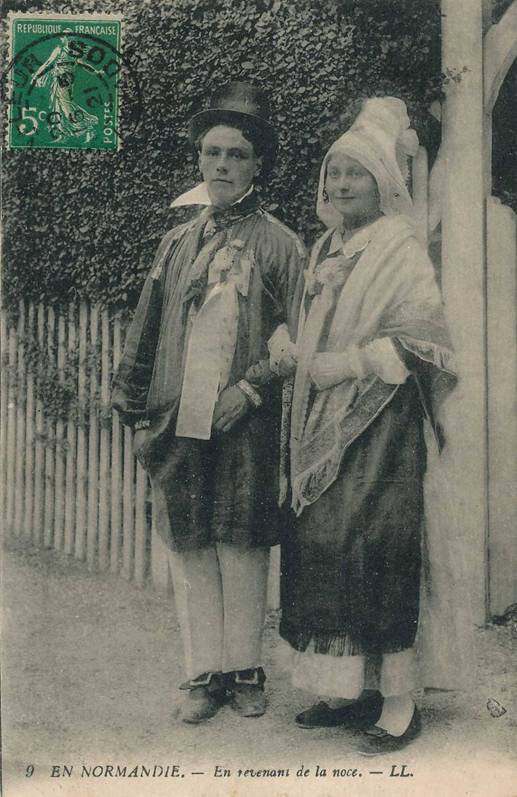 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 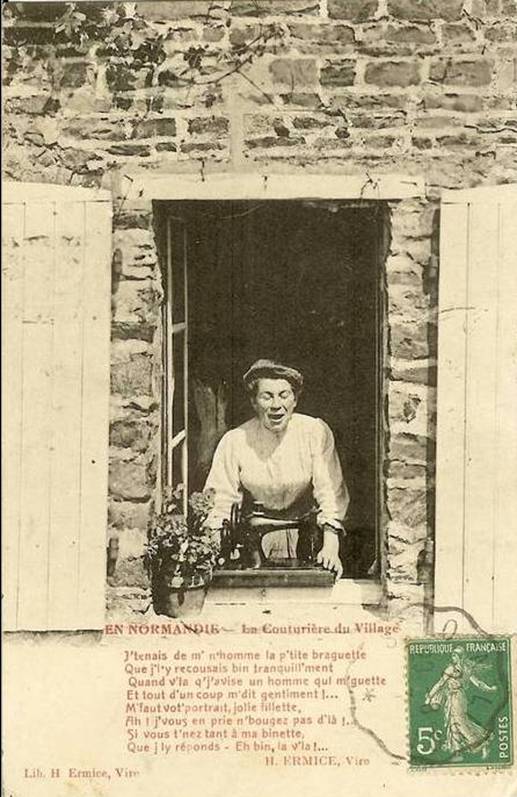 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 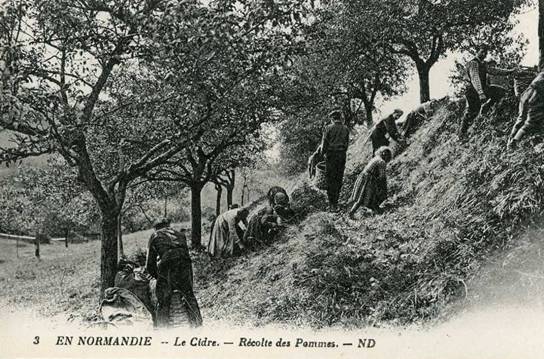 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| 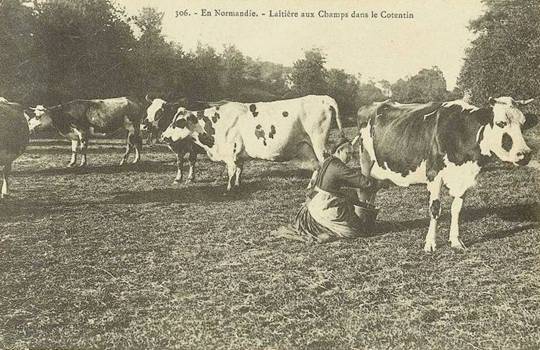 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|  | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
|
|
Votre contenu ici...
|
| ||
|
| 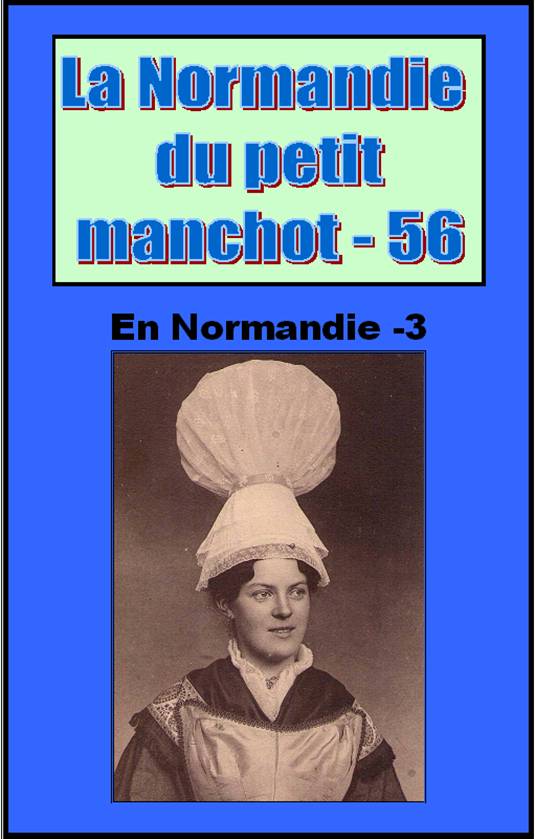 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 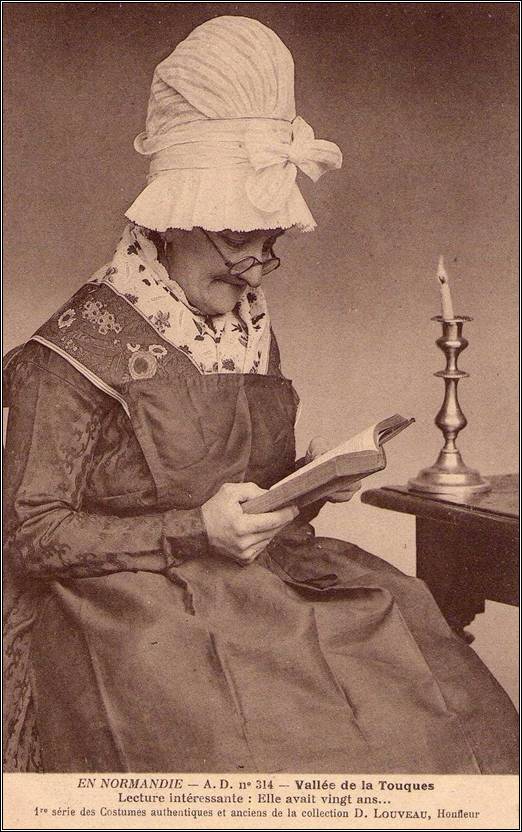 | |
|
| ||
|
| 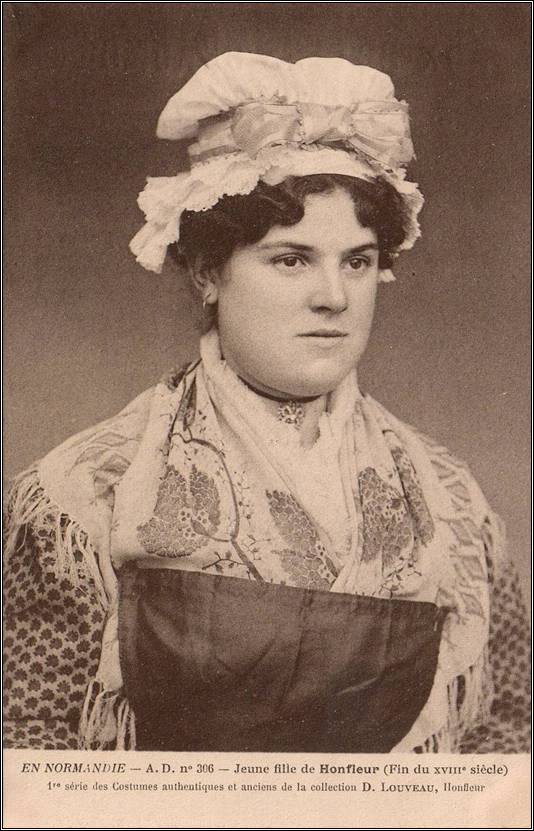 | |
|
| ||
|
|  | |
|
|
|
| ||
|
| 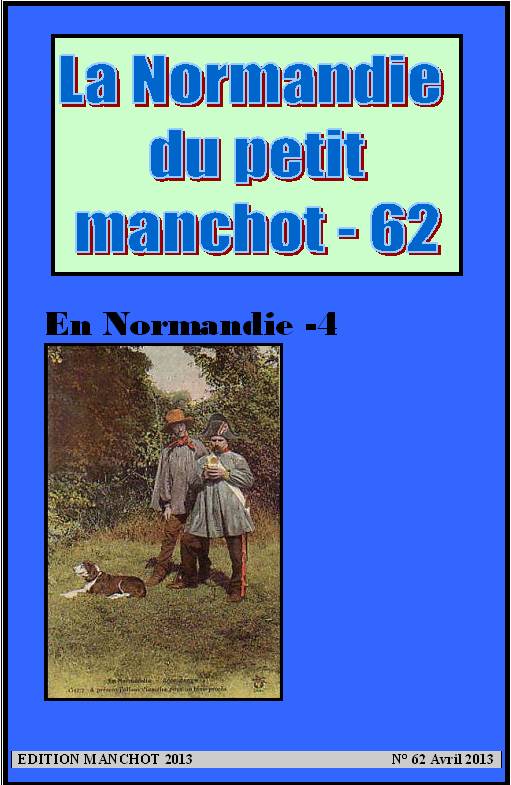 | |
|
| ||
|
| 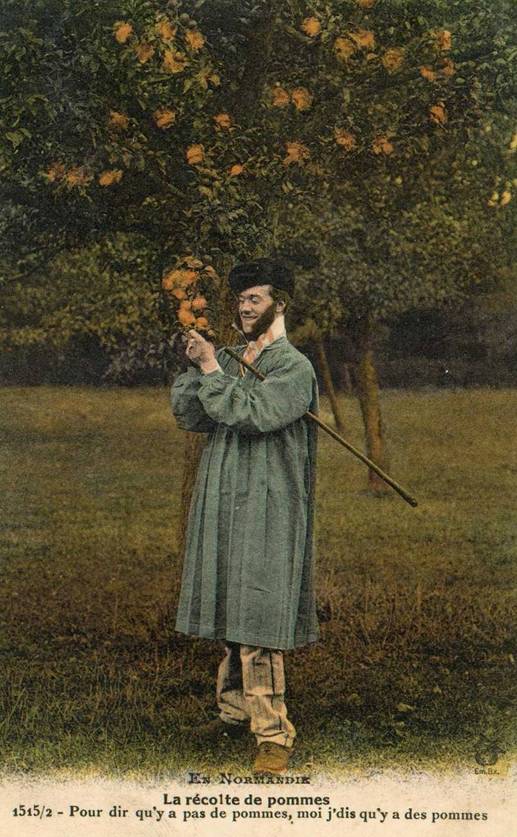 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 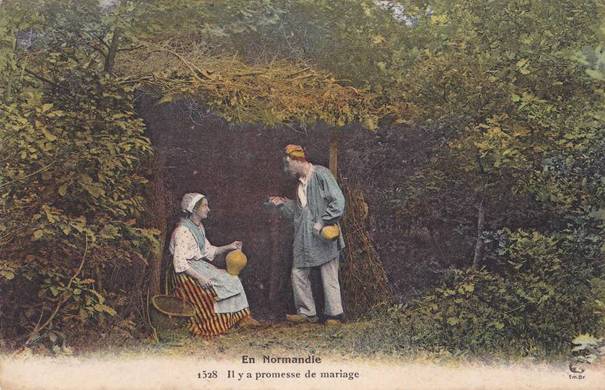 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 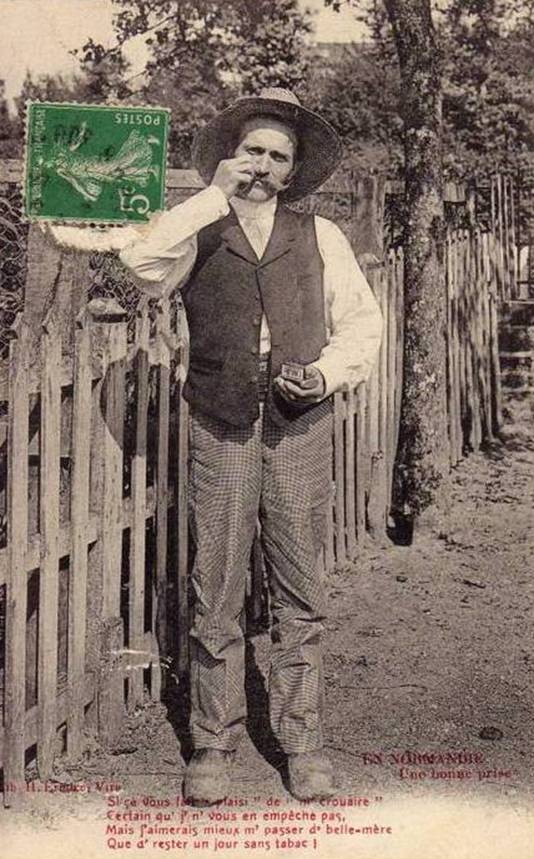 | |
|
| ||
|
| 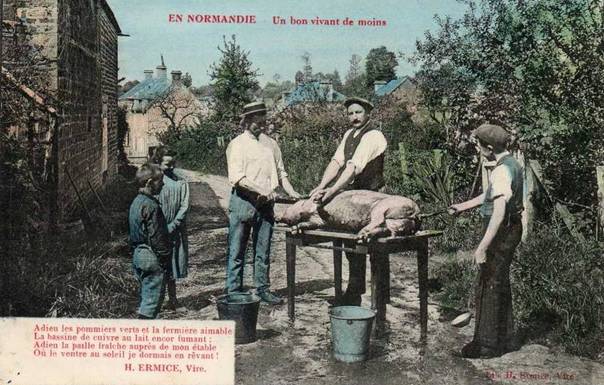 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 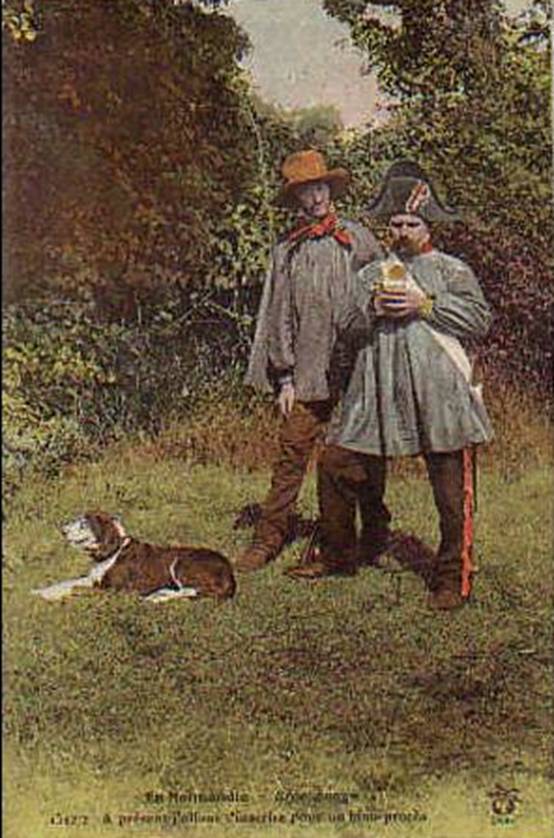 | |
|
| ||
|
|  | |
|
| ||
|
| 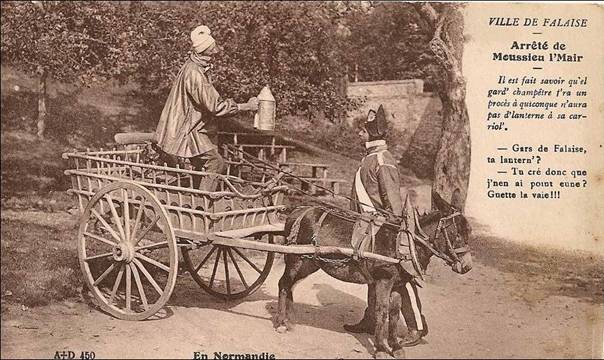 | |
|
| ||
 | ||
|
| ||
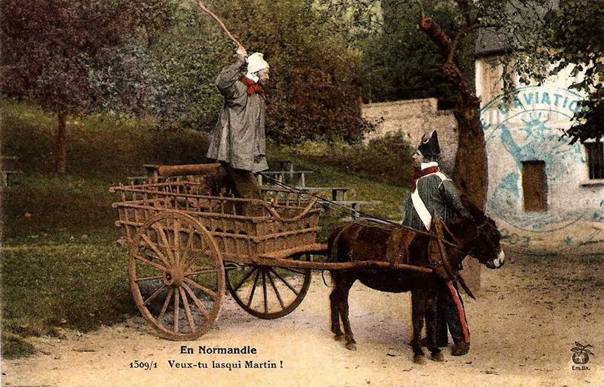 | ||
|
| ||
 | ||
|
|
|
 MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°69 Janvier 2014
| ||||
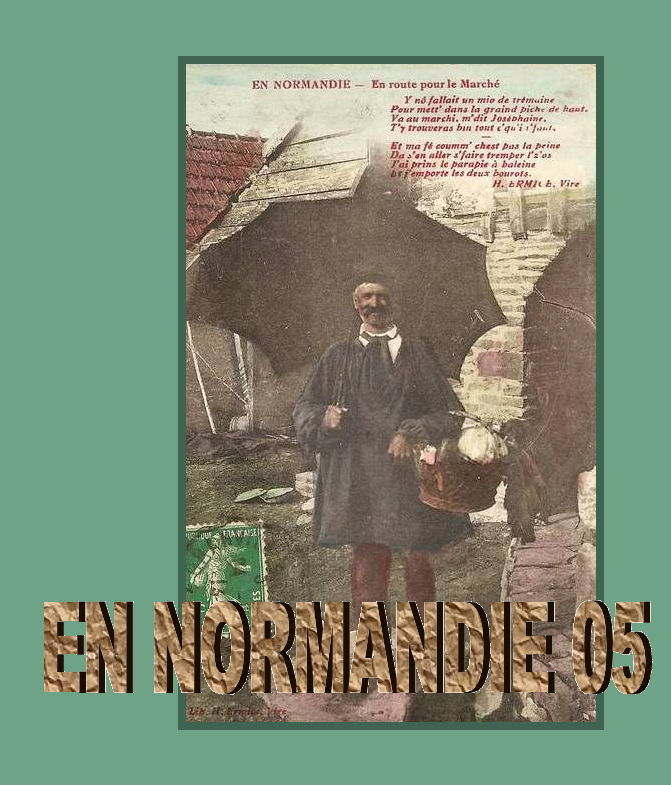 | ||||
|
|  | |||
|
|  | |||
|
|  | |||
|
|  | |||
| | ||||
|
|  | |||
|
| 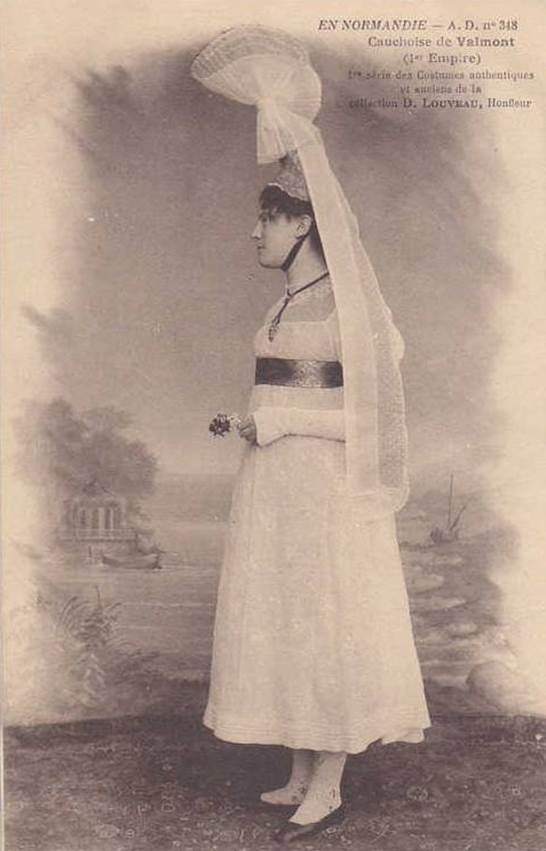 | |||
|
|  | |||
|
|  | |||
|
|  | |||
|
|  | |||
|
| ||||
|
| ||
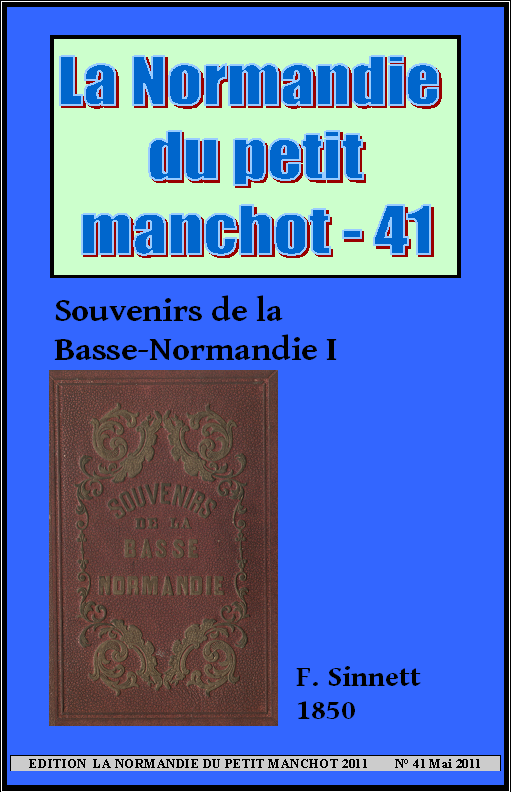 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
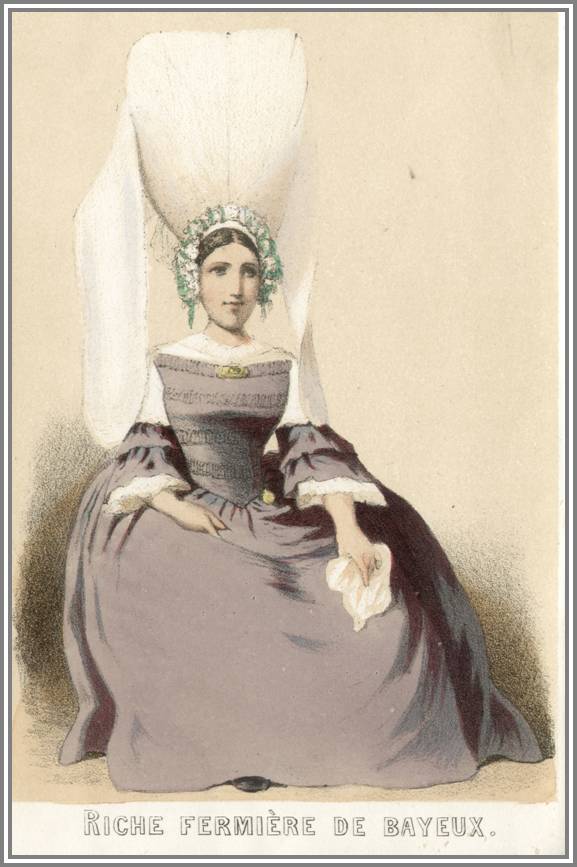 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
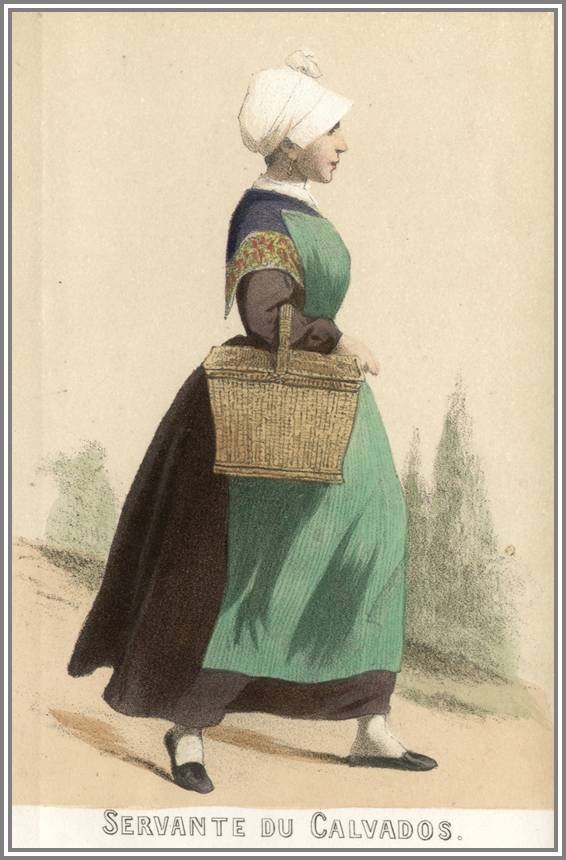 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
|
|
| ||
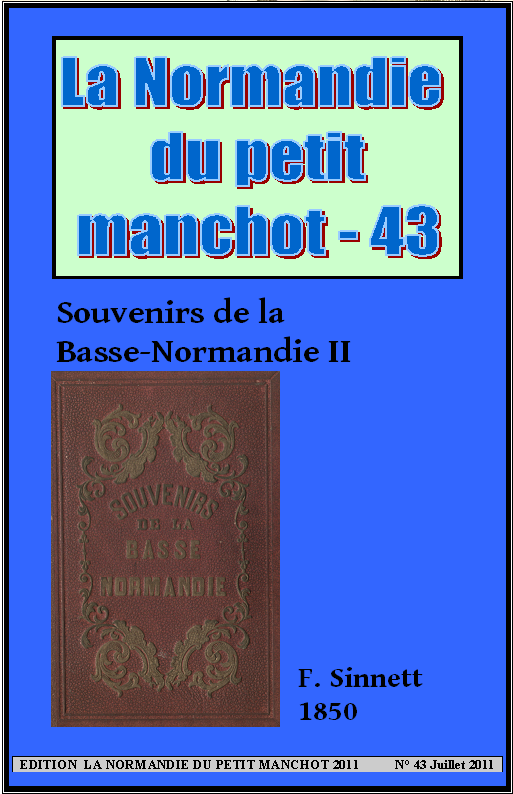 | ||
|
| ||
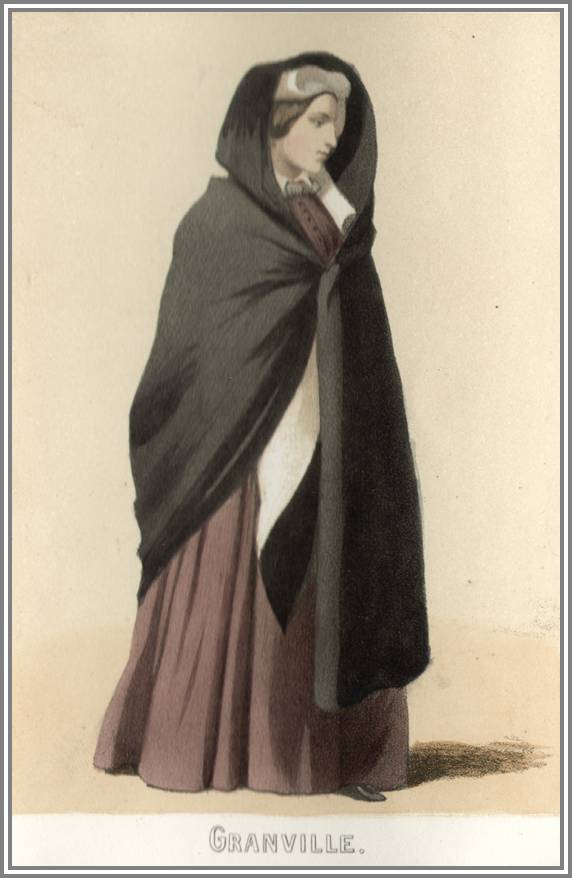 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
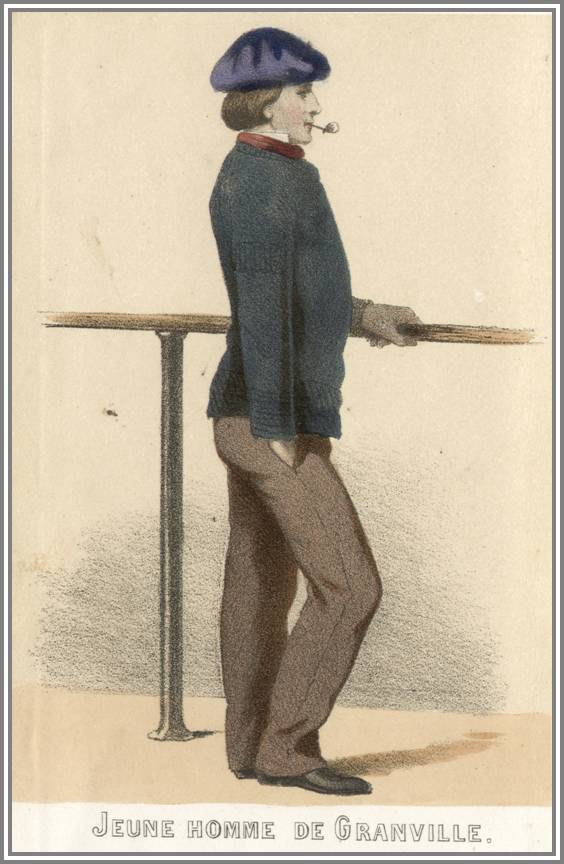 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
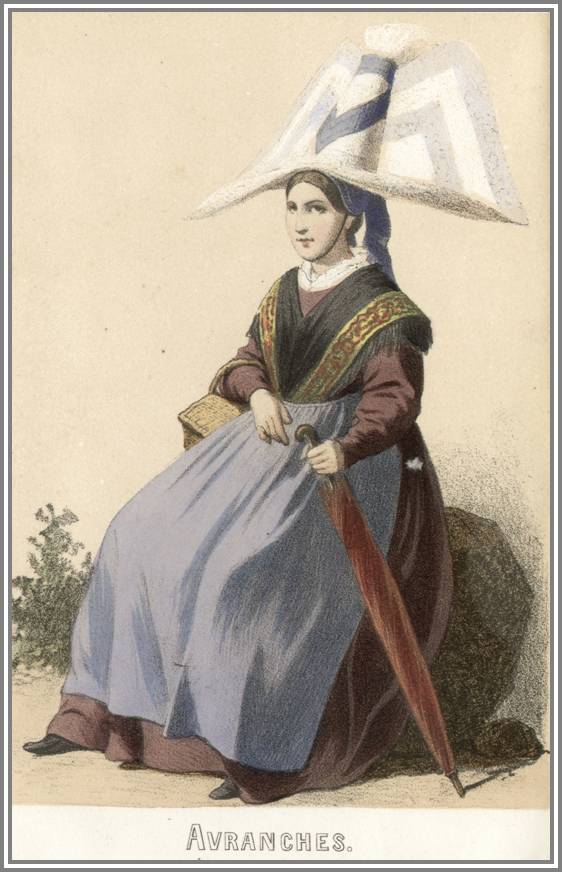 | ||
|
| ||
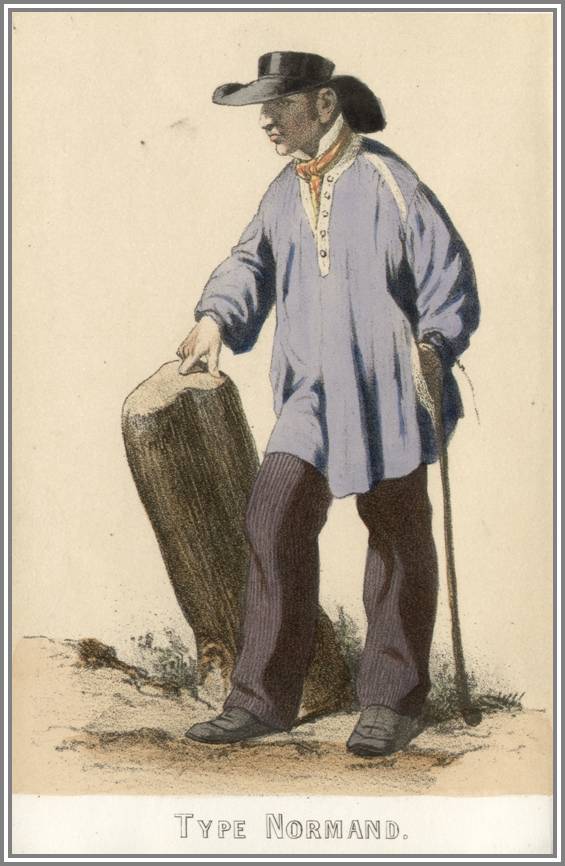 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
| ||
 | ||
|
|
| ||||||||||
| La Normandie des Plantagenêts
La mort inopinée du duc-roi en 1135 ramène le démon des querelles de succession car l’héritière désignée est une femme, Mathilde, la fille d’Henri Ier. Le royaume anglo-normand éclate. Mathilde, mariée au comte d'Anjou Geoffroi V d’Anjou dit Plantagenêt, ne parvient pas à dominer le duché de Normandie tandis que son cousin, Étienne de Blois, lui souffle la couronne d’Angleterre. Les barons normands profitent du conflit entre ces deux prétendants pour reprendre leur indépendance. L’anarchie dure jusqu’en 1144.
À cette date, Geoffroi V d’Anjou réussit à s’imposer comme duc de Normandie.
En 1150, il cède son duché à son fils Henri, beaucoup plus populaire, car il descend par sa mère Mathilde de Henri Ier Beauclerc.
En 1151, en plus du duché, le fils de Geoffroi et de Mathilde hérite des comtés de Touraine, du Maine et d’Anjou. | 
Le roi de France Louis VII | |||||||||
| Son ascension ne s’arrête pas là : un an plus tard, le nouveau duc épouse l’héritière du duché d'Aquitaine, Aliénor. Il a ainsi la main sur le sud-ouest français. Ensuite, l’infatigable duc Henri débarque en Angleterre et pousse le roi Étienne de Blois à un accord : ce dernier l’adopte et en fait l’héritier de la couronne. Henri II le remplace effectivement à sa mort en 1154. Il n’a alors que 21 ans.
Le roi de France Louis VII (1137-1180) qui voyait avec plaisir se déliter le royaume anglo-normand après la mort d’Henri Ier se rend compte qu’un ennemi gigantesque s’élève en face de lui. Non seulement, l’unité anglo-normande est refaite comme au temps d’Henri Ier mais cette fois, les possessions continentales ne se limitent pas à la Normandie. Elles vont jusqu’aux Pyrénées ! En 1156, le Plantagenêt rend hommage au roi de France pour ses fiefs continentaux. Ce geste n’a rien de contraignant pour Henri II. Il sait qu’il reste le seul maître de ses États. Louis VII de France est en effet incapable de bousculer l’extraordinaire puissance de celui que les contemporains qualifient de " plus grand monarque d’Occident ". | 
Henri II | |||||||||
| Nuançons tout de même la puissance d’Henri II. À territoire immense, problèmes et théâtres d’opérations nombreux. Au sud, offensive contre le comte de Toulouse, à l’ouest, installation d’un des fils d’Henri II, Geoffroy, comme duc de Bretagne ; au nord, combats contre les Écossais et les Irlandais ; à l’intérieur, querelles avec l’Église anglaise recherchant une certaine indépendance vis-à-vis du roi.
Dans cet ensemble, la Normandie joue le rôle de pivot du vaste empire Plantagenêt. C’est le lieu de passage principal pour le roi traversant la Manche, la liaison entre les deux parties de son Empire. La Normandie, c’est enfin l’enjeu du combat entre les Plantagenêts et le roi de France. Louis VII ne peut se résoudre à voir son domaine royal encerclé, les voies de la Seine et de la Loire contrôlées par son ennemi. Le roi de France exploite alors toutes les possibilités qui pourraient affaiblir Henri II. Louis VII de France, puis son fils Philippe Auguste (1180-1223), attisent notamment la rivalité entre Henri II et ses fils. Cette rivalité se transforme en révolte en 1173 mais le duc-roi parvient finalement à contraindre à la paix sa descendance.
En 1189, une nouvelle fronde des fils d’Henri II a raison du vieux roi. Deux jours avant sa mort, il cède ses couronnes à son fils aîné Richard, allié de Philippe Auguste. Mais leur ennemi commun mort, cette alliance n’a plus de raison d’être. | ||||||||||
| ||||||||||
| Depuis le XIXe siècle, plusieurs historiens normands se sont plu à vanter l’origine viking de la région. Ce récurrent renvoi au peuple scandinave a servi de support à la construction d’une identité normande quelque peu affaiblie. Mais la marque des Vikings fut-elle si importante sur le duché?
Dans la première moitié du XIe siècle, la Normandie offre l’image d’un pays francisé. L’empreinte viking apparaît somme toute assez limitée. Certaines pratiques témoignent d’une survivance des origines. Le duc Richard II a deux épouses : Judith épousée selon le rite chrétien et Papia, épousée à la mode danoise (more danico).
Il n’hésite pas à accueillir à Rouen même une flotte de pillards vikings. De même la filiation noble est rendue par l'adjonction du préfixe filz- / fitz- (« fils de ») au prénom du père, usage hérité de la pratique germanique (dans ce cas précis, scandinave) d'ajouter -son à la fin du nom du père pour nommer le fils. | 
Le duc Richard II | |||||||||
| Dans le domaine institutionnel, les nouveaux chefs de la Normandie moulent leur État sur l’organisation carolingienne. Ils s’autoproclament comte, parfois marquis ou duc. Autant de titulatures d’origine romaine ou franque. Le duc a des droits régaliens, dans la lignée des rois carolingiens : droit de battre monnaie, droit de haute justice, droit sur les forêts… L’ancien droit scandinave subsiste seulement à travers des éléments comme l'ullac (droit de bannissement) ou la hamfara (répression des assauts à main armée contre les maisons).
Les alliances matrimoniales contractées par les ducs au Xe et XIe siècles renforcent la thèse d’une coupure avec le milieu d’origine. Les maîtres de la Normandie n’épousent pas les filles ou les sœurs des rois danois ou norvégiens. Ils préfèrent prendre femme (du moins celles épousées selon le rite chrétien) auprès de leurs voisins : Bretagne, France, Flandre.
Quelle meilleure preuve d’acculturation que la perte de la langue d’origine, le norrois ? Le latin dans les actes écrits et le parler local l’emportent. Seul le vocabulaire marin et maritime emprunte beaucoup aux Vikings.
Du point de vue matériel, l’invasion scandinave donne l’impression de n’avoir presque rien bousculé : les archéologues cherchent en vain les traces d’un art viking ; même au niveau des types de céramique ou des objets produits. Les dédicaces de paroisses restent les mêmes. On ne connaît pas d’exemple de désertion de village à cette époque. Bref, il y a une continuité avec la Neustrie carolingienne.
Comment expliquer cette francisation ? La christianisation, condition incluse dans le traité de Saint-Clair-sur-Epte, n’est sûrement pas étrangère à ce phénomène. Elle a joué un rôle intégrateur indéniable quand on sait qu’au Moyen Âge l’essence de la culture, de la civilisation en Europe occidentale tient beaucoup au christianisme. Le faible nombre d’immigrants scandinaves en Normandie peut former une deuxième explication[16]. Mais c’est une hypothèse car nous n’avons pas d’estimation démographique. Certaines régions normandes (Pays de Caux, Roumois, Nord du Cotentin) affiche une forte densité de toponymes d’origine scandinave : les communes dont le nom se termine en -beuf / -bot (issu du mot norrois buth, bâtisse), en -bec (de bekkr, ruisseau), en -dal(le) (de dalr, vallée), en -lon(de) (de lundr, bois, forêt) et surtout en -tot (de topt, terrain d'habitation. On dénombre plus de 300 noms en -tot pour toute la Normandie) y sont particulièrement nombreux. Cette abondance pourrait laisser croire à une colonisation viking dense. Cependant, elle s'explique plutôt par l'afflux de colons d'origines diverses, fermiers originaires des îles britanniques et d'Irlande pour beaucoup et qui n'avaient plus grand lien avec leur passé viking. Ils pouvaient être danois, norvégiens, anglo-scandinaves, anglo-saxons, voire celtes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ce qui d'une part explique la forte densité des toponymes anglo-scandinaves et d'autre part l'absence de découvertes archéologiques proprement « viking ». | ||||||||||
| L’ouverture du duché à des influences autres que scandinaves ne laisse pas de doute. L’élite religieuse appartient à l’extérieur. Les invasions vikings avaient fait fuir presque tous les moines de Normandie. Les premiers ducs font appel à des abbés et à des communautés étrangères pour relever les abbayes normandes abandonnées. Richard II réussit à accueillir dans son État l’Italien Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, pour restaurer le monastère de Fécamp. Quant à l’aristocratie laïque, l’apport extérieur est moins évident. Sauf exception, comme les Tosny, les Bellême ou la famille Giroie, les plus grands aristocrates descendent des compagnons de Rollon ou directement du duc. Par contre, au niveau subalterne, l’origine de la noblesse normande est plus hétéroclite : Bretagne, Île-de-France, Anjou. |  Vitrail du traité de Saint-Clair-sur-Epte | |||||||||
|
| ||||||||||
| En somme, le particularisme viking du duché semble rapidement s’évanouir. Au début du XIe siècle, un siècle après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la Normandie est une principauté francisée. Les regards normands ne se tournent plus vers la terre de leur ancêtres. | ||||||||||
|
||||||||||
 |
||||||||||
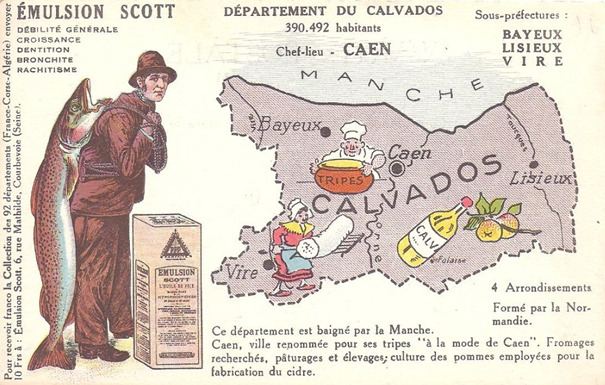 |
||||||||||
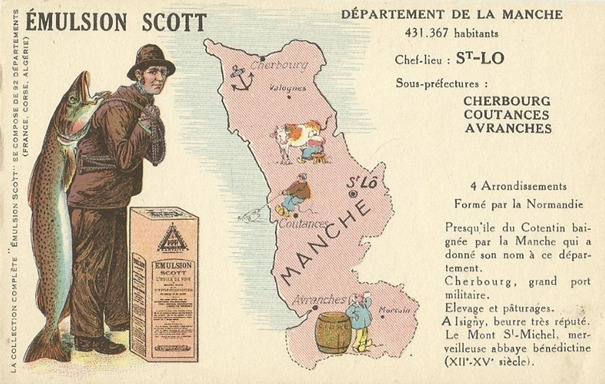 |
||||||||||
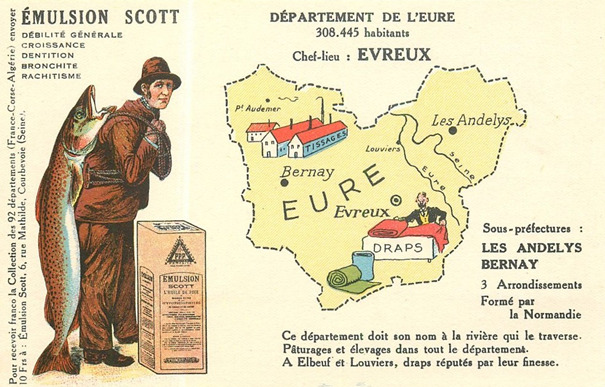 |
||||||||||
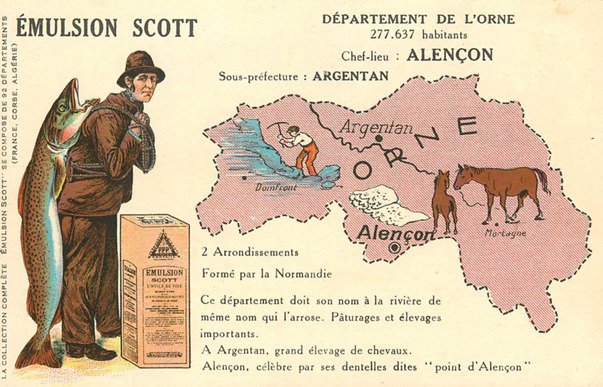 |
||||||||||
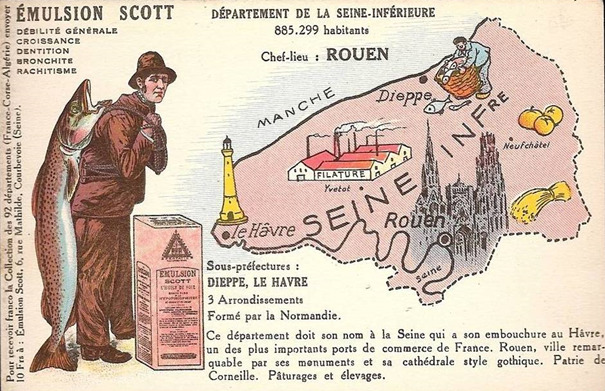 |
||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
| Normandie (Rouen) : Duché carolingien de Normandie créé en 911 pour Rollon (DR: 1204). Avait pour fiefs la Petite Bretagne, puis la Grande Bretagne après 1066.
- Les deux régions administratives, sous souveraineté française, de Haute-Normandie et de Basse-Normandie - Le duché de Normandie, composé des bailliages de Jersey et de Guernesey, sur lequel les monarques de Grande-Bretagne exercent la souveraineté sous le titre de « duc de Normandie ». | ||||||||||
| Histoire
Historiquement, la Normandie était un ancien duché du royaume de France, qui comprenait une partie continentale, devenue par la suite province de France, et une partie insulaire (Îles Anglo-Normandes), qui demeure possession du roi d’Angleterre, et est encore aujourd’hui dépendance de la couronne britannique. Fondé en Neustrie par Rollon, le duché occupa tout d’abord la basse vallée de la Seine en 911, puis Le Mans et Bayeux en 924, le Cotentin, l’Avranchin et les îles de la Manche en 933. Duché de 911 à 1204, la partie insulaire (Anglo-normande) de la Normandie, hormis Chausey, a formé les bailliages de Jersey et de Guernesey tandis que sa partie continentale française) a formé une province historique française de 1204 à 1790. | 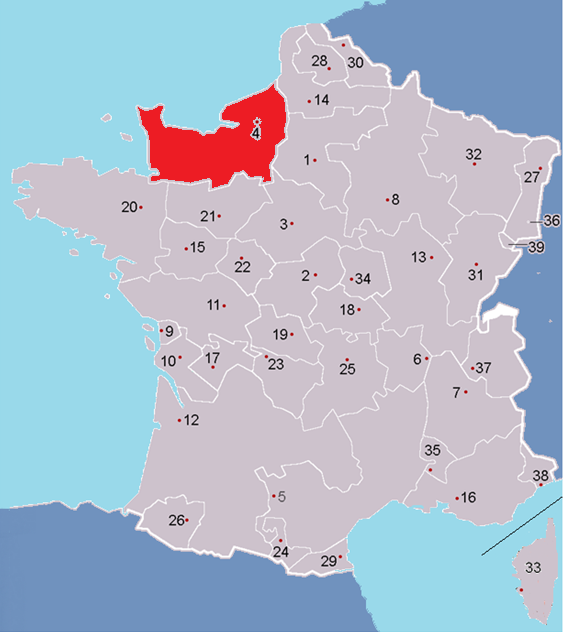 | |||||||||
| Très stables, les frontières continentales de cette ancienne province concordent assez fidèlement, hormis quelques territoires incorporés aux actuelles Eure-et-Loir, Mayenne, Oise et Sarthe lors de la création des généralités et quelques communes enclavées échangées avec la Mayenne après la création des départements à la Révolution, avec le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Inférieure.
Blason de la Normandie
L’écu rouge à deux léopards jaunes tournant la tête de face, blasonné de gueules à deux léopards d’or l’un sur l’autre est l’emblème héraldique de la Normandie continentale. |  «Carte de la Normandie» par Oie blanche | |||||||||
| Dans les îles Anglo-Normandes, les deux bailliages de Jersey et de Guernesey qui constituent la Normandie insulaire portent un blason à trois léopards, comme celui de Richard Ier d’Angleterre, dit plus tard Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie. Lequel des deux blasons est le plus ancien demeure un sujet de polémique et de recherche historique pour certains.
Henri II Plantagenêt aurait porté comme comte d’Anjou un long bouclier bleu chargé sans doute de 8 lionceaux d’or (comme on peut encore l’admirer au Mans sur la plaque funéraire de son père Geoffroy Plantagenêt) puis les aurait réduits à deux lions, la taille des boucliers s’étant raccourcie. Le premier sceau de son troisième fils Richard Cœur de Lion ainsi que des témoignages contemporains attestent qu’il fit d’abord usage d’un écu à un seul lion. De retour en Angleterre en 1194, il adopta un nouveau sceau à trois lions/léopards posés l’un sur l’autre. L’une des hypothèses discutable, est que Richard aurait introduit le troisième léopard tiré du blason de sa mère Aliénor d'Aquitaine. |  | |||||||||
| Les ducs d’Aquitaine n’ayant qu’un seul léopard. Mais il est fort probable qu'il y ait plutôt adjoint celui du sceau de la ville de Rouen (Créé au XIème s. à partir du Hrifsklímsli: "monstre agrippeur", le léopard était partie intégrante du sceau de la ville au début du XIIème siècle), pour remercier les Normands, d'avoir aider à verser sa rançon (ce que les possessions des Plantagenet en France avaient refusé de faire). Toutefois, on ne connaît pas de représentation héraldique à deux léopards avant Richard autre que l’écu de son frère Jean sans Terre comme comte de Mortain avant son accession au trône,ce qui tendrait à accréditer le fait que ce blason à 2 léopards était l’écu héraldique originel de la ville de Mortain (le blason actuel aux fleurs de lys étant une création française issue de l’écu de la branche capétienne donc française d’Evreux-Navarre). Lorsque la Normandie continentale est passée sous contrôle français, Philippe Auguste a importé l’héraldique royale, tandis que le duché de Normandie insulaire (îles Anglo-Normandes) a conservé le blason à trois léopards, emblème familial que les Plantagenêts n’avaient pas de raison de modifier.
Parmi les ducs de Normandie issus des Capétiens, Jean le Bon porta les armes des Valois (de France ancien à la bordure de gueules), et son fils Charles, duc de Normandie et dauphin de Viennois porta un écartelé de Valois et de Viennois. Au XIVe siècle, les armoriaux présentent déjà l’écu à deux léopards d’or pour la Normandie. Mais il a fallu attendre 1465 pour voir officiellement apparaître les deux léopards dans les armes d’un duc de Normandie, avec Charles de France, jusqu’en 1466. Nanti du titre de duc de Normandie de 1785 à 1789, le fils de Louis XVI a, quant à lui, porté un écartelé de France et de Normandie à deux léopards. Notons que Robert d’Alençon, comte du Perche (+1371) semble avoir parti ses armes d’Alençon ancien brisé d’un châtelet et de Normandie à deux léopards. |
Blason de la Normandie traditionnel en France
Les treis cats | |||||||||
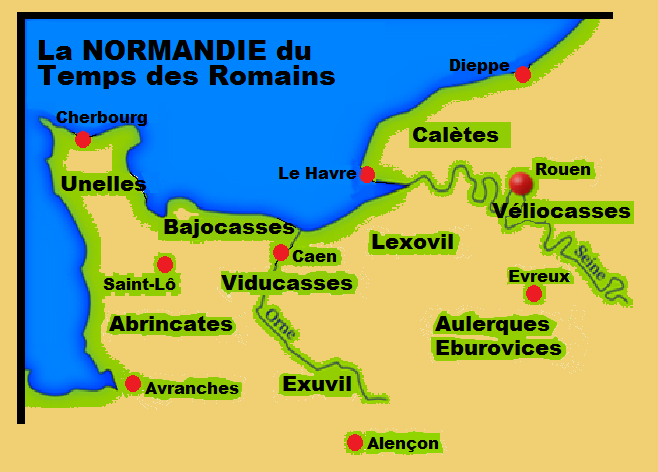 | ||||
| Histoire-Normandie.fr Site fondé, par Laurent Ridel Historien de formation. postmaster@histoire-normandie.fr
Lorsqu’il entreprend la conquête de la Gaule, César décrit les différents peuples qui la composent. Il s’agit surtout de Celtes qui sont installés dans le pays probablement depuis 475 avant J.-C. Même si leur culture est assez homogène, ils se différencient politiquement. La future Normandie est notamment partagée entre neuf tribus. Leurs relations ne sont pas toujours pacifiques : en témoigne l’existence de sites fortifiés, les oppida.
Cette division profite à César dont les légions écrasent en 56 avant J.-C. une rébellion menée par le chef des Unelles Viridovix. Quelques années plus tard, Vercingétorix parvient à fédérer une partie des Gaulois. Plus de 10 000 Unelles, Calètes, Véliocasses, Lexoviens et Aulerques Eburovices partent ainsi à son secours quand il est piégé dans Alésia. C’est un échec. En 51 avant J.-C., la Gaule est définitivement soumise. |  Guerriers Gaulois, CPA collection LPM | |||
| La Gaule soumise, une période de 300 ans de paix s’ouvre pour elle. La romanisation transfigure la région. On construit les premières villes : Rotomagus (qui deviendra Rouen), Augustodurum (la future Bayeux), Juliabona (Lillebonne), Noviomagus (Lisieux), Aregenua (Vieux, près de Caen), Mediolanum (Evreux), Legedia (Avranches)… Ce sont les capitales de cité qui servent de relais à l’administration romaine. Leur organisation politique se calque sur Rome.
Se développe aussi tout un réseau d’agglomérations secondaires devenues aujourd’hui de petites villes : Breviodurum (Brionne), Caracotinum (Harfleur), Augusta (Eu) … Les empereurs puis les notables gallo-romains dotent ces premiers foyers urbains d’une parure monumentale : théâtres, thermes, amphithéâtres, temples… De longues routes rectilignes (les fameuses voies romaines) relient les grands carrefours.
L’empreinte romaine s’étend jusqu’aux campagnes. Les grandes propriétaires terriens vivent dans des villas cossues. A l’intérieur, des pièces ornées de marbres, de mosaïques ou de panneaux peints, sont parfois chauffées sur hypocauste (villas de la Petite Houssaye dans la forêt de Brotonne, de Vieux-Rouen-sur-Bresle, de Saint-Aubin-sur-Mer…). De grands sanctuaires tels que ceux du Vieil-Evreux (Eure) et de Berthouville (Eure) attestent de l’acculturation romaine jusque dans le domaine religieux.
La décomposition de l’Empire Romain
Cependant, la paix assurée par les Romains s’effondre dès la seconde moitié du IIIe siècle. Les peuples germaniques pressent aux portes de l’Empire. Des Francs, des Alamans, des Saxons pénètrent en Normandie par voie terrestre ou par les côtes de la Manche. Les archéologues retrouvent aujourd’hui dans la stratigraphie des sites antiques un horizon de terre noire qui traduit la violence des incendies. Des villas tombent à l’abandon. L’insécurité devient permanente.
Les Romains réagissent en resserrant le découpage provincial. Rouen est ainsi mise à la tête d’une province (la IIe Lyonnaise) dont l’extension préfigure celle de la future Normandie. Le litus saxonicum, une organisation de défense des côtes de la Manche, est mise en place contre les incursions des pirates. Pour repeupler le territoire, Rome accorde le droit à certains envahisseurs germaniques de s’installer. L’armée romaine elle-même incorpore des Barbares. Face aux invasions répétées, les villes s’abritent derrière des remparts. À la même époque, le christianisme se répand parmi la population gallo-romaine. Rouen figure parmi les premières villes du nord de la Gaule à avoir un évêque.
Après plusieurs vagues d’invasions, les Francs du roi Clovis deviennent maîtres du nord de la Gaule (dont la future Normandie) vers 486.
 Guerriers Gaulois, CPA collection LPM | ||||
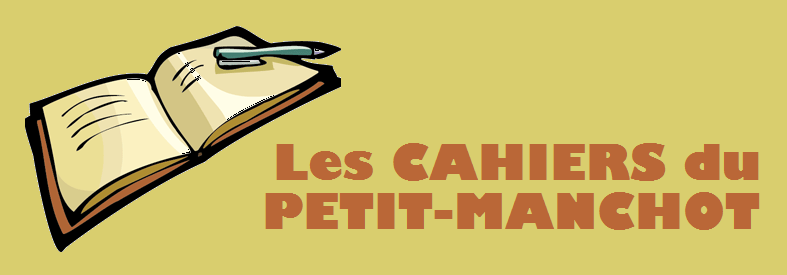 |
||||
|
L'ETENDARD DE NORMANDIE
Par Georges Dubosc La Normandie Illustrée Juillet 1927
Il est question d'arborer à nouveau, à propos des fêtes en l'honneur de Guillaume le Conquérant, le rouge étendard de Normandie, qui fut la parure flamboyante du Millénaire de Normandie en 1911. Il nous souvient qu'un jour, quelque temps avant ces belles fêtes rouennaises, l'original marquis de la Rochethulon, président du Souvenir normand, demandait à Jean Revel étonné où il pourrait se procurer un bel étendard normand !... |
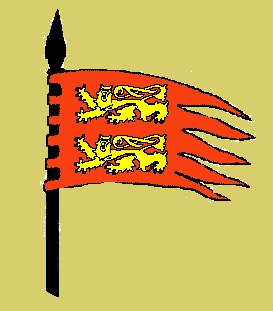 |
|||
|
« Allez aux Nouvelles Galeries, lui dit-il en désespoir de cause ! » Le marquis s'y rendit et commanda un immense étendard, la « bannière aux deux lions », comme dit Gaston le Révérend, et l'arbora au balcon de son hôtel. En même temps, les Nouvelles Galeries mirent en vente de nombreux étendards, en forme de pennons trifides, qui partout flottèrent sur nos maisons et nos monuments. Cil porta gonfanon d'en drap vermeil d'Espagne
Le léopard, au contraire, est toujours figuré passant, c'est-à-dire avec la tête de face, marchant horizontalement, la queue levée mais se recourbant au dehors. Il est vrai qu'il y a, même avec le blason, des accommodements et qu'on vit des lions léopardisés ou encore des léopards lionnés. On inventa aussi au seizième siècle de figurer, au dire de Vulson de la Colombière et de Gilbert de Varennes, en azur la langue et les ongles des léopards normands. |
||||
|
Souvent, on s'est demandé pourquoi deux léopards seulement figuraient dans les armoiries ducales normandes, tandis qu'il y en est représenté trois dans les armoiries anglaises. Il semble que le léopard de... supplément soit tout simplement l'emblème héraldique de la province française de Guyenne, qui se rattacha longtemps à la couronne d'Angleterre. Sur le tombeau de la reine Eléonore d'Aquitaine, figure l'écu de son mari Henri II, à deux léopards d'or « qui est Normandie » et celui d'Eléonore à un seul léopard d'or « qui est Guyenne ».
Est-il besoin d'ajouter que lorsque la Normandie revint à la couronne de France, l'emblème des anciens ducs disparut pour faire place aux fleurs de lys de France ?
Cependant, nombre de villes normandes, en souvenir du blason provincial, conservèrent le léopard d'or sur ce champ de gueules flamboyant qui fut toujours la véritable couleur normande. |
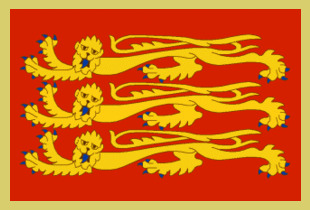 |
|||
|
Armoiries Anglaises |
||||
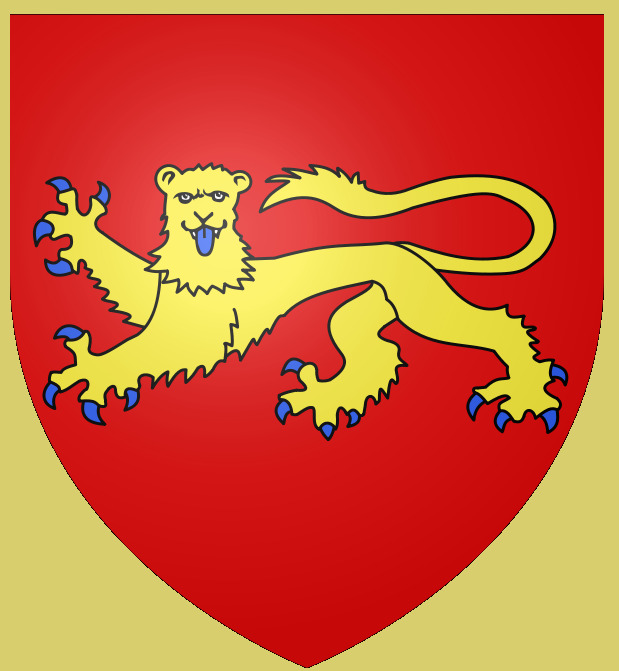 |
||||
|
Armoiries de Guyenne |
||||
|
On les retrouve aussi sur une foule de sceaux de vicomtés, à Caen, à Bayeux, à Falaise ; à Caen, sur le sceau de la Faculté des Sciences ; on les retrouve même ailleurs que dans la province, parmi les quatre écussons placés au côté de la Vierge, sur le sceau de la Faculté des Arts de l'Université de Paris en 1513, où se trouvent les armes de la nation normande. Georges DUBOSC |
||||
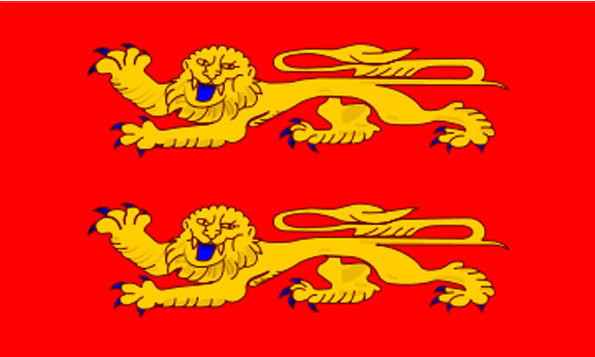 |
||||
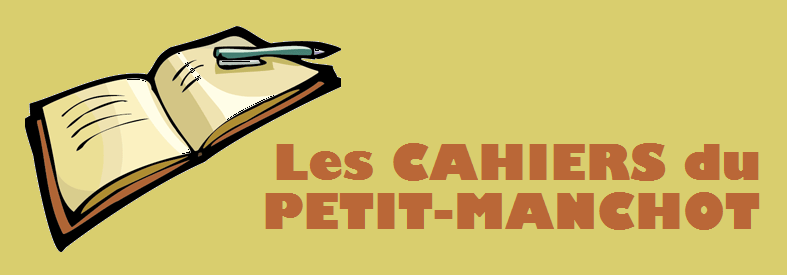 |
||||
|
VIVRE EN NORMANDIE |
||||
|
Le bonnet de coton en Normandie Par Georges Dubosc 1851
Pendant longtemps, le « bonnet de coton » fut la coiffure nationale des Normands, hommes et femmes.
Il est disparu peu à peu, remplacer par la haute casquette de soie que portaient les maquignons, les marchands de bestiaux bas-normands, puis de nos jours par les casquettes de drap plates, de genre anglais. Mais il est encore des coins de campagne du Bocage, où les femmes surtout portent encore le « casque à mèche » qui couronnait jadis le Roy d’Yvetot et aussi souvent Jeanneton elle-même.
A vraiment dire, si on recherche les origines du « bonnet de coton » on s’aperçoit qu’il en a toujours existé, mais un peu à l’état d’exception, car le coton était rare et peu connu. |
 CPA Collection LPM 1900 |
|||
|
Joinville dit cependant dans sa chronique que saint Louis « avait vestu un chapel de coton sur sa tête ». Mais ces chapels ou bonnets de coton, au lieu de dresser leur pointe en l’air, étaient taillés en forme de béguins tricotés et noués sous le cou, que recouvrait ensuite un chaperon de feutre
On trouve mille exemple de ce mode de coiffure dans les gravures de la Monarchie française de Monfaucon, car ce « bonnet de coton » primitif dura pendant deux siècles environ, sous le roi Jean-le-Bon et sous son fils Charles V. Un moment il fut remplacé par un bonnet de laine, la bizette, que fabriquaient les Bonnetiers-Aumussiers, qui avait la forme pointue des « bonnets de coton », son extrémité ordinairement terminée en fond de sac, retombait sur un des côtés ou sur le devant de la tête. C’était la coiffure préférée de Jean-sans-Peur et c’est elle qu’il porte dans toutes les miniatures où il est représenté. Au XIIIe siècle, le « bonnet de coton » existe encore et l’excellent Glossaire archéologique de Gay en représente un qui est tout semblable aux modèles classiques d’aujourd’hui.
Ce ne sont là, à tout prendre, que des exceptions, variant un peu d’un siècle à l’autre. Mais ce qui est curieux et bizarre, c’est l’adoption pendant longtemps d’une coiffure par toute une région, sa diffusion générale en un seul pays où toutes les têtes ont coiffé le même bonnet. Quelques érudits ont même posé la question de savoir quelle fut l’ère géographique du « bonnet de coton », qui se répandit un moment sur les confins de la Picardie, notamment dans le Sancerre.
A quelle époque commença donc la grande vogue du bonnet de coton ? A la fin du XVIIe siècle, mais c’est alors une coiffure bourgeoise, une coiffure de nuit, une coiffure souvent individuelle. |
||||
|
Les bons bourgeois qui en usent la recouvrent souvent d’une enveloppe de toile qu’ils nouent et parent d’un noeud de ruban de couleurs comme Argan, dans le Malade Imaginaire. Que de peintres, que d’artistes sont ainsi représentés dans leurs intérieurs, auprès de leur chevalet, dans leur intimité, tandis que la perruque poudrée de cérémonie attend sur un « pied » où elle est posée ! Il est un délicieux tableau de Lancret, qu’on appelle Les Bonnets de coton, où s’ébat toute une compagnie de joyeux viveurs, coiffés tous du « casque à mèche », réunis sous les grands arbres d’un parc ou étendus sur l’herbe autour d’une table somptueusement servie. Le « bonnet de coton » est évidemment dans cette toile, qui a appartenu jadis au duc d’Aumale, un symbole de vie joyeuse et aimable, le caprice et la fantaisie de quelques aimables compères. Cependant le «bonnet de coton» ou le « bonnet de laine » se répandit bientôt parmi les artisans et devint une coiffure commode et facile, tenant bien à la tête pour les nombreux artisans des corps de métier. |
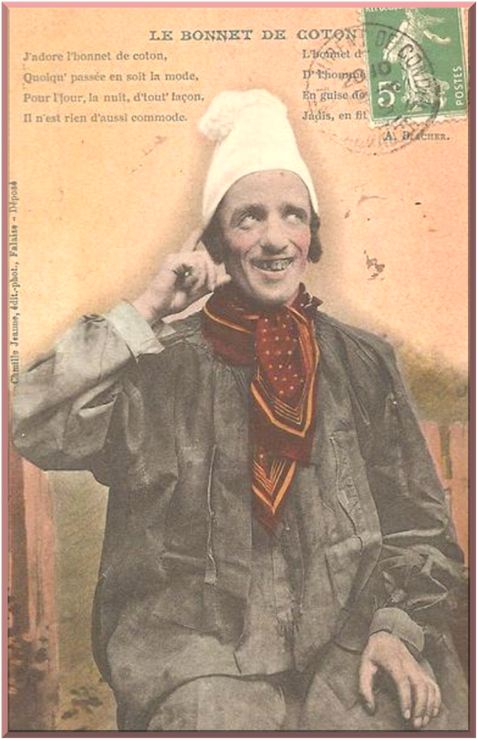 CPA Collection LPM 1900 |
|||
|
Il n’y a qu’à regarder les planches fines et bien gravées de l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, pour voir que tout un peuple d’artisans, occupé à mille métiers divers et variés, attentifs à leur besogne, portent le « bonnet de coton », qu’ils placent sur leur tête de façons très différentes. C’est par eux qu’il s’était perpétué dans quelques corporations, qui en usèrent longtemps : les marmitons, les aides de cuisine, qui portent le bonnet de coton, renversé en arrière ; les geindres ou aides des boulangers ; les peintres en bâtiment, qui sur leurs échafaudages volants, lorsqu’ils badigeonnaient en plein air, aimaient cette coiffure solide ; les déménageurs qui arborent encore un court bonnet de couleur, rayé de bleu ou de rouge, qui les préserve de la poussière.
Les paysans normands devaient à leur tour, vers le milieu du XVIIIe siècle, adopter le «bonnet de coton», imitant ainsi les matelots et les marins, qui avant de se coiffer du « béret » basque, usaient du bonnet de laine. Pour l’homme travaillant aux champs, bravant les intempéries, les vents, les ouragans, c’est une coiffure adhérente qu’on peut doubler, serrant bien la tête, couvrant les oreilles et les préservant contre la froidure. |
 CPA Collection LPM 1900 |
|||
|
Un seul défaut : elle ne préservait pas de la pluie, mais les paysans en usaient comme les artisans du moyen-âge et leur bonnet de coton était recouvert par un chapeau de feutre. Jugez-en, par exemple, par les jeunes charretiers qui figurent dans la louée aux domestiques du premier acte des Cloches de Corneville, qui font très bien revivre ces modes d’autrefois.
Jugez-en par les dessins, les croquis, les aquarelles de Bonington ou des peintres de 1820 à 1840, ayant représenté en cet équipage,les rouliers, les charretiers, les anciens porteux du pays de Caux, qui amenaient aux Halles de Rouen, les tissus, les cotonnades, les rouenneries, les siamoises des tisserands à la main. Tous ces artisans portent, sous leur feutre, le « bonnet de coton » normand.
A un moment donné sous le premier Empire, par exemple, le «bonnet de coton» fut en une telle faveur que les Normandes l’accueillirent aussi avec plaisir, bien qu’à première vue, cette coiffure blanche ne parût pas très seyante.
C’était pour elles toutefois une coiffure simple, peu coûteuse, d’un ajustement sans apprêt, fort rapide.
Et puis le « bonnet de coton » était une coiffure de travail.
Cela n’interdisait pas le port des belles coiffes aux ailes de dentelles, les bonnets cauchois, les gracieux bavolets, les calipettes, et les jolies bonnettes bayeusaines du dimanche.
A un moment donné, le «bonnet de coton» que la coquetterie féminine trouvait moyen d’enjoliver, fut tellement à la mode, que les femmes, le portèrent… même à l’église. Le clergé s’éleva contre cette négligence dans la tenue et fulmina contre le « bonnet de coton », qualifié de « coiffure abominable. »
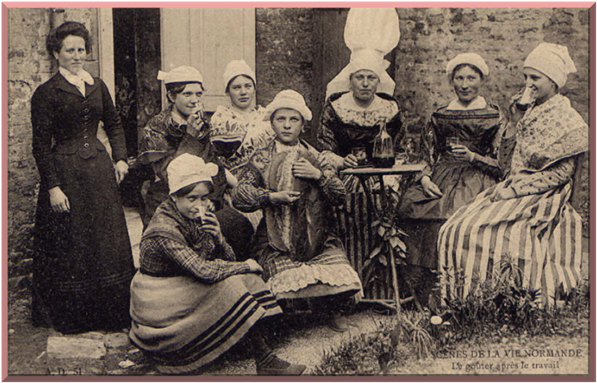 Scénes de la vie normande, CPA collection LPM 1900
Aussi bien en ce temps, il y eut en Normandie deux partis :
l’un « antibonnet de coton » et l’autre « probonnet de coton » ! Galleron, qui a écrit plusieurs volumes sur Falaise et son arrondissement, n’a pas craint d’écrire :
« La coiffure des femmes du peuple est ce qui frappe le plus l’étranger qui s’arrête dans cette ville. Il voit le bonnet de coton sur presque toutes les têtes ; tantôt sale et retenant des cheveux mal peignés qui s’échappent de différents côtés, tantôt recouvert d’une coiffe à barbes plates assez mal plissées, qui s’étendent des deux côtés de la figure. Il faut que les femmes aient bien peu d’amour-propre pour conserver cette mode qui leur ôte toute grâce. Une Vénus en « bonnet de coton » aurait de la peine à se faire regarder. Cette coiffure donne d’ailleurs à un visage féminin quelque chose d’effronté, qui en dégoûte involontairement. Il y a des femmes qui vont jusqu’à en porter de bruns ou d’écrus. Il est impossible de rendre l’impression désagréable que l’on éprouve à cette vue. » |
||||
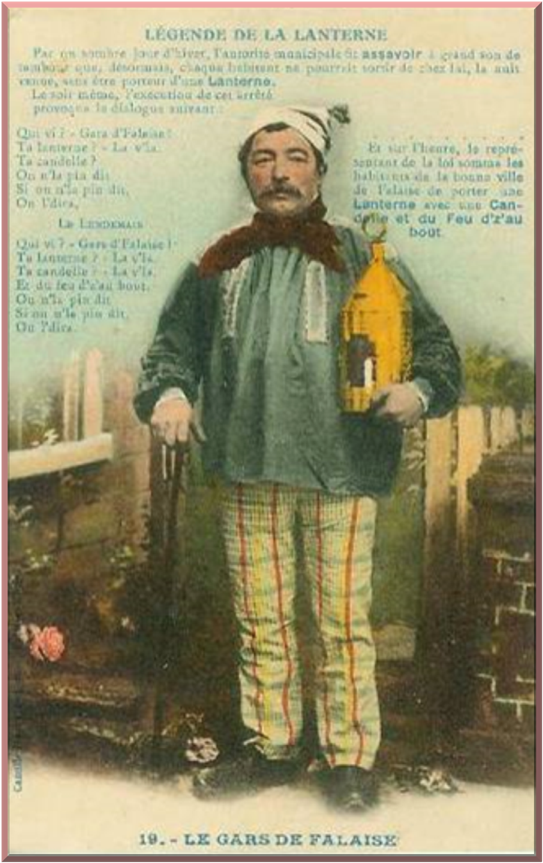 |
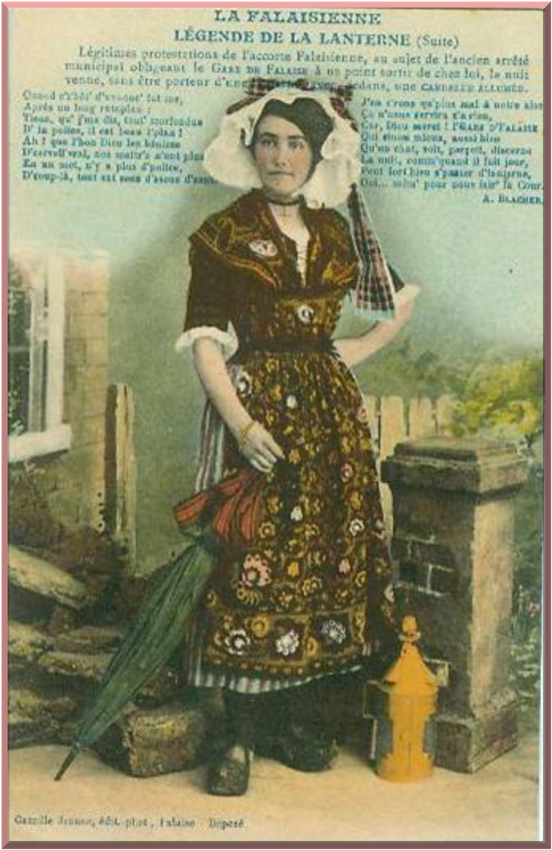 |
|||
|
Tout le monde n’a pas partagé cet avis. La Normande, au temps de la grande vogue du « bonnet de coton », avait su varier les manières de le porter, incliné à droite, ou à gauche, dressant sa mèche en avant, ou la laissant flotter en arrière enfoncé comme un polo de tennis ou découvrant des bandeaux noirs et des accroches-coeur séduisants. Mlle Amélie Bosquet qui était femme et avait bien voix au chapitre n’était pas du tout de la même opinion que le sévère Galleron :
|
||||
|
Le reste était fourni par Rouen et Condé-sur-Noireau. Vers 1820, écrivait Galleron, il y avait 3000 métiers à faire des « bonnets de coton » sans compter quelques métiers particuliers appartenant à de petits façonniers jaloux de conserver leur indépendance. On fabriquait alors 2.380.000 bonnets par an, sans compter les « bonnets de coton » bleus et les bonnets écrus. Alors plus de 1.700 personnes, femmes et enfants, étaient employées au dévidage des fils, au raccommodage et au cousage.
Les « bonnets de coton » étaient fabriqués à deux, trois, quatre ou cinq fils, les prix variant selon la qualité du coton ou le nombre des fils employés. Il est curieux de voir quel était le bas prix de la main-d’oeuvre employée : les journées d’ouvrier bonnetier les plus fortes étaient de 2 fr. et en moyenne de 1 fr. Les petits enfants, employés eux aussi à cette fabrication, recevaient un salaire quotidien de 30 à 40 centimes. Ils en fabriquaient 10 à 15 par jour, tandis que les bonnetiers ordinaires en faisaient une trentaine. |
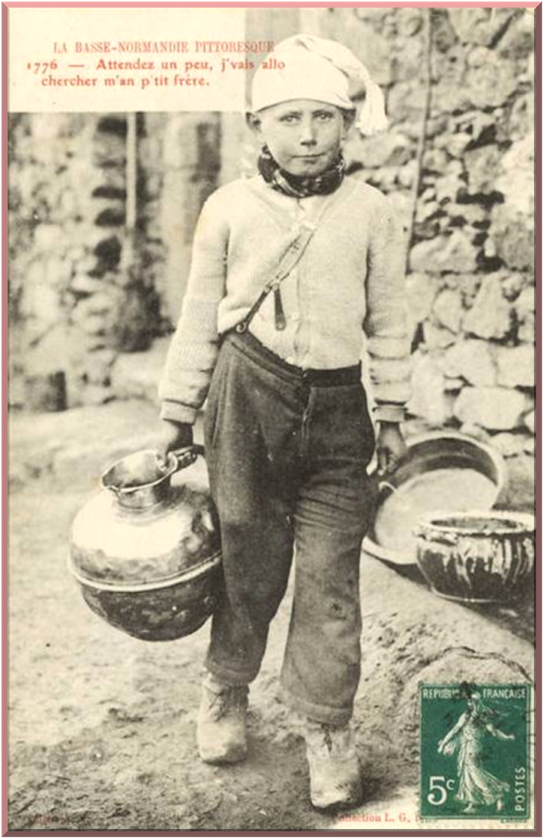 CPA collection LPM 1900 |
|||
|
Toutes ces fabriques étaient réparties à Falaise même et surtout dans le faubourg célèbre de Guibray, où se trouvaient alors surtout les ateliers familiers indépendants. En dehors des filatures du pays, trois blanchisseries bertholiennes, comme on disait alors, au lendemain de l’invention de Bertholet, se trouvaient non loin du ruisseau de Traine-feuille ou au Val d’Ante où la blanchisserie Lefez blanchissait 20.000 douzaines de bonnets par an, qui coûtaient 80 centimes à blanchir. Tous les « bonnets de coton » fabriqués alors à Falaise étaient employés par la consommation normande, puis par la Bretagne et dans le midi de la France ; il s’en débitait alors beaucoup aux foires de Guibray et de Caen.
Le grand constructeur de métiers était M. Jérôme Toutain. Mais bientôt, au coton nécessaire à la fabrication, filé à la main sur place, allait se substituer la filature purement mécanique. Lorsqu’arrivèrent d’Angleterre les précieuses machines à filer, les bonnetiers de Guibray se refusèrent à en faire usage. Il en résulta une crise causée par la concurrence et qui dura plus de vingt années. |
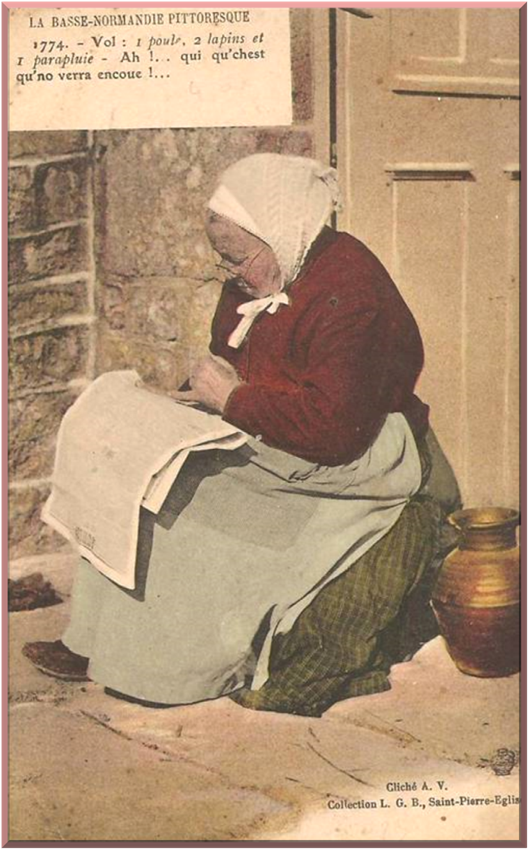 CPA collection LPM 1900 |
|||
|
Instruits par l’expérience, les industriels falaisiens se résignèrent enfin à adopter les machines à filer, mues par les manèges et par des chutes hydrauliques.
La première application de la vapeur au filage fut faite seulement en 1835, par M. Lebaillif, aux filatures de Saint-Laurent et du Moulin-Elie. MM. Lagniel-Carrel ne tardèrent pas à suivre cet exemple et dès lors la bonneterie de Falaise fut approvisionnée en tout temps, comme nous l’avons dit, de coton filé sur place. En 1865, il y avait déjà cinq filatures de coton Jusqu’en 1831, le métier falaisien en usage était le métier carré français, fonctionnant très régulièrement, mais lent et ne permettant la fabrication du « bonnet de coton » qu’à raison d’une pièce par chaîne. A cette époque, un certain Jouve avait imaginé de fabriquer pour certains bonnetiers, un métier plus large sur lequel on pouvait confectionner des « bonnets de coton » n’ayant de couture que d’un seul côté. Ce fut le signal d’une véritable petite émeute qui éclata en mai 1831 dans tous les ateliers de Guibray où retentissait le bruit des métiers. Si la police et la garde nationale n’étaient pas intervenues, le métier trop actif aurait été mis en pièces. Grâce à cette prompte intervention, on n’eut point d’excès à réprimer et les bonnetiers ne tardèrent pas à reconnaître les avantages de la nouvelle machine et l’adoptèrent. Bientôt aussi, on arriva à transformer le mouvement rectiligne et alternatif du métier carré en mouvement circulaire
Mais le grand inventeur des métiers nouveaux, le grand créateur et propagateur du « bonnet de coton » fut Louis Cahaigne, physionomie rude et méditative d’inventeur, au visage rasé et osseux, aux regards profonds. Ce fut, en réalité, le père du « bonnet de coton ». Après un voyage de propagande en Picardie, où on usait aussi du «bonnet de coton», il modifia, toujours heureusement, le métier rond : il fut même un temps, en 1860, où 70 à 80 bonnetiers employaient jusqu’à 2.500.000 kilos de coton par année pour des bonnets de toutes sortes : bonnet blanc, bonnet écru, bonnet jaspé, bonnet de roulier ou de marin. Louis Cahaigne remporta alors à l’Exposition de Rouen de 1859, pour son métier à deux chutes, une grande médaille de vermeil. Son fils, Léon Cahaigne et son gendre Baloud, dont la maison existe toujours, perfectionna et améliora sans cesse toute cette technique de la bonneterie, qui ne se contenta pas de fabriquer le bonnet normand, mais tous les genres de tricots, de chandails, de jerseys, de sweaters, tout ce qu’on appelle aujourd’hui le sous-vêtement. |
||||
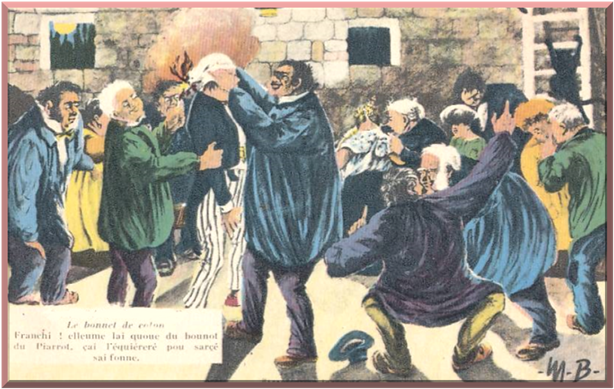 Noce en pays Maraichin, CPA collection LPM 1900 |
||||
|
|
||||
|
A Falaise existent encore les ateliers de MM. Ameline, Baloud frères, dont nous avons déjà parlé, Vve Barthélemy, Crespin, Dubois, Louis Duclos, Maurice Renaux. Nous en passons et des meilleurs ! Du reste, dans la même région, d’autres bonnetiers bas-normands, M. David, au Foulcq, près de Pont-l’Evêque, et les fabricants de Lisieux, de Pont-d’Ouilly, luttent avec la fabrique de Montrejeau, qui règne sur tout le Midi. Il y eut toute une époque où le « bonnet de coton » régna sur la France entière. Quand Béranger le chanta, il était devenu le symbole et l’attribut de toute une bourgeoisie endormie et pacifique. On le voit alors par le crayon d’Henri Monnier, coiffer Joseph Prudhomme, et Jérôme Paturot, qui las d’avoir parcouru vingt carrières sous le règne de Louis-Philippe, s’établit lui-même fabricant de « bonnets de coton ».
Voici ces strophes très peu connues : |
||||
|
Il est un choix de bonnets sur la terre Bonnets carrés sont au Temple des lois. |
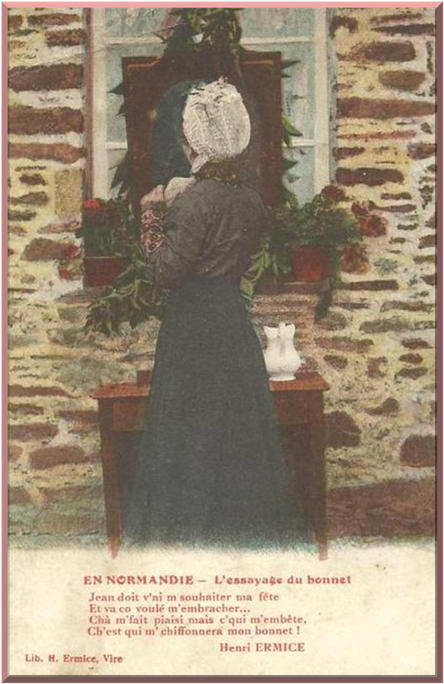 CPA Collection LPM 1900 |
|||
|
Depuis ces temps de triomphe, « le bonnet de coton » a bien décliné et Falaise a dû remplacer par d’autres tissus, sa vieille spécialité de jadis qui, pourtant, n’a point encore disparu complètement…
Il fut un temps où les usines falaisiennes étaient au nombre de 80. M. Auguste Nicolas dans son livre sur le Calvados agricole et industriel, publié en 1918, constate que l’industrie de Falaise était réduite à neuf usines qui répondaient cependant à toutes les commandes faites. A cette époque, Falaise fabriquait surtout les « chemises de coton tricot », rayées de bleu de la marine française, qui avaient remplacé le pacifique « bonnet de coton » de nos pères, dont nous venons de conter l’histoire. |
||||
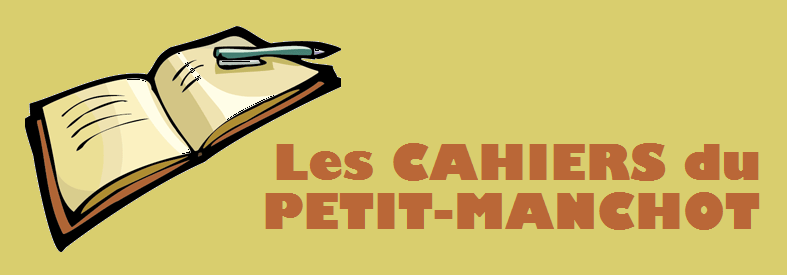 |
||||
|
Le jeu de domino en Normandie
par Georges Dubosc 1924
Illustrations par les CPA du petit manchot
Il a été proclamé dernièrement rois du Domino et princes du Double-Six, deux braves normands du Calvados, qui se sont mesurés les dés en main. Déjà, l’an dernier, à Deauville, un maçon très expert, M. Gauthier, avait battu tous les concurrents et même son dernier adversaire, M. Mator, maire de Pennedepie, bien digne, lui aussi, d’un tel honneur. D’autres concours sont encore en vue.
|
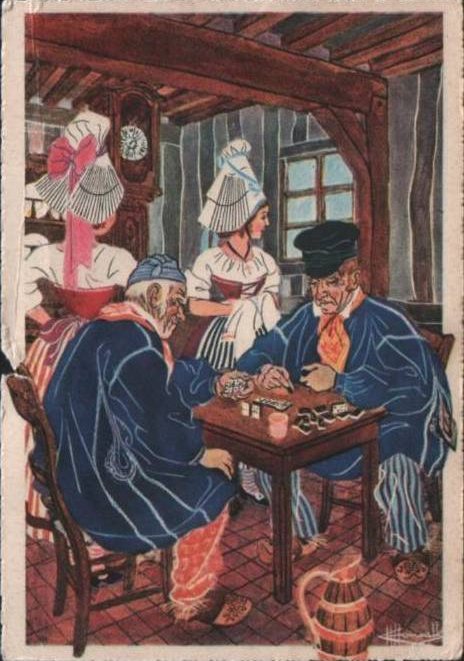 |
|||
|
C’est que le jeu de dominos est le véritable jeu des Normands, celui qui convient le mieux à leur caractère, à leurs habitudes et à leur sapience proverbiale. Ne met-il pas en avant toutes leurs qualités et toutes leurs vertus natives ? La mémoire pour se rappeler tous les dés abattus pour les évoquer immédiatement, et pour se rendre compte du fort et du faible de l’adversaire ; l’attention soutenue, la méditation réfléchie, la perspicacité avisée ; la psychologie du partenaire, la décision prompte et sûre.
N’y a-t-il pas même un peu d’imprévu et de magie, dans le mouvement de ces dés souvent remués et dans leurs cliquetis joyeux et bruyants sur les tables de marbre du cabaret et de l’auberge où se réunissaient jadis les habitués du domino ? A combien d’ingénieuses combinaisons ne peuvent pas se prêter ces simples dés rangés et alignés suivant les règles de l’art ? Des calculateurs les ont estimées à près de 400,000 figures…
Et, malgré le sérieux attentionné avec lequel on joue le jeu traditionnel en Normandie, combien de plaisanteries et de drôleries ne provoque pas l’innocent jeu de dominos ! Ne sait-on pas par exemple, que la mare d’Yvetot, au pays « des joueux de domino », ne tient bien l’eau que parce qu’elle est pavée de double-six qu’y ont jetés les joueurs, heureux de se dépouiller de quelques dés embarrassants ? Et puis combien pittoresques suivant les terroirs, sont les appellations des dés : le gros papa, le gros père, le double-six ; la patrouille, le cinq qui date des beaux temps de la Garde nationale et des interminables parties qui se jouaient pendant les heures inoccupées, la patrouille qui représentait quatre hommes et un caporal ; la blanchisseuse, la blanchinette pour le double blanc ; le quatuor le catouilleux qui figure le quatre ; le six au fin ou le cizeau fin et bien d’autres. Et les réponses énigmatiques en fin de partie, quand le jeu est bouché et qu’on va compter les points, alors que le combat s’arrête, faute de combattants ! - « Combien de dés ? – Autant que de pattes et d’oreilles !... » Manière ingénieuse, détournée, bien normande, qui peut laisser planer encore un doute, d’annoncer qu’on tient encore six dés en main. Et les rites traditionnels et amusants de la partie de dominos ! Quand, par exemple, un voisin de campagne, un fermier, avait perdu la partie, pendant la soirée, la malice paysanne voulait que les enfants le reconduisent avec une lanterne d’écurie… pour qu’il ne soit pas dévalisé de son gain, en route ! On n’était pas plus ironiquement cruel ! |
||||
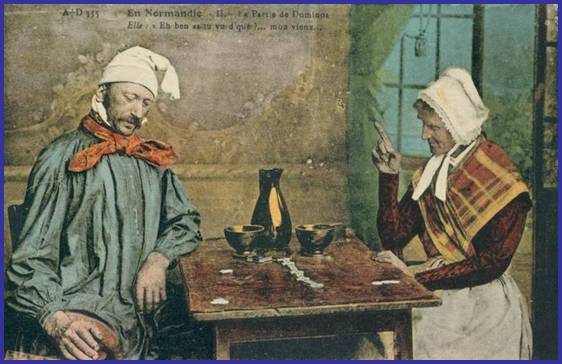 |
||||
|
Dans le pays de Caux, dans le pays de Bray, dans tous les coins de Basse-Normandie, on joue la partie de dominos, on taquine l’os, avec autant d’entrain qu’on joue la manille dans le Midi. Les parties passionnées se succèdent sans fin pendant les après-midi dominicales. Pendant la guerre, les bonnes parties de dominos à trois s’étaient un peu apaisées, mais il y a encore quelques vieux dominotiers, qui n’ont pas abandonné leurs parties. A Rouen même, où tous les « porteux » du pays de Caux avaient introduit la partie de dominos parmi tous les négociants de la Côte-d’Or, et il y avait tels cafés de l’ancien cours Boieldieu, comme les cafés Bricque et Mennechet où, le vendredi, on remuait les dés en dégustant une bouteille poussiéreuse de fin bourgogne. On jouait alors la partie à deux, ou à trois, la partie carrée, sans pêche, pioche, talon ou cuisine, qui sont les surnoms des dés inoccupés. La partie à deux a, vraiment seule, du charme. Il n’est pas toujours facile de se rencontrer à quatre qui veulent se battre. Quand on est trois, c’est bien ennuyeux, dit la chanson. Dans ce cas, on a la ressource de jouer avec un « mort », comme au whist, mais un mort au milieu de trois bons vivants, jette toujours un froid… Tout cela revient à dire au surplus, qu’il y a différents moyens de jouer aux dominos : partie de tête-à-tête, chaque joueur prenant six dés ; partie de tête-à-tête à quelque nombre de dés que ce soit ; partie à quatre, chacun pour soi, sans être aux points ; partie à deux contre deux ayant chacun six dés et jouant pour gagner le plus tôt cent points |
||||
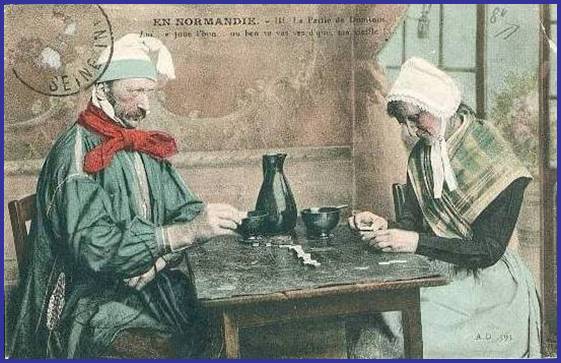 |
||||
|
Le nombre des dés s’étend, aujourd’hui, ordinairement jusqu’à vingt-huit, divisés en sept espèces, commençant par le « double-blanc » et finissant par le «double-six », formant 168 points. Mais ne croyez pas qu’il en a toujours été ainsi. L’Académie universelle des jeux ou Dictionnaire méthodique et raisonné de tous les jeux, publiée en 1825, indique que le nombre des dés était parfois porté à 36, divisés en huit espèces, et allant du « double-blanc » au « double-sept », formant 252 points. Ce nombre des dés a même été porté jusqu’à 45, allant toujours du « double-blanc » jusqu’au « double huit », formant ensemble 360 points. Et nous n’assurerions pas qu’il n’y ait pas eu des « double-dix » ! Pour se renseigner sur ces combinaisons assez restreintes du jeu, il faudrait consulter quelques recueils spéciaux ayant trait au noble jeu des dominos, mais cette bibliographie n’est pas très complète. On a chanté cependant les beautés du « double-six » et les ruses compliquées pour parvenir à boucher le jeu de l’adversaire et le contraindre à s’avouer vaincu. |
||||
|
|
||||
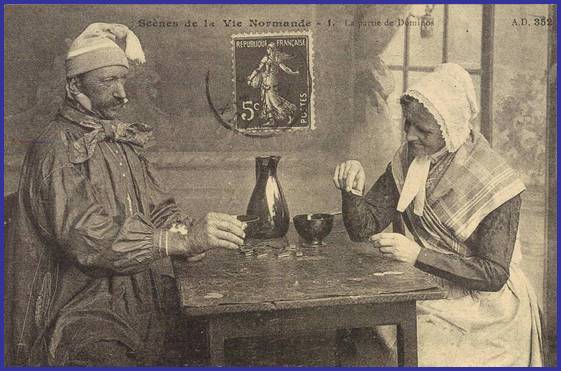 |
||||
|
|
||||
|
Un certain L. Jousserandot qui a écrit dans le fameux recueil Les Français peints par eux-mêmes et signé quelques romans Le capitaine Lacuzon et Le Diamant de la Vouivre, vers 1844 a dédié au sculpteur Dantan jeune, l’auteur de notre statue de Boieldieu, fameux dominotier en son temps, une épître intitulée Le Domino qui décrit avec verve ces belles et longues parties, quasi interminables, jouées au pays normand.
Je chante dans mes vers ces joueurs valeureux Qui, par leurs longs efforts, leurs calculs glorieux Emules des savants dont s’honore la France, Du jeu de dominos, firent une science. Une table que couvre une toile cirée Est debout au milieu de la chambre sacrée Et quatre heures sonnants, les adeptes assis Commencent le combat du Blanc contre le Six On a posé. Bravo ! Ce n’est qu’un dé timide Double-deux. Qu’ai-je vu ? Mon jeu, de six est vide Ciel ! On l’ouvre. Malheur ! Je dois boucher le deux. L’adversaire a bouché le six. Oh c’est heureux ! Et mon partner a dit : « Deux partout ! Quelle chance ! C’est de notre côté que penche la balance. On boude, on boude, on boude ! Il m’a rendu le trois. Rien, mais le six paraît pour la seconde fois !! Alors l’émotion est sur chaque visage…
L’épître de Jousserandot n’est pas la seule fantaisie poétique consacrée à la gloire du « Double Six ». Il nous faut citer encore un traité didactique Le jeu de dominos, poème en vers français par G. Bénédit, un petit in-12, paru en 1856, puis Le Traité sur le jeu de dominos par A. Laurent paru en 1858 ; le Salon des jeux, qui donne une description du jeu de dominos ; l’Almanach des dominos par Bonneveine en 1883 ; le Domino et ses patiences par A. Laun, car le Domino, comme les cartes, a ses patiences, c’est-à-dire des… parties fictives qui occupent le temps du joueur solitaire, qui s’exerce et s’entraîne. Faut-il encore citer une combinaison du jeu de dominos, avec le jeu de cartes parue en 1909 le Domino-bridge qui, suivant son auteur Jean Bernac, est une « nouvelle application du jeu de bridge au jeu de dominos » ?
Les lettres n’ont point seules vanté et chanté les douceurs du domino familial. La peinture et le dessin n’ont eu garde d’oublier Les Dominotiers. Aussi bien, les figures attentives, défiantes, perplexes des joueurs n’offrent-elles pas des thèmes tout trouvés à l’observation des peintres ? Les attitudes elles-mêmes, les gestes, la façon de tenir les dominos, de les abriter contre tout regard indiscret, la curiosité des assistants, tout cela on le retrouve dans le Domino à quatre, une charmante lithographie de Boilly, qui excellait dans ces études de physionomie. La scène semble se passer dans le Café de Foy, au Palais-Royal, qui, sous la Restauration, fut le café favori des joueurs de l’Académie du Domino, ou encore dans le Café de Valois, fréquenté par une clientèle de gens tranquilles pratiquant alors le domino. Daumier, lui aussi, a crayonné de nombreuses lithographies parues sous le titre des Dominotiers, où on lit sur les physionomies des joueurs toutes les passions de l’âme humaine. Il nous semble bien aussi que Léandre s’est plu à dessiner et à croquer quelques herbagers ou maquignons bas-normands, en plaude bleue et en casquette, figures rasées et rusées, taquinant les dés dans la pénombre d‘un cabaret villageois.
Reste encore une question assez sérieuse et qui divise encore très fortement tous ceux qui se sont occupés, peu ou prou, des dominos. Qui est-ce qui a bien pu inventer le jeu de dominos, et à quelle date remonte-t-il ? Voilà longtemps qu’on s’est posé le problème, sans pouvoir apporter une solution définitive. Bien entendu, on a voulu voir dans leurs combinaisons ingénieuses, un jeu antique, par exemple un jeu grec, mais on a eu beau lire toutes les descriptions données par Becq de Fouquières dans son Histoire des jeux antiques, on n’a rien trouvé de définitif. le jeu de pétie qui est une combinaison de dés où le hasard a sa part, ne rappelle en rien le noble jeu de dominos. D’autres ont attribué l’invention aux Chinois, aux Hébreux et, avec peut-être plus de vraisemblance, aux Coréens. On a signalé, en effet, jadis, dans le bric-à- brac d’un antiquaire parisien, dont l’étalage se composait surtout d’objets de provenance exotique, un certain nombre de dominos, d’un caractère grossier et étrange. C’étaient des plaques d’os assez petites, 15 millimètres de long sur 9 de large seulement, dont les cavités qui marquaient les points étaient peintes en rouge et en noir et diminuaient au fur et à mesure que le nombre des points augmentait. L’antiquaire qui présentait ce jeu assez singulier, prétendait qu’il provenait de Corée, mais à bien mentir qui vient de loin !... |
||||
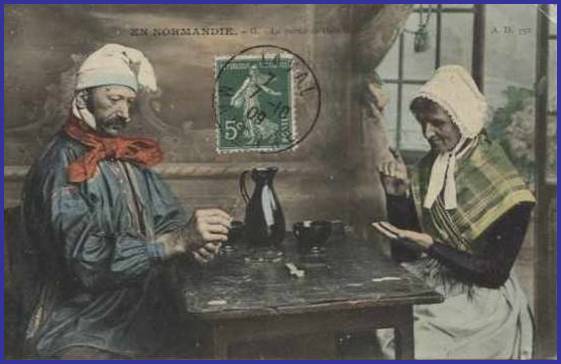 |
||||
|
D’autre enfin veulent que les Italiens aient été les inventeurs du jeu et des boîtes de dominos. Toujours est-il que la collection du savant historien des jeux, Henry d’Allemagne, possède de très curieuses boîtes de dominos, ouvragées, ciselées, découpées, qui sont certainement un travail italien de la fin du XVIe siècle. La plupart de ces anciennes boîtes sont en forme de berceaux, tantôt plates et ornées aux angles de quatre petites colonnettes, tantôt d’une forme bombée, mais munie d’un dossier comme un petit lit. Le tout est en os travaillé à jour et orné de petits cercles rouges ou verts et de rosaces quadrilobées. Ainsi que nous l’avons indiqué, ces dominos sont plus nombreux que ceux d’aujourd’hui, et vont jusqu’au double-neuf. Ces boîtes italiennes sont composées de deux casiers longitudinaux et symétriques, qui reçoivent deux jeux différents, un jeu rouge et un jeu noir. A chacun de ces jeux correspondent deux dés de même couleur. Il est donc probable que chacun jouait avec son jeu, un peu à la manière dont se pratiquait le tric-trac.
Ceux qui font remonter le jeu de dominos aux Italiens ont inventé plusieurs anecdotes assez adroitement combinées pour expliquer l’origine du jeu et, en même temps, l’origine du nom. La légende veut, par exemple, rapportait jadis l’almanach de l’Eure, cité dans le supplément du Dictionnaire de Littré, que le mot provienne d’une petite histoire trop amusante pour être vraie.
Des moines appartenant à un des monastères avoisinant le Mont Cassin, en Italie, pour quelques fautes vénielles, ayant été mis dans la cellule de pénitence, taillèrent des carrés de bois, y marquèrent et y gravèrent des points et en firent un jeu en les assemblant.
Sortis de cellule, ils communiquèrent cette distraction, qui leur avait paru si agréable, à tous ceux qui les approchaient et mirent bientôt tous les frères du couvent dans le secret de leur invention. Depuis le prieur jusqu’au portier, tout le monde se passionna pour le jeu. Celui des joueurs qui avait trouvé le moyen de placer tous ses dés témoignait sa satisfaction, comme il est d’usage chez les religieux après une tâche ou un travail quelconque : « Benedicamus Domino ». De sorte que le mot : domino revenant toujours à la fin de chaque partie, finit par désigner un jeu auquel on ne savait quel nom donner. L’Annuaire de l’Eure s’appuyait sur une vieille chronique pour donner cette explication, mais quelle chronique ? demande Littré. Tant qu’on ne l’aura pas citée – car on retrouve la même anecdote rapportée par un chercheur rémois, M. Matot-Braine – l’étymologie amusante restera toujours un peu suspecte, comme toute étymologie anecdotique. Cependant, elle a pour elle, ajoutait le savant linguiste, d’expliquer l’expression : faire domino, terminer la partie.
Il y a encore quelques traditions, non moins ingénieuses, sur l’origine des dominos ; celle qui les fait venir d’une sorte d’aumusse ou de vêtement ecclésiastique, noir et blanc, suivant la saison, dit domino dans plusieurs textes, et enfin celle qui assimile les dés blancs et noirs aux papiers de tentures, nommés dominos.
Mais les dominos à jouer remontent-ils à une époque aussi ancienne ? Tout au plus les trouve-t-on à la fin du XVIIIe siècle et on ne connaît guère de document graphique, antérieur à cette gravure allemande tirée à Augsbourg en manière noire, qui représente un petit maître en perruque poudrée, jouant aux dominos avec une jeune femme assise à une petite table en face de lui. L’idée vint aussi de décorer de motifs semblables, le revers des dominos et on voit à l’Hôtel Carnavalet plusieurs jeux ainsi décorés. Cela rentre un peu dans toutes ces sortes de jeux de dominos décorés : dominos avec « grotesques », comme Géricault aimait à en dessiner suivant la méthode des « cinq points » ; dominos-cartes, avec sujets qui se poursuivent ; dominos ornés de lettres et de syllabes, dits alphabétiques ou calculateurs. Notre distingué concitoyen, M. Chanoine-Davranches, a raconté dans ses intéressantes Notes sur l’origine et l’histoire des Jeux, que vers 1798, les joueurs de dominos se rencontraient dans les salles basses du café Foy et jetaient avec ostentation sur la table, les pièces de leur jeu favori revêtues de lettres dont le rapprochement formait : Vive le roi, la reine et le dauphin. C’était la distraction habituelle de la Jeunesse dorée de Fréron qui deviendront bientôt les Incroyables ! Cela prouve bien que la grande vogue des dominos date de la fin du XVIIIe siècle. L’Improvisateur français, parlant de ce jeu en 1804, disait, en effet :
« Il y a quarante ans seulement que la manie du domino s’est introduite dans les cafés de Paris. C’est une des plus misérables ressources que l’oisiveté ait imaginée, ce qui n’empêche pas d’y jouer des sommes considérables pour aller se pendre après les avoir perdues. »
Ce qui paraît bien invraisemblable.
Où fabrique-t-on les dominos ? Tout d’abord à Paris où les tabletiers de la rue des Gravilliers, en fabriquent de toutes sortes, en os, en verre, en galalithe, avec revêtements de toutes couleurs. Et puis à Méru, dans l’Oise, dans tout ce pays de la petite industrie de la nacre, de l’os, et l’ébène. Ardouin-Dumazet qui a écrit des notes bien curieuses sur Méru, décrit ainsi la fabrication du domino :
Le domino se fait à domicile, presque tout le travail étant exécuté à la main. J’ai assisté à l’achèvement de ces jeux pour lesquels j’avais vu débiter l’os à la machine. Sauf le creusement des trous à teindre en noir, l’opération est très simple : la plaque d’os est collée sur une plaque de bois préalablement plongée dans un bain de teinture noire. On place les rivets qui sont fixés à coup de marteau. On trace au noir les séparations et le domino est achevé. Méru en fait de très grands pour l’Allemagne, de très petits pour la Normandie, où ce jeu est fort répandu. La plus grande partie de la production va en Angleterre.
Les principaux fabricants sont les maisons Angot-Lamy, qui font les jeux et leurs boîtes ; Caplain fils, Deboffe, Pinguet et Ventin, qui font aussi les touches de piano ; Saguez et Deschamps. Enfin plus près de nous, il existe aussi une fabrique à Etrépagny dans l’Eure. N’est-ce pas une preuve suffisante pour gagner définitivement la partie en faveur de la Normandie et pour s’écrier : Domino !
GEORGES DUBOSC |
||||
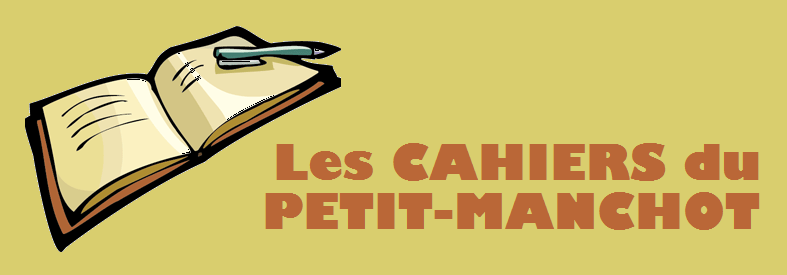 |
||||
|
LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN NORMANDIE
Par Georges Dubosc Journal de Rouen du 21 décembre 1909
Certes, notre région normande a toujours été à l’abri des grandes perturbations sismiques, si nombreuses sur certains points du globe, souvent éprouvés par de lamentables catastrophes. Au cours des siècles, toutefois, on peut noter différents tremblements de terre qui ont été relevés dans nos vieilles chroniques, toujours prêtes à recueillir les faits qui leur paraissaient mystérieux et dont Farin, notamment, dans son Histoire de Rouen, a dressé une nomenclature que nous complèterons.
Le nombre de ces tremblements de terre - est-il besoin de le dire ? - est en somme fort peu considérable, quand on compare la statistique générale des secousses de tremblements de terre dans le monde entier. |
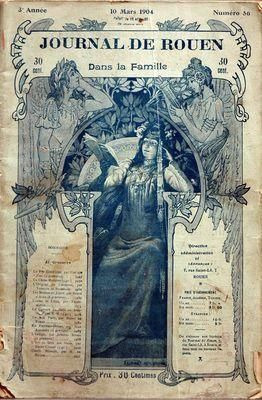 |
|||
|
Qu’est-ce que nos petites secousses normandes, à côté des mille cent quatre-vingt-quatre tremblements de terre qui ont eu lieu de 1865 à 1873 ; à côté des seize secousses ressenties en Suisse dans la seule année 1881, ou des cinq cents secousses annuelles du Japon, le pays classique des catastrophes sismiques ?
GEORGES DUBOSC |
||||
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
Deux lépreux demandant l'aumône, d'après un manuscrit de Vincent de Beauvais (XIIIe siècle). |
||||||||||
|
Recherches sur les léproseries et maladeries qui existaient en Normandie par Léchaudé d'Anisy, 1772-1857. Publié en 1847
De tous les fléaux qui ont affligé l’humanité, la lèpre est sans contredit la plus ancienne maladie dont l’histoire fasse mention! Elle était connue des Egyptiens, qui la transmirent aux Juifs, comme nous l’apprend l’Écriture-Sainte; et l’ordre que Moïse fit exécuter contre sa sœur, prouve que ceux qui étaient atteints de ce genre de maladie étaient exclus de la société des autres hommes jusqu’à leur entière guérison.
Nos chroniques les plus anciennes font mention de cette maladie, qui a porté indistinctement les noms latins de Lepra , Misellaria ou d 'Elephantia; et en vieux français ceux de Me sel ou Mesiax pour exprimer un lépreux. « Quant Mesiax apele home sain , ou quant li home sain apele a un Mesel ; li Mesiax pot mettre en défense , qu’il est hors de la loi mondaine »
Tous les auteurs qui out parlé de cette maladie eu ont fait des descriptions plus ou moins horribles, et presque tous nous ont peint le lépreux sans espoir, appelant vainement la mort pour mettre un terme à sa triste existence, qui se prolongeait souvent jusques dans un âge très-avancé.
Les lois Lombardes firent, pour ainsi dire, un mort vivant du lépreux, en lui appliquant les effets de la mort civile. Après avoir recouvert ce malheureux d’un linceul et lui avoir fait entendre une messe des morts, suivie du Libéra, on le conduisait dans le cimetière, où le prêtre prenait une pelletée de terre qu’il lui posait par trois fois sur la tête, en lui disant: a Souviens-toi que tu es mort au monde et, pour ce, aye patience en toi. » Il lui était alors défendu d’approcher de personne ; de ne rien toucher de ce qu’il marchandait pour acheter; de se tenir toujours au-dessous du vent, lorsqu’il parlait à quelqu’un ; de sonner sa tartavelle ou cliquette, quand il demandait l’aumône ; de ne pas sortir de sa borde ou tanuière sans être vêtu de la housse ; de ne boire en aucune fontaine ou ruisseau , qu’en celui qui était devant sa borde ; de ne point passer ponts ni planche sans gants ; enfin , de ne pas sortir sans un congé du curé ou de l’official du lieu ). Aussi, voyons-nous un malheureux lépreux, même dans l’aisance , obligé de s’exiler du sein de sa famille, à laquelle il était en horreur , ne pouvoir trouver une retraite qu’en abandonnant la moitié de son bien aux moines. « Cum se Ragierus Fortinus lepra sensisset , « rogavit nos ut eum in nostra suscipientes apud Bellum locum , Cenomanensis, sicut de uno monachorum curam de eo geremus. Quo impetrato donavit ecclesiæ nostræ medietatem quam possidebat , etc.
La politique et la religion s’unirent bientôt pour trouver des remèdes à cette maladie, ou , du moins, pour en arrêter les progrès. Aussi des ordonnances furent-elles rendues, dès les premiers tempsde la monarchie, pour séparer le lépreux de la société. On s’occupa en même temps de pourvoir à leur subsistance, et la piété de nos pères ne tarda pas à élever et à doter cette multitude de léproseries ou maladreries, dont nous voyons encore quelques vestiges auprès des villes ou des principaux bourgs de cette province.
Plusieurs historiens ont avancé que la maladie de la lèpre avait régné, beaucoup plus anciennement en Angleterre qu’en France. Ilss’appuyent sur ce que St.-Finian , de la famille des rois de Munster, en était attaqué lorsqu’il fonda le monastère d’Inis-Fallen , d’où lui vint le surnom de Lobhar ou le Lépreux. 11 est cependant bien évident que nos premiers conciles s’occupèrent particulièrement des lépreux dès le commencement du VI eme siècle, ainsi qu’on le voit dans l’un des canons du cinquième concile d’Orléans, par lequel les pères recommandent aux évêques de prendre un soin particulier de ceux qui seraient atteints de cette maladie. Il en est de même du concile tenu à Lyon en 583, qui recommande également aux évêques le soin des lépreux de leurs diocèses , « afin que « l’église leur fournissant le nécessaire , ils ne puissent avoir aucun « prétexte pour se mêler avec les autres hommes. »
Il est probable que cette maladie se ralentit pendant le VII eme siècle, et même durant toute la première moitié du VIII eme ; car le plus ancien document que nous trouvons en France, après les conciles, ne remonte pas au-delà d’une ordonnance de Pépin, donnée à Compiègne en 757. Elle permettait à la femme saine de se séparer de son mari lépreux.
Charlemagne, par une autre ordonnance de l’an 789, fit pour ainsi dire parquer les lépreux : il leur défendit de se mêler avec le reste du peuple.
Les capitulaires de nos rois nous fournissent aussi quelques ordonnances semblables, destinées autant que possible à arrêter ’extension de ce fléau. Elles s’arrêtent à l’année 929, avec les registres qui les renferment.
La coutume de Normandie et celle du Hainaut contiennent des dispositions qui donnent lieu de croire que cette horrible maladie, déjà très-répandue en France, vers le X eme et le XI eme siècle , ne fut cependant introduite en Normandie que vers le milieu de ce dernier.
Suivant une vieille coutume manuscrite de Normandie « Li mesel (ou lépreux) ne poeut estre heirs à nului, partant que la maladie soit apparoissante communément, mais ils tendront leur vie l’éritage que il avoient ains que il fussent mesel. »
Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, en faisant établir plusieurs léproseries en Normandie, dans le XII e . siècle, et en stimulant la libéralité de ses sujets pour fonder de semblables établissements , paraît avoir fait quelques règlements pour les lépreux et avoir prescrit des mesures pour les éloigner des villes et des villages ; mais ces divers actes ne nous sont point parvenus.
Dès le commencement du XIII e . siècle, ce fléau avait été tellement multiplié par les croisades qu’il n’y avait pas de villes , de bourgs et même de grandes communes , qui n’eussent leurs léproseries particulières ; et nous voyons Louis VIII léguer par son testament , fait en 1225, cent sous (ou 84 liv. d’aujourd’hui) à chacune des deux mille léproseries de son royaume.
Les coutumes générales, connues sous le nom d’établissement de St.-Louis , contiennent aussi quelques règlements concernant les léproseries et spécialement contre les abus commis par les prévôts fermiers, chargés de l’administration des biens de ces hôpitaux.
Odon Rigaut, archevêque de Rouen , dans ses visites pastorales , et particulièrement Robert de Harcourt , évêque de Coutances , dans ses statuts synodaux de l’an 1294 (2) , nous ont également laissé de curieux documents sur les lépreux et les léproseries de la Normandie.
En 1315, Louis X (dit le Hutin) , crut détruire la mendicité , siège principal de la lèpre , eu permettant aux juifs d’acheter des rotures en se faisant chrétiens ; mais il ne fit qu’augmenter ces deux fléaux , parceque les seigneurs , auxquels ces nouveaux convertis appartenaient, s’emparèrent de leurs biens , sous le spécieux prétexte que la liberté qu’ils acquéraient par ce moyen privait lesdits seigneurs du droit de propriété qu’ils avaient sur la personne même du juif.
Charles VI, par une ordonnance de l’an 1381 , abolit cet usage barbare; mais dix ans après il en rendit une autre, plus cruelle encore , en expulsant ces mêmes Juifs du royaume et en s’emparant de leurs biens.
Néanmoins cette mesure, quelqu’injuste qu’el’e fût , eut cependant un résultat qui en tempéra l’atrocité, puisqu’on doit lui attribuer le peu de progrès que fit cette maladie pendant le XV e . siècle et au commencement du XVIe . Une ordonnance de François I er . , en date du 19 décembre 1563 , prouve, en effet, que cette maladie était alors beaucoup diminuée et qu’une grande partie des maladeries se trouvaient désertes et restaient sans emploi. C’est pourquoi ce prince enjoignit de faire faire un état des biens de tous les établissements de ce genre dont les administrateurs dissipaient le revenu , afin d’en prévenir la ruine ; mais , cette ordonnance ne reçut pas son exécution, et les biens de ces maisons continuèrent d’être dilapidés comme par le passé.
Bientôt après , cette dilapidation vint de la couronne elle-même; et Henry II , pour soutenir la guerre qu’il faisait à Charles-Quint, après avoir mis, en 1552 , un impôt de 25 liv. sur chaque clocher du royaume, ordonna ensuite de s’emparer de tous les biens disponibles des léproseries et maladeries.
Henri IV , par un édit du mois de juin 1606 , ordonna que son grand aumônier, ou ses vicaires-généraux, procédassent à la révision des comptes des fermiers des maladeries , afin d’employer les sommes dont ils étaient détenteurs , à l’entretien et au soulagement des pauvres gentilshommes ou autres officiers et soldats estropiés dans les dernières guerres.
Quelques symptômes de la lèpre s’étant manifestés vers le commencement du règne de Louis XIII, ce prince ordonna, par sa déclaration du 2 octobre 1612, de répartir ces nouveaux lépreux dans les maladeries qui subsistaient encore , et il fit pourvoir à leur subsistance au moyen de pensions que les fermiers de ces hôpitaux furent contraints de leur payer.
Mais bientôt la fainéantise chercha à exploiter, à son profit, ces secours donnés aux véritables lépreux : des vagabonds se firent admettre dans ces tristes maisons, après s’être frottés d’herbes corrosives, qui les faisaient paraître couverts de pustules et d’ulcères les plus dégoûtants.
La découverte de ces honteuses supercheries rendit bientôt les maladeries désertes; et les revenus affectés à ces établissements, n’ayant plus de destination fixe , eussent fini par être entièrement dilapidés par les employés préposés à leur administration, si Louis XIV n’y eût apporté un prompt remède. Ce prince, par son édit du mois de décembre 1672, donna une nouvelle destination à ces établissements , et disposa de leurs biens pour accorder des pensions ou des Commanderies aux officiers de ses troupes qui s’étaient distingués dans les dernières guerres. En même temps il réunit leurs domaines à ceux que possédaient déjà les ordres hospitaliers et militaires de St. -Lazare de Jérusalem et du Mont Carmel qui avaient été précédemment unis par Henry IV , en 1607.
Par un autre édit, du mois de mars 1693 Louis XIV, voyant que l’abandon qu’il avait fait des biens des léproseries et maladeries , aux ordres du Mont-Carmel et de St.-Lazare, n’apportait aucun soulagement aux officiers de ses troupes qui les possédaient , à titre de Cgmmanderie, à cause des procès que leur suscitait la division des terres de ces petites propriétés , ce prince ordonna définitivement la désunion de ces biens et se réserva d’en faire jouir quelqu’autre établissement eu dédommageant les fondateurs et -les officiers qui en jouissaient. En conséquence, il rendit une nouvelle déclaration , en date du 15 avril de la même année, par laquelle il remit en possession des biens des maladeries et léproseries les anciens fondateurs qui justifièrent suffisamment de leurs droits ; et en même temps il pourvut à l’entretien de l’ hôpital de St.-Mesmiu, dans lequel on réunit tout ce qui restait en Frauce de malades affectés de la lèpre.
Enfin, par une nouvelle ordonnance de la même année, qui ne fut cependant vérifiée et exécutée qu’en 1696, ce prince réunit les Maladeries dont les anciens fondateurs n’avaient pu justifier de leur titre , aux hôpitaux ou autres établissements les plus voisins des lieux où elles étaient situées ; et ces derniers en sont demeurés possesseurs jusqu’à l’époque de la révolution.
Quoique la piété de nos pères, ou plutôt la crainte de cette horrible maladie ait fait multiplier à l’infini les léproseries dans cette province néanmoins les diverses mutations qui se sont successivement opérées dans le régime administratif de ces maisons , ainsi que les dilapidations auxquelles elles ont été si souvent exposées , ne m’ont permis de recueillir dans les archives départementales qu’un fort petit nombre de chartes primitives de leur fondation , et encore moins d’actes civils ou particuliers passés par des lépreux. Aussi la table indicative des léproseries et des maladeries , dont je donne ici une courte description , est-elle fort incomplète , bien que le chiffre numéral s’en élève à 218 . Elle eût même été moins considérable encore , si je n’eusse eu recours aux pouillés de nos divers diocèses , qui ne désignent souvent ces anciens établissements que sous le nom d’hôpital ou de chapelle. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
LA NORMANDIE ANCESTRALE Ethnologie, vie, coutumes, meubles, ustensiles, costumes, patois Stéphen Chauvet. Membre de la Commission des Monuments historiques Edition Boivin, Paris.1920 |
||||||||||
|
Mariage.
— Le mariage civil est accompli sans bruit comme une formalité qui n'engage point, et les noces ne commencent que la veille du mariage à l'église, le seul regardé comme légitime. Le matin, les parents de la future montent dans une charrette traînée par des chevaux ou des bœufs et, accompagnés d'un ménétrier qui sonne du violon, vont chercher le trousseau chez la belle-mère pour le transférer chez le bruman (fiancé; de bru, et de man, homme).
Une énorme armoire sculptée est bientôt chargée sur la voiture, au-devant de laquelle la sœur ou simplement la couturière de la mariée s'assied sur des oreillers destinés au lit nuptial, tenant sur ses genoux un rouet et une quenouille, symboles des occupations domestiques Chemin faisant, la couturière distribue des paquets d'épingles aux jeunes filles qu'elle rencontre.
Assez fréquemment, la noce va à cheval à l'église, les femmes assises sur la croupe, en arrière du « maître ». Les deux époux se placent au milieu de l'église, sous un crucifix pendu à la voûte, y reçoivent la bénédiction nuptiale, entendent l'évangile au maître-autel et font une station à l'autel de la Vierge pour y déposer leurs cierges. |
 |
|||||||||
|
On sort de l'église au bruit des coups de fusils et des pétards; le convié le plus alerte présente la main à la mariée, la fait danser un moment et en reçoit un ruban; un second ruban est la récompense de celui qui la remet en selle.
Dans les préparatifs du mariage, le transport du trousseau de la future mariée signalé ci-dessus, constituait à lui seul une cérémonie qui se déroulait selon des rites charmants. L. Beuve a recueilli, à Vesly, de la bouche d'une vénérable octogénaire le récit de cet événement, car c'en était un dans un bourg et on en « jasait » longtemps encore après les noces. Ce récit figure dans le numéro du Bouais Jan du 8 août 1898 (p. 103) :
« Le trousseau de la mariée arrivait, en voiture, huit jours avant la noce, marchant au pas, lentement, le long des bourgs, pour s faire bi guetta L'armoire, la vénérable armoire normande, trônait, bien en vue, au mitan de la quertée de meubles, telle une reine parmi ses sujets. Le grand caoudron, la paesle, le biaux mireux, étaient aussi mis en valeur, artistement disposés, suivant les règles plusieurs fois séculaires, que se transmettaient de génération en génération, les couturières. La quenouille et le rouet y figuraient aussi. Ils étaient soigneusement enrubannés. Après la noce, la jeune mariée allait suspendre sa quenouille à l'autel de la bouiïvirge. Aujourd'hui, ajoute le poète, on ne file plus et l'on remplace la quenouille par un vulgaire bouquet. » |
||||||||||
|
Le trousseau de la mariée arrivait, en voiture, huit jours avant la noce |
||||||||||
|
Les mariés recevaient de leurs parents et amis quelques cadeaux parmi lesquels une houe, un louchet (un truble), une braie à filasse, un carrosse à laver et son battoir, emblèmes du travail que la jeune mariée devait exécuter clans son ménage. Le D r E. Ozenne rappelle qu'on « procédait minutieusement à la toilette de la mariée, sans oublier d'attacher derrière la coiffe, au-dessus du chignon, un petit miroir encadré de chenille verte et une rose blanche. Ces objets s'appelaient la relique. C'était l'emblème de la virginité. Le lendemain du mariage, la relique était placée à la tête du lit des époux : la rose s'était épanouie... »
Après la cérémonie religieuse le cortège, précédé du ménétrier, se rendait à pied à la salle du repas si elle était proche. Sinon, comme il n'y avait guère de voitures à cette époque et que les chemins étaient en très mauvais état, on se rendait à cheval au lieu du festin, chacun ayant sa chacune en croupe. Et c'était de par les champs et les chemins, une pimpante cavalcade, égayée des rires des paysannes casquées de belles coiffes (les comètes) dont les grandes ailes blanches et les rubans flottaient au vent.
Au festin, la bru (la mariée) se plaçait au centre. Derrière elle, était tendu un drap blanc sur lequel étaient attachés les bouquets de mariage enguirlandés de feuillage, de fleurs champêtres et de roses, et de flots de rubans blancs. Les invités se plaçaient selon leur bon plaisir. Le repas était copieux. De belles poulardes, rissolées à point, quittaient la broche qui les faisait tourner sans cesse devant une belle flambée de genêt, pour être découpées et passées parmi les invités, sur de grands plats de compagnie ornés de dessins bleus. Le bon bère, de pur jus, était versé à pleins connots, dans de biaux godias de cérémonie, par de nombreux valets et aussi... par le bruman (le marié) qui, selon l'usage, revêtu d'un tablier et les manches retroussées, servait les gens de la noce! Des chants, des divertissements animaient la fin du repas. Lorsque ce dernier était terminé, tout le monde allait faire un petit tour en plein air, de par les prés et les plants, puis on revenait souper. Enfin arrivait l'heure de la danse qui durait, généralement, pendant presque toute la nuit. Au petit jour les invités partaient; il ne restait que les amis intimes; ceux-ci allaient porter aux mariés, qui s'étaient retirés pendant la fête, des rôties contenues dans une écuelle d'étain à oreilles qu'on avait maintenue au chaud, devant l'âtre flamboyant, dans la corbeille d'un des landiers. Ce rite était l'occasion de quelques plaisanteries. Puis la chambre se vidait, et pendant que l'aurore se levait, les jeunes mariés pouvaient, enfin, goûter, loin du bruit, un sommeil réparateur.
Au cours du chapitre suivant, on verra que le trousseau de la mariée, ce trousseau qui était l'œuvre de tant de veillées et qui comportait des vêtements et des coiffes si seyantes, était livré la veille des épousailles.
Maintenant, hélas! tout cela est bien tristement modifié. Le trousseau est acheté, tout fait, dans un magasin de nouveautés, de la petite ville voisine. Les coiffes, les fichus ont disparu ainsi que le rouet. La belle armoire de chêne sculpté est remplacée soit par une armoire à grands panneaux tout unis, en bois blanc (peint de façon à imiter les nervures du bois), ou bien, si les futurs époux sont aisés, par une armoire à glace, « le plus platement hideux de tous les meubles », au dire de Banville. Le jour du mariage, la mariée, habillée de soie et portant simplement un voile blanc au-dessus de son chapeau (!) prend place dans la voiture à deux roues qui sert à aller au marché, à côté de son époux, habillé d'un veston foncé (orné à la boutonnière d'un petit bouquet de fleurs d'oranger) et coiffé d'un chapeau melon. Les invités de la noce suivent dans d'autres voitures. La couturière qui a fait la robe de la mariée, a encore, cependant, un petit privilège. Elle fleurit de petits bouquets de fleurs d'oranger les personnes de la noce et parfois celles qu'elle rencontre sur la route qui mène à l'église, et reçoit, en échange, une obole.
Mais où sont les beaux meubles et les délicieuses coutumes du vieux mariage d'antan? |
||||||||||
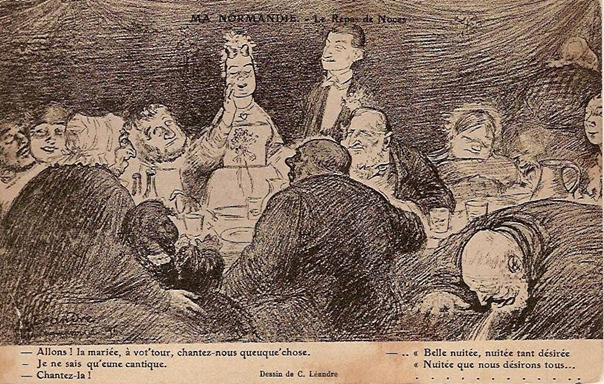 |
||||||||||
|
||||||||||
|
Promenades en Normandie Par Mauricette VIAL-ANDRU
On fait remonter l’histoire de la Normandie au traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Rollon et Charles le Simple. Toutefois, des ports comme Saint-Valery, entretenaient depuis bien longtemps déjà des relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Depuis la conquête romaine jusqu’aux invasions du Ve siècle, la paix avait régné. Les villes de Rouen, Évreux, Saint-Lô, Lisieux, Coutances, Avranches, existaient déjà et, à partir du Ve siècle, le pays s’était couvert d’abbayes illustres : Saint-Wandrille, Jumièges, le Mont-Saint-Michel.
La constitution du duché de Normandie fit de cette terre un des plus grands fiefs du royaume de France. En 1066, Guillaume le Conquérant réclame la couronne d’Angleterre et est victorieux à Hastings. Le sort de la Grande-Bretagne et de la Normandie est lié désormais. Quand la petite fille de Guillaume, Mathilde, épouse le comte d’Anjou Geoffroi Plantagenet, l’empire anglo-angevin vient de naître. Il s’étendra bientôt jusqu’aux Pyrénées, menaçant le royaume de France.
Et ce fut la première guerre franco-anglaise. Richard Coeur de Lion édifie son fier Château-Gaillard au-dessus de la Seine. Mais les Capétiens sont vainqueurs.
Louis X signe en 1315 la charte aux Normands qui ratifie toutes leurs libertés. C’est la paix capétienne : l’agriculture et l’industrie des toiles prospèrent.
Hélas, au XIVe siècle, la guerre reprend. Les bandes anglaises et leurs alliées les bandes navarraises, pillent les villes et les campagnes. Du Guesclin délivre un temps le pays par la victoire de Cocherel. Mais arrivent les heures mauvaises : le pays occupé à partir de 1417, puis Jeanne d’Arc brûlée vive à Rouen. La délivrance n’aura lieu qu’en 1450.
Au XVIe siècle, les Normands, qui ont le goût de l’aventure, s’élancent, depuis Dieppe ou Honfleur, vers les Amériques et les Indes. Les guerres de religion n’arrêtent pas cette expansion, Après la bataille d’Arques près de Dieppe, la province se rallie à Henri IV.
Au XVIIe siècle, la Fronde n’entrave pas le développement économique car les intendants de Rouen, Caen, Alençon, le favorisent. Pendant la Révolution, c’est une Normande de Caen, Charlotte Corday, qui délivre le pays du féroce Marat. |
 CAEN 1880 |
|||||||||
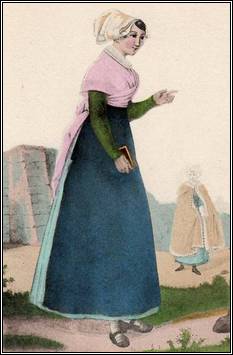 GRANVILLE 1880 |
||||||||||
|
Les Vendéens échouent au siège de Granville. Les chouans duCotentin, derrière leur chef Louis Frotté, attaquent les diligences qui transportent les fonds publics… et les derniers rêves s’évanouissent.
Mais l’histoire n’est pas close. En 1944, la bataille de Normandie ravage la province et fait disparaître de nombreux monuments d’un passé magnifique.
Reste l’orgueil des grands écrivains donnés à la France : Malherbe, Corneille, Flaubert, Maupassant, Barbey d’Aurévilly, Jean de la Varende. Ce sont là gloires majeures |
||||||||||
|
||||||||||
|
On juge le Normand madré et peu enclin aux promptes décisions. On le dit méfiant, on l’accuse de trop de prudence. En réalité, il est patient, observateur. Il possède un fond de solide bon sens. Il ne manque pas de finesse et se gausse des fanfarons. Il est travailleur. La guerre détruit-elle le village ? Il reconstruit avec ardeur et ne se lasse pas de recommencer l’oeuvre détruite. On peut encore admirer des auberges avec leurs énormes poutres et leurs solives mais presque partout, la pierre calcaire, parfois la brique, triomphent et donnent ces claires maisons égayées d’hortensias. Là s’imposait naguère l’armoire en chêne à deux portes, cirée, frottée jusqu’à l’usure. L’artisan y faisait figurer des épis de blé, des colombes… les armoires les plus anciennes remontent à la Renaissance et ont été recueillies dans les musées ou, hélas, vendues à des étrangers. Elles étaient, ces armoires, emplies de draps, de serviettes, de linge de table et de maison, fleurant bon la lavande cachée dans des sachets.
C’était le trousseau de l’épousée, sa « corbeille de mariage ». Et puis il y avait le buffet aux formes élégantes, le vaisselier garni des magnifiques faïences de Rouen, la bonnetière, la vieille horloge au balancier de cuivre, les cuivres rouges pendus aux murs, le lit massif entouré de lourds tissus. |
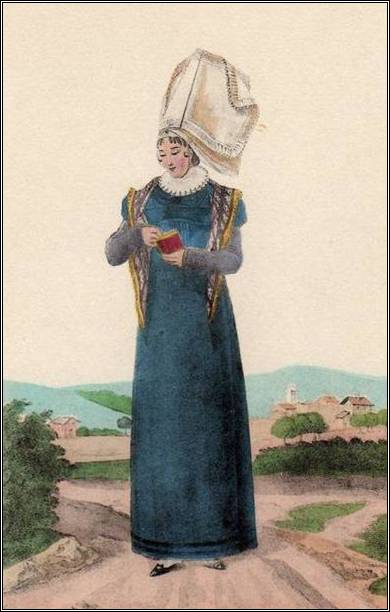 COUTANCES 1880 |
|||||||||
|
Les vêtements d’autrefois ont disparu et les coiffes, si diverses selon les lieux, ne sont visibles que dans les musées de traditions populaires.
Le Normand garde les pieds sur terre et s’inquiète peu du fantastique. Dans les bocages, les loups-garous ont longtemps couru les champs au grand effroi des enfants mais les contes normands s’inspirent surtout de l’histoire et de la vie quotidienne. Au pays du meilleur cidre, sur cette terre où une savoureuse eau-de-vie s’offre, pour créer au milieu d’un repas de fête, le fameux « trou normand », le diable n’a pas sa place… ou bien, s’il s’égare ici, il se fait avoir ! |
||||||||||
|
||||||||||
|
Une ville-musée, un port fluvial, un centre industriel, dans un cadre de vallons et de collines verdoyantes, au coeur d’une large courbe de la Seine, telle est Rouen.
Le coeur de la ville fut dévasté par la guerre. Mais Rouen a vite pansé ses plaies. La cathédrale, une des plus belles de France, a été sauvée. Elle fut commencée en 1145. La nef appartient aux XIII et XIVe siècles. Le grand portail ne fut terminé qu’en 1514. On peut suivre ainsi l’évolution du style ogival, improprement appelé gothique. C’est en Normandie que sont nées deux grandes évolutions spectaculaires : l’arc-boutant et la croisée d’ogives.
L’exquise église Saint-Maclou est du XVe siècle et sa façade est une dentelle de pierre d’une admirable finesse. L’aître Saint-Maclou, ancien cimetière de l’église, dont les galeries de bois remontent au XVIe siècle, est fascinant avec les restes de sa Danse macabre. La Grosse Horloge et son beffroi enjambent la vieille rue. Que de ruelles bordées de façades pittoresques ! Et nous voici sur la place du Vieux Marché qui rappelle encore le martyre de sainte Jeanne d’Arc. |
 ROUEN 1880 |
|||||||||
|
||||||||||
|
Ils s’égrènent des limites de la Picardie à celles de la Bretagne : Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Cherbourg, Granville.
Dieppe aux eaux profondes (deep) séduisit les Normands, puis les Plantagenets et enfin les Capétiens. Les Dieppois souffrirent rudement de la rivalité franco-anglaise pendant la guerre de Cent Ans. En revanche, au XVIe siècle, la ville connut une intense prospérité, en particulier avec le commerce de l’ivoire. C’est l’époque des explorateurs, des armateurs audacieux comme Jean Ango. Samuel de Champlain un autre armateur de Dieppe, parti d’Honfleur, fonde Québec en 1608. Au XVIIe siècle, le Canada est une « colonie normande ».
Fécamp a pris naissance autour d’une abbaye fondée en 660. Le monastère bénédictin fut saccagé à la Révolution mais l’église subsiste et aussi la célèbrebénédictine, liqueur découverte au XVIIe siècle par un moine et qui a rendu célèbre le nom de Fécamp. Autre monument important de la ville, l’église abbatiale de La Trinité, sobre, harmonieuse, caractérisée par l’abondance des chapelles : il y en a douze ! Au port, on se passionne pour le travail des pêcheurs toujours prêts à tout vous expliquer au milieu des cris discordants des goélands.
Le Havre, presque intégralement détruit par les bombardements, a retrouvé toute son activité. Les Romains y avaient établi un camp, mesurant la valeur d’une telle situation sur un estuaire. Mais au XVIe siècle, Le Havre n’était qu’une bourgade, un « havre de grâce », quand François Ier y fit élever des chantiers maritimes, dont témoigne la fameuse écluse François Ier.
De l’autre côté de l’estuaire, Honfleur est, avec ses maisons encapuchonnées d’ardoises, ses bassins animés de voiles colorées, une des cités les plus exquises de la Normandie. Les hautes maisons, la lieutenance, l’église Sainte-Catherine construite en bois au XVe siècle par les charpentiers du pays, sont autant de témoins d’un passé harmonieux. Alphonse Allais, Erik Satie, Henri de Régnier, Lucie Delarue-Mardrus, naquirent ici.
L’importance de Cherbourg est récente et ne date que du XIXe siècle.
De l’autre côté de la presqu’île, Granville s’installa tout doucement au XIIe siècle autour d’une modeste chapelle. |
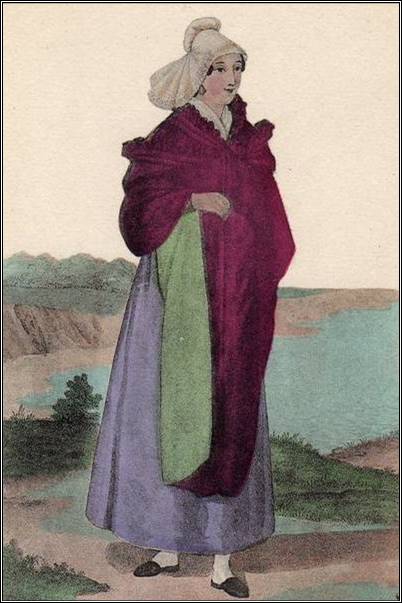 FECAMP 1880 |
|||||||||
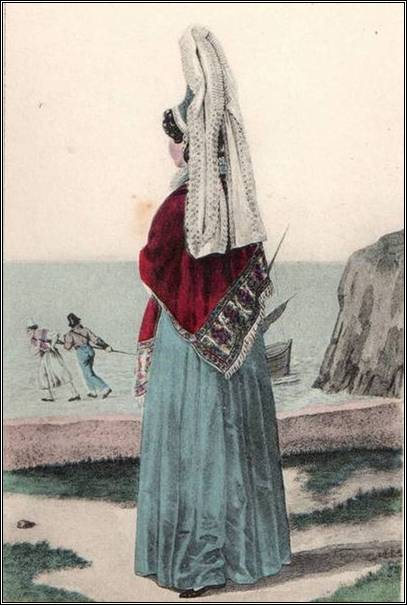 SAINT-VALERY-EN-CAUX 1880 |
||||||||||
|
La ville fut fortifiée au XVIIIe siècle et ses fortifications arrêtèrent en 1793 l’armée vendéenne commandée par La Rochejaquelein.
La vieille cité des Abrincates est perchée à 104 mètres au-dessus de l’estuaire de la Sée, en face du Mont-Saint-Michel. C’est Avranches où, devant le portail de la cathédrale le puissant Plantagenet Henri II s’humilia après le meurtre de Thomas Becket. Les Avranchais ne furent pas toujours pacifiques. En 1639, ils se révoltèrent contre la gabelle et leur chef fut dur à soumettre. |
||||||||||
|
||||||||||
|
Pays de Caux, Pays d’Ouche, Vexin normand… dans cette grasse Normandie, les villes s’animent les jours de marché. Évreux possède une magnifique cathédrale. Les Andelys sont réputés par leur situation près d’un méandre de la Seine. Gisors, c’est la citadelle avancée de la Normandie tournée contre la France capétienne. C’est la clé du Vexin normand. Plantagenets et Capétiens se disputèrent la forteresse pendant un siècle. Aujourd’hui, c’est une ruine somptueuse, un donjon massif entouré d’une enceinte encore flanquée de tours. L’une d’elles, la « tour du prisonnier », est ornée de curieux bas-reliefs sculptés par un captif
Au-delà de Louviers, on pénètre en Pays de Bray, dont les vallons s’entourent de ruisseaux et enrichissent le terroir de pâturages qui permettent l’élevage des vaches laitières productrices de beurres et de fromages réputés.
Au sud du Pays de Bray, on entre en Pays de Caux avec Yvetot, célèbre par son roi ! Elbeuf fut une riche cité drapière dès le XVIe siècle. Lisieux vécut pendant des siècles d’une existence relativement paisible depuis sa conquête par Philippe Auguste en 1203. Il y eut la tourmente de 1944. |
 DIEPPE 1880 |
|||||||||
|
Mais Lisieux est devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté où lespèlerins honorent la très aimée « petite Thérèse ». C’est à Lisieux qu’en 1154, Henri II Plantagenet épousa Aliénor d’Aquitaine, mariage catastrophique pour le royaume de France. Bayeux conserve un visage tranquille. La broderie de la reine Mathilde (improprement nommée tapisserie), continue à narrer les péripéties de la conquête de l’Angleterre. La cathédrale est, avec celle de Coutances, l’une des plus belles de Normandie : l’art ogival normand s’y épanouit dans toute sa splendeur. Livre d’images grandiose qu’on ne se lasse pas de contempler !
Aux confins du Perche et du Bocage normand, Alençon étend ses rues paisibles où d’habiles dentellières maintinrent longtemps une tradition qui fit la renommée de la ville. Pour accueillir les princes, l’échevin Jean du Mesnil avait fait construire en 1450 la maison d’Ozé. Non loin de là, Flers fut prospère avec ses tissages de toile et ses filatures de coton.
Au milieu de plantureux pâturages et de vergers de pommiers, Vimoutiers produisit l’authentique, le délicieux, l’inégalé camembert de Normandie. |
||||||||||
|
||||||||||
|
Le Mont-Saint-Michel est la plus célèbre. Elle fut fondée en 708 par Aubert, évêque d’Avranches, sur l’ordre de saint Michel archange qui indiqua le roc où il entendait qu’on lui élevât un sanctuaire.
En 966, les Bénédictins s’établissent au Mont. Après un incendie en 1203, l’abbé Jourdain jette les fondations de cet admirable ensemble, la « Merveille de l’Occident ». Le cloître, entrepris en 1228, semble suspendu entre ciel et terre comme un coin du paradis.
Jumièges est une ruine émouvante. Saint Philibert la fonda en 654.
Guerre de Cent Ans, guerres de Religion, elle connut toutes les épreuves et pour finir, les marchands de biens la dépecèrent sous la Révolution. Un parc ombragé drape de verdure les restes de la nef, des arcades et des tours carrées.
Saint-Wandrille est voisine, fondée en 648 par un disciple de saint Colomban sous le nom de Fontenelle. Elle connut la décadence dès le XVIe siècle et fut rétablie au XVIIe siècle par les Bénédictins réformés de saint Maur. Maurice Maeterlinck y habita longtemps. |
 LONGUEVILLE 1880 |
|||||||||
|
||||||||||
|
Donjons en ruines, envahis par la végétation, hantés par hiboux et chouettes, courtines croulantes entre deux oubliettes, la Normandie, terre foulée dès le VIe siècle par les envahisseurs, en possède un nombre imposant.
Ainsi de cet imprenable Château-Gaillard qui fermait contre le Capétien la frontière normande, dans une boucle de la Seine, au-dessus des Andelys, sur un promontoire rocheux. Démantelé, déchiqueté, il témoigne encore de l’indestructible puissance des forteresses médiévales.
Arques, que l’on appelle Arques-la-Bataille depuis la victoire d’Henri IV sur le duc de Mayenne en 1589, fut édifié en 1123. Le château fut dépecé au XIXe siècle mais ce qu’il en subsiste est impressionnant. Le pont de Tancarville
n’est pas loin, non plus que ce Villequier dont le nom est désormais lié au funèbre poème de Victor Hugo.
Pour apprécier la beauté de la Normandie, il ne suffit pas d’admirer les majestueuses églises abbatiales et les forteresses. |
 CHERBOURG 1880 |
|||||||||
|
C’est souvent dansd’humbles sanctuaires de village qu’on découvre toute la pureté du style normand tant roman que gothique. La Normandie est une terre d’une extraordinaire richesse artistique et, malgré les destructions subies, cette vieille province française peut s’enorgueillir du magnifique patrimoine que les siècles lui ont légué. Et puis, il y a la nature ! |
||||||||||
|
||||||||||
|
Campagne et bocage, deux types extrêmes de paysages normands ! C’est d’abord le Vexin normand, plateau calcaire au limon épais très favorable au blé. Puis voici le Pays de Caux au vaste plateau crayeux limité au sud par la vallée de la Seine et du côté de la mer, par ses célèbres falaises festonnées de valleuses. À Étretat, la Falaise d’Amont et la Falaise d’Aval si joliment peintes par Claude Monet, encadrent une plage de galets.
L’Aiguille, haute de 70 mètres, se dresse au large, solitaire, et inspira Maurice Leblanc pour son roman L’Aiguille creuse. Le long de cette côte joliment nommée Côte d’Albâtre, on cultive le lin, arraché à la machine puis laissé sur le sol, où, bien étalé, il subit le rouissage.
Les falaises de la côte du Calvados sont interrompues par des dunes et des marais. À l’est, les plages de la Côte Fleurie – Deauville, Trouville, Cabourg –offrent leurs étendues de sable fin. À l’ouest, entre l’Orne et la Vire, s’étend la Côte de Nacre au climat tonique.
La presqu’île du Cotentin avec ses anses rocheuses, évoque la Bretagne mais on y rencontre aussi des plages de sable et des dunes. |
 DIEPPE 1880 |
|||||||||
|
Quant à la baie du Mont-Saint-Michel, elle se couvre de grèves immenses à perte de vue, toujours hantées par la Fée des Grèves de Paul Féval.
Le bocage, on va l’admirer en pays de Bray et en pays d’Auge. Un quadrillage de haies, dressées sur des levées, cerne les prés et les champs et cloisonne à l’infini le terroir qui, de loin, semble boisé. Le Pays d’Auge est le domaine des pommiers dont la floraison est une véritable féérie. Les variétés tardives donnent des pommes dures qui se conservent pendant des mois. Dans les haies, hérissons, lézards, couleuvres, petits rapaces, font bon ménage et se partagent la grasse provende des portées de mulots et de campagnols qui, sans ces prédateurs, seraient de véritables fléaux pour les cultures.
Et peut-on quitter la Normandie sans évoquer les chevaux ? Pur-sang anglais, trotteurs français, selle français et anglo-arabes, cobs, percherons, vivent là dans les haras privés et les haras nationaux du Pin et de Saint-Lô. Chaque année, fin août, a lieu à Deauville la vente des poulains pur-sang anglais d’un an et demi, les « yearlings », et c’est un événement capital d’une portée internationale.
Attachante Normandie ! Baudelaire composa à Honfleur son Invitation au Voyage. Et le dernier mot sera pour le Normand du Chamblac, Jean de La Varende. Voici comment il fait allusion à un climat qui n’est pas toujours facile : « Dans l’Ouche, qui n’entretient pas chaque année, voit mourir. La pluie… les vents… ! Les chemins se rétrécissent et il ne faut que deux ans pour faire d’un potager une pâture. » (Pays d’Ouche) |
||||||||||
|
||||||||
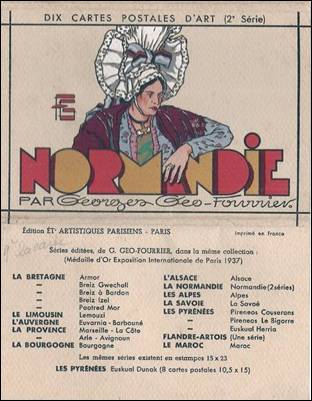 |
||||||||
|
NORMANDIE Coiffes et costumes FOURRIER, Georges (1937) |
||||||||
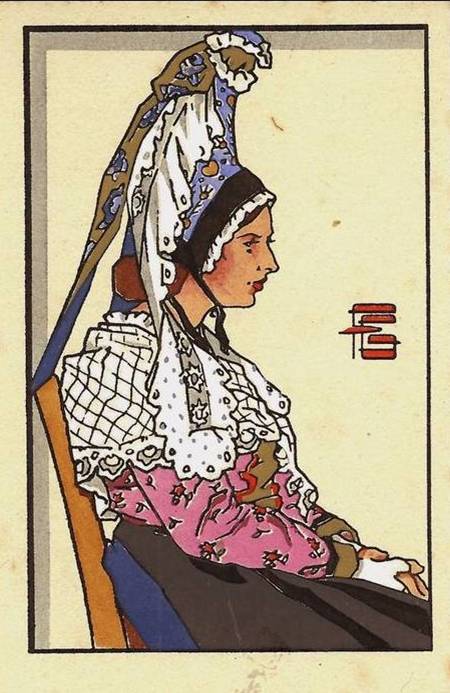 |
||||||||
| N°1 - JEUNE FEMME DE CAUDEBEC-EN-CAUX | ||||||||
 |
||||||||
| N°2 - JEUNE FEMME DE CHAMPSECRET | ||||||||
 |
||||||||
| N°3 - JEUNE FEMME DE ROUEN | ||||||||
 |
||||||||
| N°4 - JEUNE FILLE DE PUTANGES | ||||||||
 |
||||||||
| N°5 - BOURGEOIS DE DOMFRONT | ||||||||
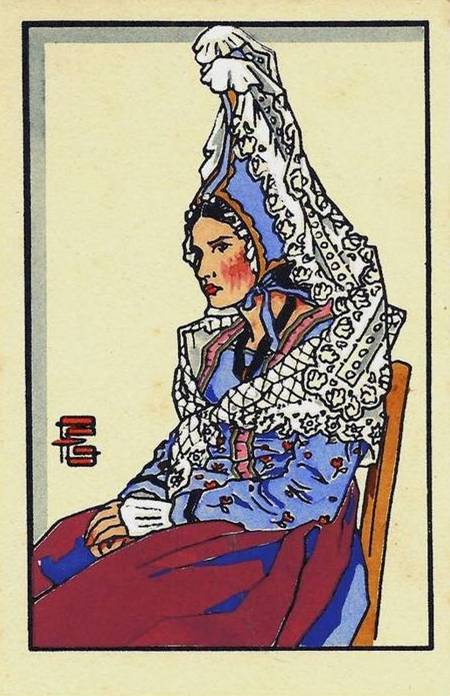 |
||||||||
| N°6 - JEUNE CAUCHOISE | ||||||||
 |
||||||||
| N°7 - JEUNE FEMME, REGION D'HONFLEUR | ||||||||
 |
||||||||
| N°8 - JEUNE BOURGEOISE DE DOMFRONT | ||||||||
 |
||||||||
| N°9 - RICHE PAYSAN DE SAINT FRONT | ||||||||
 |
||||||||
| N°10 - FERMIER NORMAND | ||||||||
| ||||||||
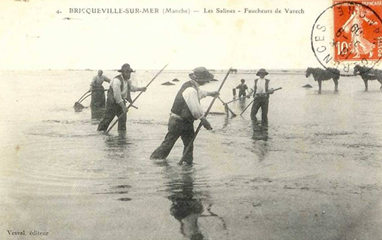 Bricqueville sur Mer faucheurs de varech. Collection CPA LPM 1900 | ||||||||
| DIDEROT & d’ALEMBERT Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 1751-1770 | ||||||||
| ANCIENNE COUTUME DE NORMANDIE
VARECH, (Jurisprudence) l'ancienne coutume de Normandie dit que tout ce que l'eau de la mer aura jetté à terre est varech : la nouvelle coutume comprend sous ce terme tout ce que l'eau jette à terre par la tourmente & fortune de mer, ou qui arrive si près de terre, qu'un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance. | ||||||||
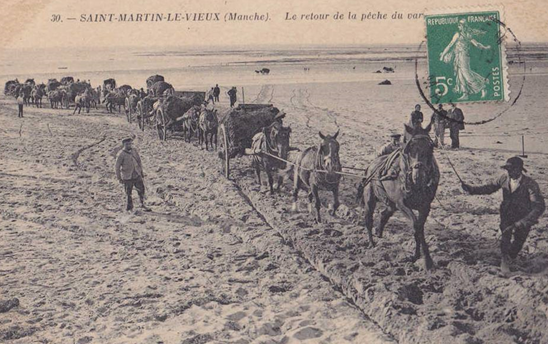 Retour de pêche au varech à Saint Martin de Bréhal, Collection CPA LPM 1900 | ||||||||
|
||||||||||
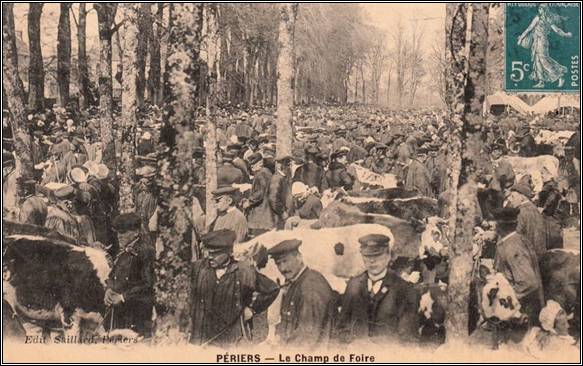 |
||||||||||
|
Periers jour de foire, CPA collection LPM 1900 |
||||||||||
|
Foires et assemblées en Normandie Guide du touriste en Normandie Auteur Emile Tessier 1864
Rien n'est plus curieux que les foires et les assemblées en Normandie. C'est là que l'on retrouve les anciens usages et les costumes originaux du paysan, qui disparaissent tous les jours. Dès le matin de ces réunions champêtres, les routes sont couvertes de voitures chargées de femmes et d'enfants, de boeufs, de moutons, de chevaux et d'animaux de toute sorte, qui se précipitent en tumulte dans un vaste champ préparé à l'avance, au milieu des cris et des jurons de leurs conducteurs. De longues tentes en grosse toile, pourvues d'abondantes provisions, et laissant voir d'énormes tonneaux de cidre à dépotayer, sont dressées sur les côtés du terrain réservé à la fête. Elles fourniront à la consommation des villageois, et retentiront bientôt du choc des verres, de chants nationaux, et des discussions frénétiques que le cidre, servi dans de vastes puchés (vases en terre), fait souvent naître, à la suite de libations trop copieuses et trop souvent répétées. Car le paysan normand, pour nous servir d'une expression du pays, boit sec, c'est-à-dire beaucoup. Dans ces assemblées tumultueuses, nos belles paysannes elles-mêmes tiennent tête à leur mari sous la tente, en trinquant fréquemment, et prouvent leur force physique, en se frayant, bon gré mal gré, un large chemin au travers de la cohue des promeneurs. A la fin de la journée, les sons d'un orchestre composé en général d'une clarinette, d'un tambour et d'une grosse caisse, attirent la jeunesse dans un verger, dont le sol, souvent humide, cède sous les pieds des danseurs, et occasionne des chutes parfois grotesques. Ce bal en plein air, éclairé par quelques lanternes de couleur suspendues aux arbres, termine habituellement la fête dans chaque village. |
||||||||||
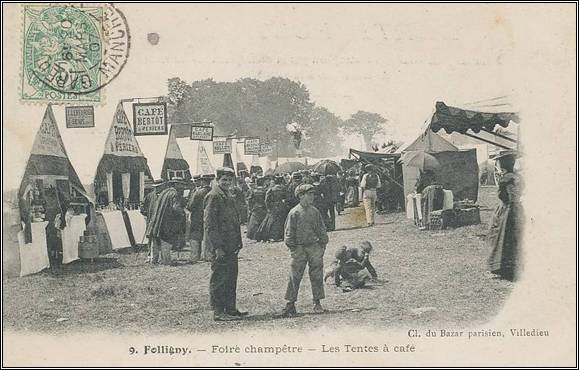 |
||||||||||
|
Folligny jour de foire, CPA collection LPM 1900 |
||||||||||
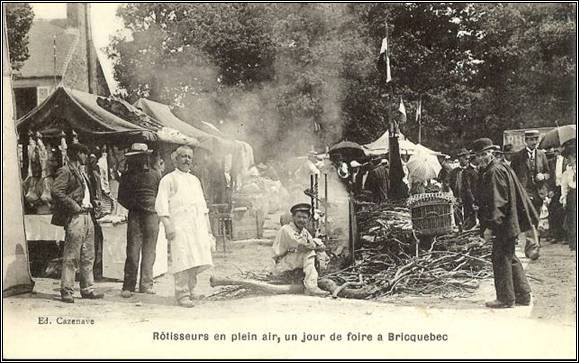 |
||||||||||
|
Folligny jour de foire, CPA collection LPM 1900 |
||||||||||
|
||||||||||
|
Les soirées d'Hiver en Normandie par l'Abbé Léonor Blouin. 1901
L'aïeul assis dans un large fauteuil tient sur ses genoux l'avant-dernier de ses petits garçons qui s'amuse à dérouler les boucles argentées des cheveux de son grand-père.
Un espiègle de sept ans qui s'est permis de tirer l'oreille de son chaton noir pousse les hauts cris parce que l'animal à bout de patience s'est défendu d'un coup de griffe. Le nouveau-né n'est tranquille que si la mère penchée sur son berceau vient lui chanter do-do. La soeur aînée répare les bas de laine des nombreux frères, sans aucun regret de n'être pas fille unique. Et l'arrière-grand-mère repasse avec une douce mélancolie les années lointaines de sa jeunesse en faisant tourner son rouet vermoulu. |
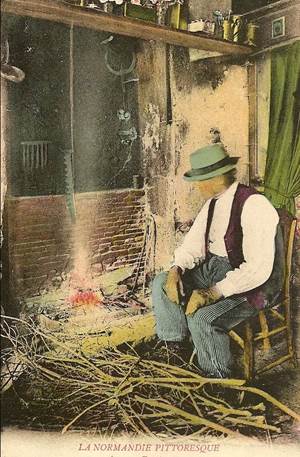 CPA collection LPM 1900 |
|||||||||
|
C'est l'heure où les domestiques tressent leurs chapeaux, où le berger hache betteraves et navets pour le bétail; quant à la servante voici qu'elle épluche tranquillement les légumes pour la soupe du lendemain.
La lumière ne coûte pas cher dans notre atelier du soir: une longue résine, suspendue à la muraille, à l'aide d'une pince de bois consumé péniblement sa mèche fumeuse et répand une lueur jaunâtre sur le visage des travailleurs.
Dans l'âtre, le châtaignier pétille – c'est un méchant bois de chauffage- l'ajonc épineux crépite avec une violence qui ne dure qu'un moment, juste le temps d'éclairer ceux qui serait en train de bâiller par suite d'un vieil usage.
Au surplus voici une opération qui a toujours été incompatible avec l'ennui, je veux dire la manducation des châtaignes harassées. Une poêle à frire, à long manche de fer ou même de bois, est percée à l'aide d'un poinçon gros comme le doigt, de quelques dizaines de trous ou pertuis circulaires. C'est, on le voit, un instrument d'une simplicité primitive, et il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pu préciser l'époque de son invention ni citer le nom de son auteur.
La soirée du dimanche est choisie de préférence pour le repas de châtaignes. On n'appelle cela ni souper ni collation et pourtant c'est souvent l'un et l'autre, car il n'est pas rare de mettre deux fois la harassoire sur le feu dans la même soirée. Qui donc pourrait demeurer indifférent à ce spectacle capable de captiver nos yeux et nos oreilles et de produire en même temps dans les estomacs une attente si légitime! Le maître de maison harasse lui-même les marrons qu'un ouvrier maladroit pourrait laisser tomber dans le feu.
À propos de ce maître cultivateur, je crois utile d'ouvrir ici une parenthèse pour dire que jamais les anciens ne le désignaient d'un autre nom que celui de bourgeois. C'est avec un regret des plus vifs et un étonnement pénible que les personnes sages voient s'introduire chez nous l'habitude blâmable de décerner le titre de patron au maître de maison, cultivateur, fermier ou propriétaire. Le mot patron, quand il désigne l'artisan, chef d'atelier, est certainement très noble et sans reproche, mais il dévie du pur argot absolument répréhensible quand on l'adresse au bourgeois laboureur.
Il faut donc espérer que nos concitoyens reconnaîtront le bien-fondé de ces observations, et qu'ils voudront revenir franchement au langage de nos ancêtres. Oui, oui parlons comme nos pères!
Donc le bourgeois fait cuire les châtaignes. Un fagot de chêne flambe sous la poêle. La chaleur s'introduit par les trous multipliés; les châtaignes sautent en l'air et retombent avec un ensemble parfait, faisant entendre un bruit rauque ressemblant assez au cri du râle dans nos prairies à la fin d'avril. La cuisson s'opère, la décortication se produit. Parfois un marron plus coriace ayant accumulé sous son enveloppe un gaz abondant se déchire tout à coup: l'explosion s'accompagne d'une détonation épouvantable aux plus jeunes de la famille!
Chaque fois qu’on sert des châtaignes harassées, c'est un régal pour les jeunes gens qui ont complété leur râtelier dentaire. Quant aux plus âgés de la famille, aux vieillards, c'est surtout pour eux un prétexte de boire du cidre nouveau, car personne n'ignore que nos marrons farineux donnent la soif.
Voici nos gens rangés en cercle autour du foyer: au milieu, un canot plein de châtaignes fumantes, la cruche au cidre et la tasse, tels sont les objets sur lesquels convergent tous les regards. |
||||||||||
 CPA collection LPM 1900
|
||||||||||
|
||||||||||
|
LA NORMANDIE ANCESTRALE Ethnologie, vie, coutumes, meubles, ustensiles, costumes, patois Stéphen Chauvet. Membre de la Commission des Monuments historiques Edition Boivin, Paris.1920 |
||||||||||
|
Mariage.
— Le mariage civil est accompli sans bruit comme une formalité qui n'engage point, et les noces ne commencent que la veille du mariage à l'église, le seul regardé comme légitime. Le matin, les parents de la future montent dans une charrette traînée par des chevaux ou des bœufs et, accompagnés d'un ménétrier qui sonne du violon, vont chercher le trousseau chez la belle-mère pour le transférer chez le bruman (fiancé; de bru, et de man, homme).
Une énorme armoire sculptée est bientôt chargée sur la voiture, au-devant de laquelle la sœur ou simplement la couturière de la mariée s'assied sur des oreillers destinés au lit nuptial, tenant sur ses genoux un rouet et une quenouille, symboles des occupations domestiques Chemin faisant, la couturière distribue des paquets d'épingles aux jeunes filles qu'elle rencontre.
Assez fréquemment, la noce va à cheval à l'église, les femmes assises sur la croupe, en arrière du « maître ». Les deux époux se placent au milieu de l'église, sous un crucifix pendu à la voûte, y reçoivent la bénédiction nuptiale, entendent l'évangile au maître-autel et font une station à l'autel de la Vierge pour y déposer leurs cierges. |
 |
|||||||||
|
On sort de l'église au bruit des coups de fusils et des pétards; le convié le plus alerte présente la main à la mariée, la fait danser un moment et en reçoit un ruban; un second ruban est la récompense de celui qui la remet en selle.
Dans les préparatifs du mariage, le transport du trousseau de la future mariée signalé ci-dessus, constituait à lui seul une cérémonie qui se déroulait selon des rites charmants. L. Beuve a recueilli, à Vesly, de la bouche d'une vénérable octogénaire le récit de cet événement, car c'en était un dans un bourg et on en « jasait » longtemps encore après les noces. Ce récit figure dans le numéro du Bouais Jan du 8 août 1898 (p. 103) :
« Le trousseau de la mariée arrivait, en voiture, huit jours avant la noce, marchant au pas, lentement, le long des bourgs, pour s faire bi guetta L'armoire, la vénérable armoire normande, trônait, bien en vue, au mitan de la quertée de meubles, telle une reine parmi ses sujets. Le grand caoudron, la paesle, le biaux mireux, étaient aussi mis en valeur, artistement disposés, suivant les règles plusieurs fois séculaires, que se transmettaient de génération en génération, les couturières. La quenouille et le rouet y figuraient aussi. Ils étaient soigneusement enrubannés. Après la noce, la jeune mariée allait suspendre sa quenouille à l'autel de la bouiïvirge. Aujourd'hui, ajoute le poète, on ne file plus et l'on remplace la quenouille par un vulgaire bouquet. » |
||||||||||
|
Le trousseau de la mariée arrivait, en voiture, huit jours avant la noce |
||||||||||
|
Les mariés recevaient de leurs parents et amis quelques cadeaux parmi lesquels une houe, un louchet (un truble), une braie à filasse, un carrosse à laver et son battoir, emblèmes du travail que la jeune mariée devait exécuter clans son ménage. Le D r E. Ozenne rappelle qu'on « procédait minutieusement à la toilette de la mariée, sans oublier d'attacher derrière la coiffe, au-dessus du chignon, un petit miroir encadré de chenille verte et une rose blanche. Ces objets s'appelaient la relique. C'était l'emblème de la virginité. Le lendemain du mariage, la relique était placée à la tête du lit des époux : la rose s'était épanouie... »
Après la cérémonie religieuse le cortège, précédé du ménétrier, se rendait à pied à la salle du repas si elle était proche. Sinon, comme il n'y avait guère de voitures à cette époque et que les chemins étaient en très mauvais état, on se rendait à cheval au lieu du festin, chacun ayant sa chacune en croupe. Et c'était de par les champs et les chemins, une pimpante cavalcade, égayée des rires des paysannes casquées de belles coiffes (les comètes) dont les grandes ailes blanches et les rubans flottaient au vent.
Au festin, la bru (la mariée) se plaçait au centre. Derrière elle, était tendu un drap blanc sur lequel étaient attachés les bouquets de mariage enguirlandés de feuillage, de fleurs champêtres et de roses, et de flots de rubans blancs. Les invités se plaçaient selon leur bon plaisir. Le repas était copieux. De belles poulardes, rissolées à point, quittaient la broche qui les faisait tourner sans cesse devant une belle flambée de genêt, pour être découpées et passées parmi les invités, sur de grands plats de compagnie ornés de dessins bleus. Le bon bère, de pur jus, était versé à pleins connots, dans de biaux godias de cérémonie, par de nombreux valets et aussi... par le bruman (le marié) qui, selon l'usage, revêtu d'un tablier et les manches retroussées, servait les gens de la noce! Des chants, des divertissements animaient la fin du repas. Lorsque ce dernier était terminé, tout le monde allait faire un petit tour en plein air, de par les prés et les plants, puis on revenait souper. Enfin arrivait l'heure de la danse qui durait, généralement, pendant presque toute la nuit. Au petit jour les invités partaient; il ne restait que les amis intimes; ceux-ci allaient porter aux mariés, qui s'étaient retirés pendant la fête, des rôties contenues dans une écuelle d'étain à oreilles qu'on avait maintenue au chaud, devant l'âtre flamboyant, dans la corbeille d'un des landiers. Ce rite était l'occasion de quelques plaisanteries. Puis la chambre se vidait, et pendant que l'aurore se levait, les jeunes mariés pouvaient, enfin, goûter, loin du bruit, un sommeil réparateur.
Au cours du chapitre suivant, on verra que le trousseau de la mariée, ce trousseau qui était l'œuvre de tant de veillées et qui comportait des vêtements et des coiffes si seyantes, était livré la veille des épousailles.
Maintenant, hélas! tout cela est bien tristement modifié. Le trousseau est acheté, tout fait, dans un magasin de nouveautés, de la petite ville voisine. Les coiffes, les fichus ont disparu ainsi que le rouet. La belle armoire de chêne sculpté est remplacée soit par une armoire à grands panneaux tout unis, en bois blanc (peint de façon à imiter les nervures du bois), ou bien, si les futurs époux sont aisés, par une armoire à glace, « le plus platement hideux de tous les meubles », au dire de Banville. Le jour du mariage, la mariée, habillée de soie et portant simplement un voile blanc au-dessus de son chapeau (!) prend place dans la voiture à deux roues qui sert à aller au marché, à côté de son époux, habillé d'un veston foncé (orné à la boutonnière d'un petit bouquet de fleurs d'oranger) et coiffé d'un chapeau melon. Les invités de la noce suivent dans d'autres voitures. La couturière qui a fait la robe de la mariée, a encore, cependant, un petit privilège. Elle fleurit de petits bouquets de fleurs d'oranger les personnes de la noce et parfois celles qu'elle rencontre sur la route qui mène à l'église, et reçoit, en échange, une obole.
Mais où sont les beaux meubles et les délicieuses coutumes du vieux mariage d'antan? |
||||||||||
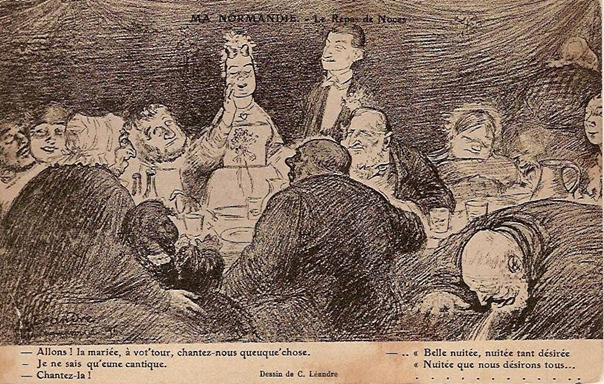 |
||||||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le paquebot NORMANDIE Texte issu de WIKIPEDIA
Le Normandie est un paquebot transatlantique de la Compagnie générale transatlantique, construit par les Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire.
Souvent cité comme le plus beau paquebot jamais construit, c'était aussi le plus grand à sa sortie du chantier en 1932. Après seulement quatre ans de service, il est réquisitionné par la marine des États-Unis afin d'être converti en transport de troupes d'une capacité de plus de 10 000 soldats. Durant des travaux dans le port de New York, un incendie se déclare en 1942 et le paquebot chavire sous le poids de l'eau déversée par les pompiers. Renflouée, l'épave est ferraillée en 1946. Normandie laisse le souvenir d'un âge d'or des transatlantiques luxueux, dont le Queen Mary 2 est aujourd'hui l'héritier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Normandie (1935-42) La Fayette (1942-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAISSANCE
La Compagnie générale transatlantique termine l'année 1928 sur un bilan exceptionnel. Les jours de guerre sont loin, le prestigieux Île-de-France est le paquebot le plus apprécié de la clientèle nord-américaine qui vient voyager en Europe ; en un mot, les bénéfices sont florissants. John Dal Piaz, président de la Compagnie générale transatlantique de 1920 à 1928, voit plus loin et décide la construction d'un paquebot encore plus grand, encore plus rapide, encore plus beau : ainsi naît le projet T6, dont la commande est passée le 20 octobre 1930.
Le projet subira de nombreux avatars, l'un des premiers et non des moindres étant la crise de 1929. L'économie s'effondre, de même que les recettes de la Transat. Le navire manque d'être abandonné mais l'État, pour sauvegarder les emplois dus à la construction ainsi que le prestige national que représente la compagnie, décide de renflouer la Transat. Le gouvernement fait voter des subsides et la Compagnie devient une société d'économie mixte. Ainsi la construction du T6, dont le nom n'est pas encore décidé, peut continuer.
Le nouveau paquebot est si grand que les chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire doivent construire une nouvelle cale, creuser le plateau rocheux situé dans l'estuaire de la Loire pour permettre le lancement du navire, et construire une nouvelle écluse. Le port du Havre, future base du T6, doit également construire une nouvelle jetée pour permettre au géant d'entrer dans le port, et celui de New York doit construire un nouveau môle, le Pier 88, pour l'attribuer à la « French Line ».
Le 26 janvier 1931, la première tôle de la quille est mise en place. La construction continue à un rythme soutenu. Le nouveau paquebot rassemble une brassée d'innovations technologiques (coque, propulsion, etc.) qui font de lui le fleuron de la technologie française. C'est à cette période que la Transat nomme finalement son vaisseau amiral. L'appellation Président Paul-Doumer, un temps envisagée, est abandonnée lorsqu'on découvre que sa prononciation en anglais rappelle fâcheusement le mot doomed (« condamné à un destin tragique »). Le nom de Normandie, évocateur de l'ancienneté de la France et facilement prononçable dans toutes les langues, est finalement retenu.
Le 29 octobre 1932, le paquebot est lancé en présence d'Albert Lebrun, président de la République, et de son épouse, marraine du navire. L'armement est poursuivi à flot puis, le 5 mai 1935, Normandie prend la mer pour effectuer ses premiers essais sur la base des Glénan. Ceux-ci sont extrêmement concluants. La vitesse maximale, supérieure à 32 nœuds, fait du navire le premier prétendant français crédible au très convoité Ruban bleu. Lancé à pleine vitesse, Normandie effectue un arrêt d'urgence en seulement 1 700 mètres, soit moins de six longueurs de carène. L'innovant mode de propulsion par turboalter-nateurs donne entière satisfaction. Aucun incident ou avarie n'est à déplorer excepté... un peu de vaisselle brisée. Seules des vibrations importantes dans le tiers arrière seront à signaler. Elle seront éliminées par l'adoption de nouvelles hélices après la première saison.
Une carrière d'exception peut commencer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquebot Normandie, collection CPA LPM 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| CARRIERE
Normandie arrive au Havre le 11 mai 1935 à 19 heures sous l’accueil enthousiaste des Havrais. Suivent les cérémonies de l’inauguration. On en profite pour inaugurer la gare maritime nouvellement construite.
Et le mercredi 29 mai 1935, à 18 heures, c'est l'appareillage pour la première traversée commerciale. Dans la matinée du 30, Normandie passe Bishop Rock, repère officiel de départ pour l'attribution du Ruban bleu. Le lundi 3 juin, le navire passe le repère d'arrivée d'Ambrose, à l'approche de New York. Il a parcouru 2 971 milles en quatre jours, trois heures et deux minutes, à la vitesse moyenne de 29,94 nœuds. Le record du paquebot italien Rex est battu, le Ruban bleu est français pour la première fois. Il flotte glorieusement, long de trente mètres, au grand mât.
Durant l'hiver 1935-1936, Normandie est légèrement modifié. Pour atténuer les vibrations ressenties par les passagers de l'arrière, les hélices sont changées. Les passerelles de manœuvres en encorbellement sont remplacées : à l'origine de forme courbe elles prolongeaient la passerelle de commandement mais sont remplacées par des passerelles droites plus adaptées aux manœuvres. Un salon est aménagé sur le pont arrière, ce qui alourdit un peu la silhouette jusque là si gracieuse. Puis le navire reprend le service. | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Le Normandie de la Cie Générale transatlantique. carte Voyage inaugural | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Arrivé du Normandie à New-York lors de sa première traversée. | ||||||||||
| De 1936 à 1939, Normandie s'impose comme l'étalon du confort et du luxe transatlantiques. Le gratin des sociétés française et américaine prend pension dans le magnifique intérieur Art déco, goutant une cuisine digne des plus grands restaurants parisiens. Le personnel de la Transat, attentif à l'extrême à ses clients sans jamais verser dans la familiarité, ne contribue pas peu à la renommée du navire et fait naitre la légende du service « à la française ». Pendant ces années fastes, Normandie livre une lutte épique à son grand rival britannique le Queen Mary, lui cédant puis lui reprenant le Ruban bleu avant de le lui abandonner définitivement en 1938.
En janvier 1938 Normandie débute l'année par une croisière New York-Rio-New York, qui déclenche un énorme engouement. Le paquebot n'est pas conçu pour ce genre de voyage (absence de climatisation) ; cette croisière est néanmoins un succès, et sera reconduite l'année suivante.
Le 30 août 1939, Normandie accoste à New York dans un climat politique irrespirable. Le pacte germano-soviétique, signé une semaine plus tôt, a rendu la guerre avec l'Al-lemagne quasi-certaine. Quatre jours plus tard, c'est chose faite alors que Normandie est encore à quai. Les autorités françaises ne demandant pas la conversion du navire en transport de troupes, la Transat décide de le désarmer sur place pour lui éviter un hasar-deux retour sous la menace des sous-marins allemands et de possibles dégâts en cas d'attaque ennemie sur Le Havre. Le 6 septembre, le personnel retourne en France hormis un équipage de veille.
L'arrêt du trafic transatlantique et la défaite de juin 1940 mettent la Transat en situation financière précaire. Les salaires des marins restés à New York ne sont plus assurés. Pen-dant plus d'un an, ceux-ci survivront grâce à l'aide des autorités consulaires et de nom-breux gestes de sympathie de la communauté française de New York, sous l'œil quelque peu soupçonneux d'une Amérique encore en marge du conflit. Tout change après la dé-claration de guerre faite aux États-Unis par l'Allemagne le 11 décembre 1941, quatre jours après Pearl Harbor. Normandie, ne battant pas pavillon de la France libre, est juri-diquement rattaché au régime de Vichy et devient donc une prise de guerre légitime. Le 16, un détachement de la marine américaine investit le navire, évacue de force l'équipage français, et amène le pavillon tricolore pour hisser à sa place le drapeau américain. Les travaux débutent pour transformer Normandie, rebaptisé La Fayette le 1er janvier 1942, en transport de troupes.
Le détachement améri-cain en charge du navire n'assure qu'une veille des plus sommaires, débran-chant entre autres les systèmes de sécurité dont il a négligé de s'informer.
L'inévitable drame éclate le 9 février 1942. Un ouvrier travaillant au chalumeau dans la salle à manger des premières classes met accidentellement le feu à un stock de gilets de sauvetage en kapok temporairement entreposé là. L'incendie, alimenté par les nombreuses boiseries non encore démontées, se propage rapidement. Les marins français, accourus sur place pour proposer leur aide, se voient refoulés par la police militaire. Les pompiers new-yorkais ne peuvent intervenir directement à bord, car le type d'embouts de leurs lances à incendie est incompatible avec celui du système de lutte contre l'incendie du navire. Ils ne peuvent attaquer le feu que de l'extérieur, à l'aide de bateaux-pompes et de lances alimentées depuis la jetée. De plus un froid polaire gèle l'eau dès son arrivée sur le pont. En conséquence, une grande quantité des 6 000 tonnes d'eau déversées se retrouve sous forme de glace accrochée aux superstructures du bateau, déséquilibrant celui-ci et entrainant son chavirement le 10 février à 2h45.
(L'origine de ce désastre est aussi attribuée selon certaines sources à un acte de sabotage d'agents allemands opérant sur le territoire américain, ou à une manœuvre de la mafia afin d'obliger les autorités à négocier la protection des docks et aussi de réduire la peine de Lucky Luciano.) | ||||||||||
|
USS Lafayette en feux entouré de bateaux pompes | ||||||||||
| Après de longues réflexions, le La Fayette est remis à flot le 27 octobre 1943. Il est alors jugé irréparable en raison des dommages irréversibles subis par la machine et une partie de la structure après un an et demi en immersion.
Le 3 octobre 1946, l'ex-Normandie est vendu à un ferrailleur de New York, l'entreprise Lipsett, pour 161 680 dollars. Il est entièrement démantelé. | ||||||||||
|
USS Lafayette couché après l'incendie | ||||||||||
| ||||||||||
|
Élévation et coupe longitudinale | ||||||||||
| L'ARCHITECTURE
Durant la période de dessins et d'essais de maquettes, les concepteurs de Normandie reçurent la visite d'un jeune émigré russe, Vladimir Yourkevitch. Celui-ci leur proposait un nouveau modèle de coque, dessiné par lui, et qui disait-il était très performant.
Sans grande attention, les ingénieurs testèrent le modèle de Yourkevitch, qui à leur stupéfaction se révéla bien meilleur que les maquettes réalisées par eux. Yourkevitch fut donc associé au projet et participa au dessin de la carène. Celle-ci se caractérisait par une rentrée des parois de l'avant, là où les paquebots précédents étaient plutôt renflés. Ceci permettait une meilleure pénétration de la coque mais un léger déséquilibre qui fut compensé par un bulbe situé sous l'étrave. Celle-ci, au lieu d'être verticale, était incurvée. Tout ceci faisait que le paquebot avait tendance à piquer dans les vagues, ce qui nécessita la construction d'un brise-lame sur la plage avant. Mais toute cette architecture permit d'utiliser une surface beaucoup plus importante pour construire les aménagements. Ceci donnait à Normandie un aspect assez trapu, atténué par l'arrondi des passerelles avant. L'arrière s'étageait en majestueux encorbellements
Trois cheminées surmontaient l'ensemble. À l'origine, elles devaient être de type normal (cylindrique). C'est l'artiste Marin-Marie qui, alors qu'il devait dessiner une vue du futur paquebot, s'insurgea et dessina trois cheminées à la section en goutte d'eau (donc aéro-dynamique) et qui s'étageaient vers l'arrière. La troisième cheminée était factice, pour équilibrer l'ensemble, et abritait le chenil. Enfin le mât principal, plutôt que de se situer devant la passerelle et gêner la visibilité, avait été situé sur celle-ci.
Tout ceci concourait à donner à Normandie une silhouette novatrice pour l'époque et résolument moderne. Tous les paquebots construits depuis se sont inspirés de leur illustre prédécesseur.
La propulsion
L'appareil propulsif de Normandie incluait les dernières innovations techniques de l'époque. Comme sur toutes les grandes unités du moment, il s'agissait d'un navire dont la propulsion était assurée par la vapeur. Celle-ci était produite par 29 chaudières de type Penhoët à « tubes d'eau ». Cependant, à la différence de ses concurrents, Normandie utilisait une transmission électrique : la vapeur produite se détendait dans des turbines couplées à des alternateurs. Le courant ainsi produit alimentait des moteurs électriques qui pouvaient être alimentés par n'importe lequel des alternateurs. Ainsi, la marche arrière s'obtenait par simple inversion de l'arrivée de courant aux bornes des moteurs. Bien que ce mode de transmission ait déjà existé à l'époque, il n'avait jamais été monté sur une unité aussi importante. Cette solution avait été choisie assurait une grande souplesse des machines.
• Les chaudières
Il y avait sur Normandie 29 chaudières principales de type Penhoët, à tubes d’eau (la fumée et les gaz chauds circulent autour de tubes contenant l’eau à vaporiser). Le rendement de chauffe était de 88,5 %. Les chaudières fonctionnaient au mazout et leurs masses à vide atteignaient 100,5 t. Elles possédaient 4 brûleurs à pulvérisation mécanique et une surface de chauffe de 1 000 m², fournissant de la vapeur surchauffée à 360 °C sous une pression de 28 kg/cm². La vapeur était récupérée par 4 collecteurs et passait ensuite dans les turbines.
• Les turbines
Normandie comportait 4 turbines principales. Chacune disposait de 19 étages (un étage représentant un aubage fixe et un aubage mobile) de type à action (la vapeur se détend dans l’aubage fixe et l’aubage mobile utilise l’énergie de cette détente) multicellulaires.
Leur puissance atteignait 34 200 kW (soit 46 530 ch), avec une vitesse de rotation maximale de 2 430 tours /min. Sous ces turbines se trouvaient les condenseurs, permettant de refaire passer la vapeur d’eau à l’état liquide. Ces turbines étaient couplées à des alternateurs (on parle donc de turbo-alternateurs), la transmission turbines-alternateurs étant synchrone. | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Un des quatre Turbo | ||||||||||
| • Les alternateurs
Les 4 alternateurs, dont la fonction était de convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique, étaient chacun constitués d’un rotor (ou inducteur) avec 4 pôles magnétiques (2 pôles nord et 2 pôles sud) et d’un stator (ou induit) sur lequel se trouvent 3 bobinages, décalés l’un par rapport à l’autre de 120°. Le courant courant alternatif triphasé ainsi produit atteignait une tension de 6 000 V à une fréquence de 81 Hz. Étant couplés avec les turbines, les alternateurs tournaient à 2 430 tours/min et leurs puissance atteint 33 200 kW (soit 45 411 ch). Ils produisaient le courant alternatif distribué ensuiteaux moteurs par l'intermédiare des pupitres de contrôles.
• Les moteurs
Les moteurs, eux aussi au nombre de 4, avaient le rôle inverse des alternateurs (ils con-vertissaient l’énergie électrique en énergie mécanique). Leurs dimensions étaient de6,50 m de hauteur, 8,00 m de longueur et 6,00 m de large. Ces moteurs développaient une puissance de 40 000 ch (soit 29 420 kW), avec capacité temporaire de 50 000 ch en cas d'urgence. Chaque moteur était constitué d’un stator et d'un rotor de 40 pôles magnéti-ques. Leurs pôles étant 10 fois plus nombreux que ceux des alternateurs, les moteurs tournaient 10 fois moins vite, donc à 243 tours/min maximum. Ces moteurs étaient asynchrones lors des manœuvres de démarrage, d’arrêt et d’inversion de marche, et synchrones en marche normale. En effet, un moteur asynchrone démarre seul sous l’effet du champ tournant produit par le stator, mais sa vitesse ne peut atteindre celle du champ tournant (ici de 243 tours/min) alors que le moteur synchrone, dont le rotor est excité (ou parcouru par un courant continu), avait besoin d’être entrainé pour démarrer (compte tenu des moyens de com-mande des machines élec-triques à cette époque), mais sa vitesse est toujours proportionnelle à la fré-quence du champ tournant. On comprend donc le choix des ingénieurs de faire démarrer ces moteurs en asynchrone et tourner en synchrone pour la marche normale. Le changement de sens de rotation de ces mo-teurs se faisait par simple inversion des polarités du courant à l’arrivée aux moteurs, ce qui permettait à Normandie de « battre » en arrière avec 160 000 ch. Ces moteurs, parmi les plus grands jamais construits dans le monde, ont été produits, tout comme les turbo-alternateurs, par l’entreprise Alsthom de Belfort | ||||||||||
|
Salle des moteurs, collection CPA LPM1900 | ||||||||||
| ||||||||||
|
Un coin du grand salon, collection CPA LPM 1900 | ||||||||||
| DECORATION INTERIEURE
Normandie représente l'archétype de la décoration intérieure des années 1930. Les plus grands noms de l'art avaient participé à sa décoration : Pierre Patout et Henri Pacon dessinèrent la salle à manger des premières classes, volume immense recouvert d'or et de luminaire de Lalique; Emile Gaudissard réalisa les cartons des tapisseries pour les chauffeuses basses du salon des 1ere Classe. Cette disposition d'un espace aussi grand au centre du paquebot avait été obtenue en dédoublant les conduits de fumée qui se réunissaient juste sous les cheminées. Jean Dunand dessina les panneaux de laques du fumoirs et bien d'autres décorateurs participèrent à ce manifeste flottant, tant vanté par le Corbusier, tel Maurice Daurat qui contribua en fabriquant huit vases monumentaux en étain et palissandre. Jean de Brunhoff avait entièrement décoré la salle à manger des enfants sur le thème de sa création, l'éléphant Babar. Les sculptures des couloirs étaient l'œuvre de Georges Saupique. Jean Dunand a participé à la décoration du fumoir et d'une partie du salon des premières classes
Beaucoup des décorations de Normandie faisaient référence, directement ou non, à la province qui lui avait donné son nom. Les dessins et photos d'époque montrent de vastes salles communes décorées avec beaucoup d'élégance. La salle à manger des premières était particulièrement remarquable, non seulement par ses dimensions (93 x 14 x 8,5 m, 700 couverts), mais aussi par la richesse de sa décoration (Raymond Quibel). Afin de pallier l'absence de lumière naturelle, les décorateurs avaient installé douze « piliers lumineux » de cristal Lalique que complétaient trente-huit colonnes lumineuses murales et deux immenses chandeliers, eux aussi en cristal.
Normandie était équipé de piscines couvertes et découvertes (le second navire ainsi équipé après le paquebot italien Rex), d'une chapelle, et d'un cinéma transformable en théâtre.
De nombreux éléments de l'orfèvrerie comme les soupières avec des boules dans les poignées sont présentées à l'écomusée de Saint-Nazaire. | ||||||||||
|
Le jardin, les verrières et l’aquarium, collection CPA LPM 1900 | ||||||||||
|
La chapelle, collection CPA LPM1900 | ||||||||||
|
Un coin du grand salon, collection CPA LPM 1900 | ||||||||||
|
||||||||||
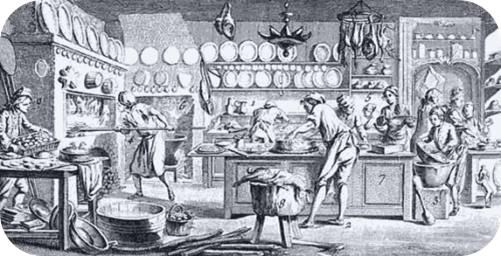 |
||||||||||
|
« Histoire des anciennes corporations d’art et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie » Paru en 1850
Les maîtrises des pâtissiers et des oublayeurs jouissaient de droits différents : les pâtissiers seuls pouvaient employer les œufs et le beurre pour la confection des gâteaux, tourtes , pâtés , tartelettes, craquelins de confréries, nieules et autres ouvrages, tandis que les oublayeurs n’employaient que des épices dans la fabrication des oublies, des gaufres, des échaudées, ou des hosties pour la célébration des messes. Ce dernier ouvrage formait une portion considérable du commerce des oublayeurs.
La fabrication des hosties était défendue aux Juifs et aux Protestants, par une raison que chacun conçoit aisément. Depuis la révolution de 1793, certains religieux, entre autres les Carmélites, se livrent à la confection des hosties, ce qui a fait tomber entièrement le commerce des oublayeurs. Le nom et la forme actuelle de ces pâtes légères, ordinairement appelées plaisirs, mot qui exprime si bien leur fragilité, ne datent que de l’époque du mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette. Auparavant, on les nommait dérisoirement : Canons de la reine de Hongrie, à cause de leur forme ronde ressemblant à peu près à ces instruments de guerre. Louis XVI défendit le nom et changea la forme de ces inoffensives pâtisseries, par respect pour son épouse, dont la famille tenait par quelques liens aux princes de Hongrie. On ne s’attendait guère, assurément, à trouver des raisons politiques dans des pâtes de si maigre valeur.
Les pâtissiers et les oublayeurs ne pouvaient acheter les farines nécessaires à leurs ouvrages que chez les boulangers sujets aux moulins de la ville. Comme on avait découvert chez plusieurs pâtissiers des farines d’une provenance illégale, un arrêt de 1678 enjoignit aux boulangers de déclarer dans les vingt-quatre heures, au clerc des moulins, la qualité et la quantité de farine vendue par eux aux pâtissiers et aux oublayeurs. Si les pâtissiers ou les oublayeurs voulaient moudre pour leur usage quelques boisseaux de blé, ils ne pouvaient le faire qu’aux moulins de la ville. En 1544, sur les poursuites de Martin Cavelier, fermier des moulins, Jean Lhermite, pâtissier, fut condamné à trente sols d’amende pour transgression de cette ordonnance.
Plusieurs fois, les pâtissiers, de concert avec les boulangers, se liguèrent ensemble pour se soustraire aux droits de mouture perçus par le clerc des moulins. Ils insultèrent ce fonctionnaire dans l’exercice de sa charge, le menacèrent même de le jeter à l’eau. Tant d’audace attira une juste répression. En 1674, Jean de Brevedent, lieutenant du Bailliage réprimanda sévèrement le pâtissier Simon Becquet, qui se plaisait à ces insultes, le menaça du fouet et d’une peine encore plus grave en cas de récidive. A cette occasion, on renouvela et publia au son de trompe, par les rues et carrefours de Rouen la défense aux pâtissiers, oublayeurs et boulangers de moudre leurs blés ailleurs qu’aux moulins urbains. En 1709, les pâtissiers Thomas Flescheur, Jean Parmentier, Jean Pigeon, furent condamnés à payer au fermier des moulins le prix de la mouture de deux mines de blé, en punition de quelques sacs de farine qu’ils avaient fait moudre ailleurs. |
||||||||||
|
Les pâtissiers renouvelèrent leurs statuts en 1735, et en demandèrent la confirmation à Louis XV. Comme ils s’attribuaient exclusivement la confection des tourtes et des gâteaux en tous genres, les rôtisseurs et les boulangers s’opposèrent à leur prétention. Ils réussirent, et on maintint aux boulangers le droit de faire des gâteaux aux Rois et à Pâques, avec des œufs et du beurre , dont l’usage en tout autre temps appartenait seulement aux pâtissiers.
Nuls autres que les pâtissiers et oublayeurs ne pouvaient vendre ni pâtisseries, ni galettes, ni oublies, sur les places de Rouen. En 1744, les pâtissiers, forts de leur droit, arrêtèrent un sieur Mabire, d’Eauplet, qui portait des gâteaux au marché. De là, procès devant le Parlement. Heureusement pour Mabire, la saisie avait été faite par un vendredi, et les pâtissiers avaient oublié que, ce jour-là , toutes les denrées étaient franches de droits au marché de la Vieille-Tour. Le Parlement déclara donc la saisie nulle, et sauva Mabire des mains jalouses des pâtissiers. Comme beaucoup des artisans de ces anciens temps, plusieurs pâtissiers se distinguèrent par de pieuses et magnifiques donations. En 1611, Guillaume Lemourme, maître pâtissier, donna le terrain sur lequel les Capucins ont bâti leur église. En mémoire de ce don, ils représentèrent Saint-Guillaume, patron du généreux pâtissier, sur les vitraux brillants d’une croisée, au bas de laquelle on lisait ces vers :
Mon âme ardemment éprise |
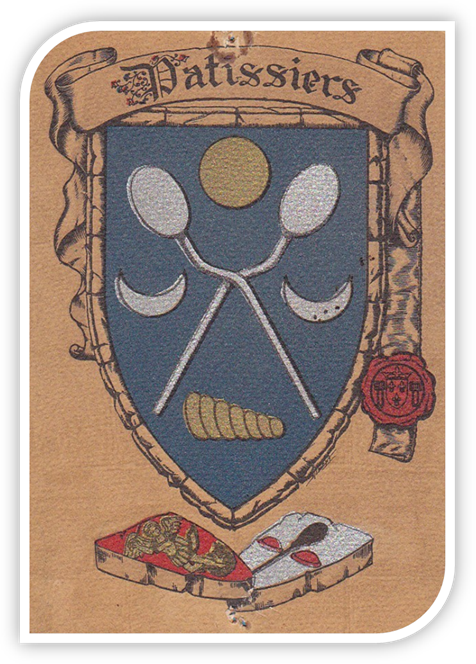 |
|||||||||
 |
||||||||||
|
Sur la croisée on voyait encore l’écusson de la profession, à fond d’azur avec une emporte-pièce d’argent, ou fers à fabriquer les hosties, accompagnés de deux croissants en or, en chef une grande hostie, et en pointe plusieurs petites. |
||||||||||
 |
||||||||||
|
|
LES CAHIERS DU PETIT MANCHOT N° 202 du 04-05-2013 | |||
|
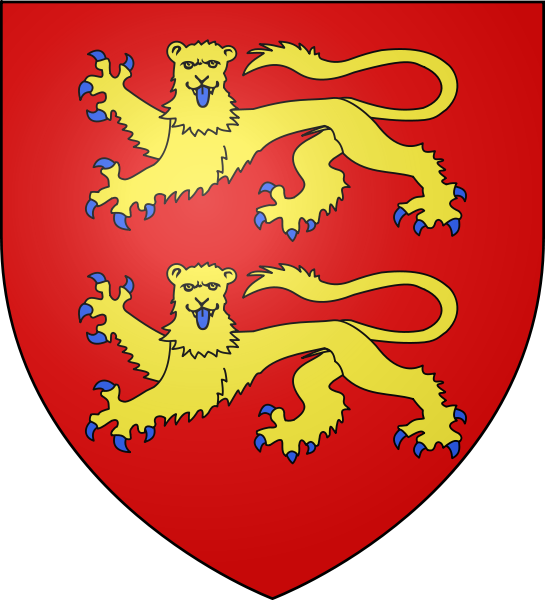
Les Léopards de Normandie Par Marcel LELEGARD | ||||
|
| |||||
| Les Léopards de Normandie | |||||
|
| |||||
|
Les Léopards de Normandie Texte de L’abbé Lelégard, in fascicule « le Chateau de Pirou. »
L’une des hontes de ma vie dont je traînerai le remords jusqu’à mon trépas, sera d’avoir recouvert le catafalque de Louis Beuve d’un grand drap rouge à deux léopards d’or, dans la cathédrale de Coutances, le 12 août 1949, pour le service trentain que la Normandie lui célébra.
Georges Lernesle, puis Albert Desile me dirent chacun à leur tour:
« Ch’est troués qu’il en faut! »
| 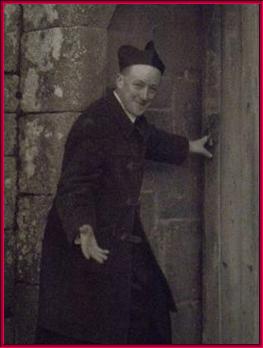 L’abbé Lelégard | ||||
| Il y a eu un temps où j’ai cru de bonne foi que les armes de Normandie ne comportaient que deux léopards, car c’était ce que je pouvais voir sur le frontispice ou la page de titre d’ouvrages relativement anciens: « Histoire générale de Normandie» par Gabriel du Moulin, à Rouen chez Jean Osmond, 1631 : « Histoire ou chronique de Normandie », éditée par Martin Le Mégissier en 1581, à Rouen.
| |||||
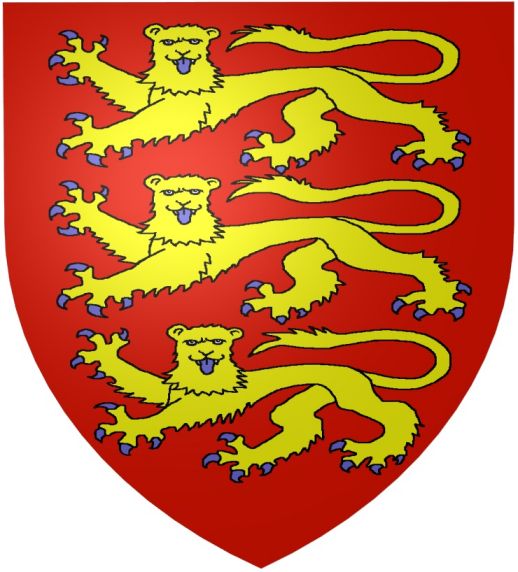 | 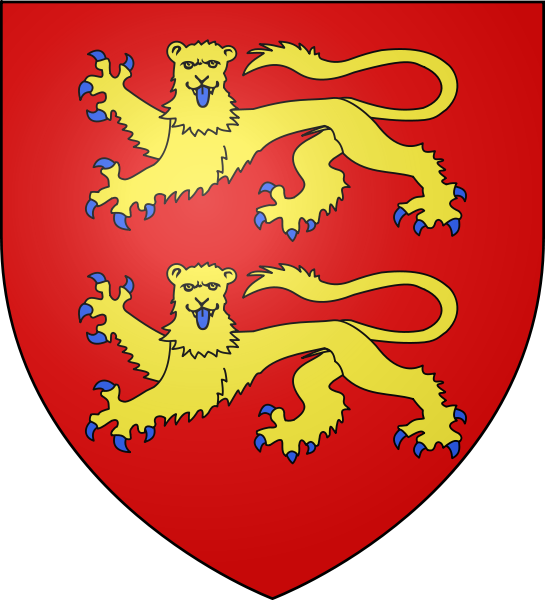 | ||||
| « les treis cats » | « les p’tits cats » | ||||
|
Cette belle théorie, transposant imaginairernent au XIIe siècle des règles qui ne se feraient jour que beaucoup plus tard, ne reposait en fait sur rien du tout. Elle était totalement erronée.
La plus ancienne figuration de l’écu (rouge) à léopards (d’or) apparaît sur le sceau équestre de Richard Cœur-de-Lion, duc de Normandie et roi d’Angleterre, appendu à une charte datée du 18 mai 1198. Et les léopards y sont bel et bien au nombre de trois. Ce blason et ce sceau avaient été adoptés par Richard Cœur-de-Lion après sa captivité au retour de la croisade, car auparavant il portait semble-t-il des lions affrontés, plus ou moins inspirés peut-être, des lionceaux qu’avait portés Geoffroy Plantagenêt son grand-père.
Lorsque Philippe Il Auguste rattache la Normandie à la couronne de France en 1204, il ne lui donne pas un nouveau duc.
Ce n’est qu’en 1339 que Philippe de Valois, roi de France, désigne son fils Jean comme duc de Normandie. Quel blason va porter le prince ? Tout simplement les armes de France: d’azur semé de fleurs de lys d’or, avec une bordure rouge pour « brisure» afin d’éviter la confusion avec les armes du roi son père, et lorsque ce même Jean, devenu roi, (jean le Bon) désignera pour duc de Normandie son fils le Dauphin Charles, quel blason portera celui-ci ? Un écartelé aux 1er et 4ème quartiers de France, et aux 2ème et 3ème quartiers: des dauphins de Viennois ; dans tout cela point de léopards : Les armes sont celles du prince, issu de la Maison de France. Les léopards n’étaient point totalement oubliés. Cependant en 1279, Édouard Ie qui est toujours duc de Normandie dans les îles de Jersey et Guernesey (la Normandie insulaire) concède au bailliage des îles un sceau à trois léopards, puis en 1304, chaque Ile devient un bailliage indépendant avec son sceau particulier, chacun à trois léopards. Quand verra-t-on apparaître des blasons à deux léopards seulement ?
Hélas son duché va être bien éphémère: Louis XI l’oblige à y renoncer en 1469 et le 9 novembre de cette même année, il fait briser l’anneau ducal à coups de marteau sur une enclume en pleine séance de l’Échiquier.
| |||||
| | |||||
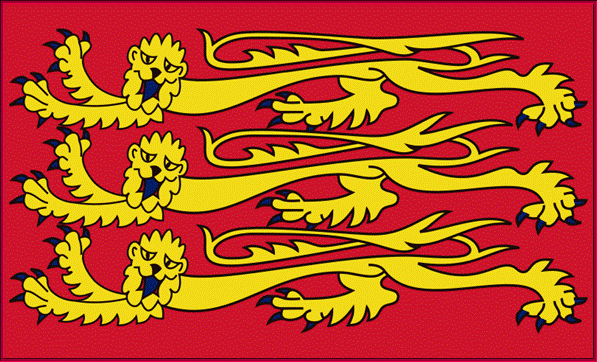 | |||||
| Drapeau de Richard Coeur de Lion. Drapeau Jersiais « les treis cats » | |||||
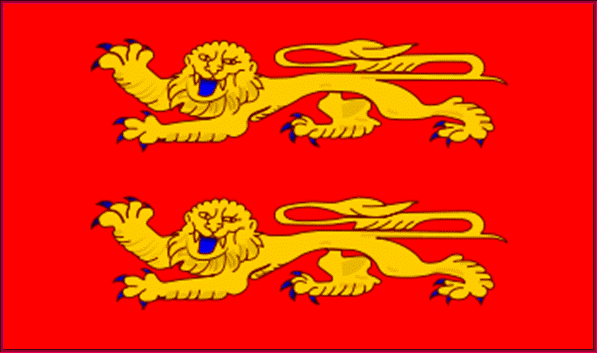 | |||||
| Drapeau Normand « les p’tits cats » | |||||
|
| ||
 | ||
|
| ||
| MESSE DE MINUIT EN NORMANDIE | ||
|
Monseigneur CHABOT Prélat de Sa Sainteté CURÉ DE PITHIVIERS (LOIRET)
LA NUIT DE NOËL DANS TOUS LES PAYS 1912
C'est au pays de Caux surtout que la Messe de minuit se célébrait avec une grande solennité, sous le nom de fête des bergers.
Son origine était complètement normande. Au début, cette fête ne fut, en effet, qu'un de ces petits drames liturgiques latins que parfois on intercalait, comme une sorte de jeu sacré, dans l'office solennel, telles la Messe de l'étoile et la Messe de l'âne, qui furent représentées souvent, dans les premières années du Moyen Age, à la cathédrale de Rouen.
On représentait aussi dans la même église le Drame des pasteurs, adoration pieuse et naïve de l'Enfant-Jésus par les Bergers.
Ces pastorales donnèrent naissance à la fête des bergers. C'est la même naïveté dans le scénario, avec un caractère rustique qui remplace la gravité sacerdotale.
C'était aux garçons du village que revenait l'organisation de la fête. A Goderville et à Froberville, ils élisaient même un maître qui devait recueillir les offrandes pour rachat d'un somptueux pain bénit.
A minuit, la vieille église du village s'estompait dans la brume blanchâtre et glacée. Sous le porche et dans l'allée centrale piétinaient, avec un perpétuel chuchotement, les curieux, étrangers à la paroisse qui cherchaient, comme dans les théâtres des villes, «des places assises d'où l'on puisse très bien voir.» Tous étaient attirés par le charme de poésie touchante qui caractérisait cette pittoresque cérémonie.
De tout ce mouvement, de tout ce bruit, sont presque scandalisés les habitants du village, rangés dans leurs bancs bien cirés: cultivateurs venus avec leurs valets par les chemins creux, vieux paysans aux casquettes de poil et aux sabots de bois rembruni; bonnes femmes dont le serre-tête de coton s'agite sans cesse d'un petit mouvement saccadé; fermières et leurs servantes, bien au chaud dans leurs amples manteaux de laine, dans leurs capelines sombres, qu'égayent de blancs pompons légers et mouvants.
Dans le clocher de pierre, les douze coups de minuit viennent de sonner; les chantres ont achevé le Te Deum, le silence se fait dans toute l'église; qu'attend-on?
Réunis auprès des fonts baptismaux, se tenaient tous les garçons du village, portant en écharpe une serviette blanche, tandis que le maître se distinguait au milieu d'eux par une sorte de petite nappe à longs effilés, portée à la ceinture. À leur groupe se joignaient les bergers du pays. Ceux-ci avaient revêtu leur costume traditionnel: longue limousine rayée à pèlerine et à capuchon, chapeau de feutre à larges bords, sabots aux pieds et houlette ornée à la main.
A un signal donné, le cortège ainsi formé se mettait en marche. Souvent il était précédé par une sorte de chandelle allumée, mise en mouvement et glissant, à l'aide d'un fil de fer, d'un bout de l'église à l'autre, du portail à l'autel. C'était la Marche à l'étoile. Les bergers tenaient en laisse ou portaient un bel agneau blanc tout enrubanné; ils venaient l'offrir au Christ-Enfant couché dans une Crèche devant l'autel.
Souvent on tirait la queue à la pauvre bête ou on la piquait avec une épingle, afin qu'elle se mit à bêler dans les moments les plus solennels.
Mais ce qui attirait surtout les regards de la foule, c'était la civière du pain bénit, éblouissante de lumières, de cierges et de chandelles allumées.
Cette civière, comme à Néville, près de Saint-Valéry, était un véritable monument de menuiserie, en forme de pyramide, à plateaux ronds et superposés, ornés de lumières et reliés par des girandoles illuminées; elle était en outre parée de jolies touailles ou nappes de broderies et de dentelles. Au beau milieu se dressait un mât portant cinq plateaux d'un diamètre de plus en plus diminué, en montant, et donnant l'aspect d'un cône. Du sommet de ce mât, comme quatre haubans, descendaient quatre branches de fer portant, de distance en distance, des bras de candélabres et des torchères où brillaient de nombreuses bougies. Une sorte de manivelle—pour employer le terme populaire une chincholle—placée à la partie supérieure, actionnait tous les plateaux qui tournaient alors sur leur axe, en projetant l'éclat de mille petits cierges scintillants. Sur les plateaux reposaient les couronnes de pain bénit, ornées de fleurs et de feuillage: houx, laurier, lierre, roses de Noël; un bouquet terminait également le mât pyramidal.
Tout ce cortège, dans lequel deux garçons étaient chargés de mettre le mécanisme en mouvement, venait, à un moment donné, faire l'offrande du pain bénit; les fameux plateaux tournants faisaient surtout un effet magique.
Nous avons extrait ces détails d'un excellent article de M. Georges Dubosc, dont tout le monde, en Normandie, connaît le talent et l'érudition
A Saint-Victor-l'Abbaye, quatre petites filles, tout de blanc habillées, couronnées de roses, portent sur leurs épaules le symbole vivant de l'Enfant-Dieu, un agneau immaculé, incarnation d'innocence, de pureté et de douceur. Couché sur un tapis moelleux de chauds lainages, l'agnelet dresse sa petite tête placide et sereine, sous un dôme de verdure et de fleurs, formé d'un entrelacement de feuilles de lierre et de branchages de houx, piqué çà et là de roses, d'oeillets et de chrysanthèmes
| ||
Chanson de Nôel | ||
|
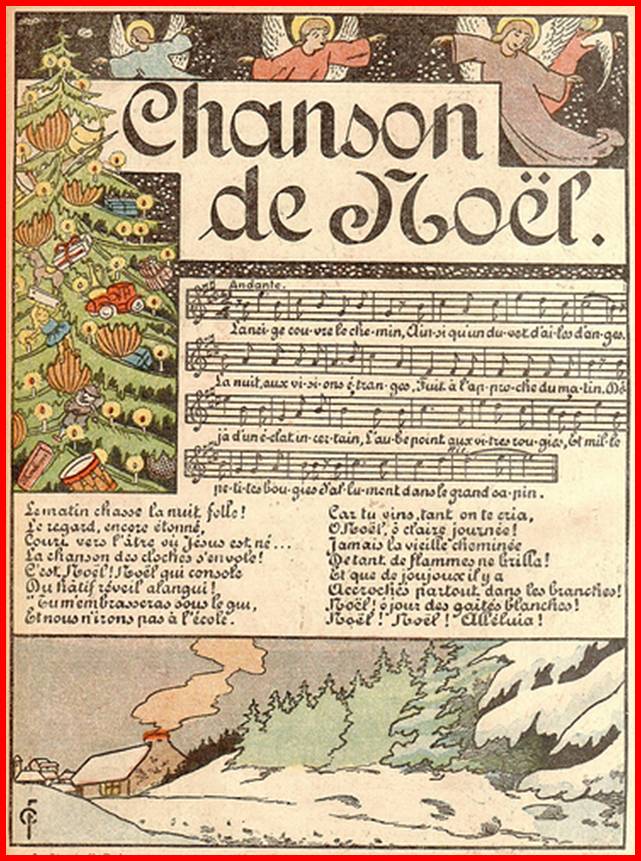
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
CPA collection LPM 1900 |
||||||||
|
Adélaïde de Normandie (1026-1090)
Adélaïde1 de Normandie (vers 1026, Calvados – vers 1090), demi-sœur de Guillaume le Conquérant, fut comtesse d'Aumale de son plein droit.
Ses parents ne sont pas connus avec certitude. Elle est peut-être la fille de Robert le Magnifique, duc de Normandie et d’une maîtresse inconnue, ou peut-être la fille du duc Robert et d'Arlette, ou encore la fille d'Arlette et d'Herluin de Conteville. Dans une interpolation au récit de Guillaume de Jumièges, Robert de Torigny mentionne qu'Adélaïde est une « sœur utérine » de Guillaume le Conquérant. L'historienne britannique Elisabeth van Houts a depuis démontré que Robert de Torigny utilise aussi cette expression précise pour désigner les enfants issus d'un même père. De plus, Robert de Torigny précise, dans un autre passage, qu'Adélaïde est une fille du duc Robert par une concubine qui n'est pas Arlette.
Elle épouse en premières noces Enguerrand II, comte de Ponthieu et seigneur d'Aumale. Ce dernier aide son beau-frère Guillaume d'Arques, révolté contre le duc de Normandie, et se fait tuer le 25 octobre 1053 lors de combats livrés à Saint-Aubin-sur-Scie. De ce premier mariage naissent deux filles.
Le duc Guillaume la remarie à Lambert de Boulogne, comte de Lens, frère du comte Eustache II de Boulogne. Lambert meurt peu après, tué en 1054 dans un combat livré à Phalempin lors du siège de Lille (1054) par l'empereur Henri III contre Baudouin V, comte de Flandre.
Quelques années plus tard, Eudes († après 1115-18), comte de Troyes et de Meaux, tue un baron champenois, et se réfugie à la cour de Normandie. Son oncle Thibaud III de Blois, qui était son suzerain, en profite pour s'emparer de ses comtés champenois. Guillaume lui fait épouser sa demi-sœur Adélaïde. Il octroie à sa sœur la cité d'Aumale avec 10 chevaliers. Dans les actes légaux qui nous sont parvenus, Adélaïde est citée pour la première fois en 1082 comme comtesse d'Aumale. Son mari Eudes n'est jamais mentionné portant ce titre, mais simplement « comte » (sans précision) ou « comte de Champagne ». Pour l'historien français Pierre Bauduin, Eudes n'est que le représentant de sa femme, qui est la seule à posséder les droits sur Aumale.
Mariages et descendances
Elle épouse en premières noces Enguerrand II († 1053), comte de Ponthieu. Ils ont : Adélaïde, citée en 1098 ; Hélissende, mariée avant 1091 à Hugues II Campdavaine, comte de Saint-Pol.
En secondes noces, elle épouse Lambert de Boulogne († 1054), comte de Lens, fils d'Eustache Ier de Boulogne. Ils ont une fille : Judith, mariée en 1070 à Waltheof, comte d'Huntingdon.
En troisièmes noces, entre 1065 et 1070, elle épouse Eudes III de Champagne († après 1115-18), comte de Troyes et de Meaux. Ils ont un fils : Étienne (avant 10707-1127), comte d'Aumale. |
||||||||
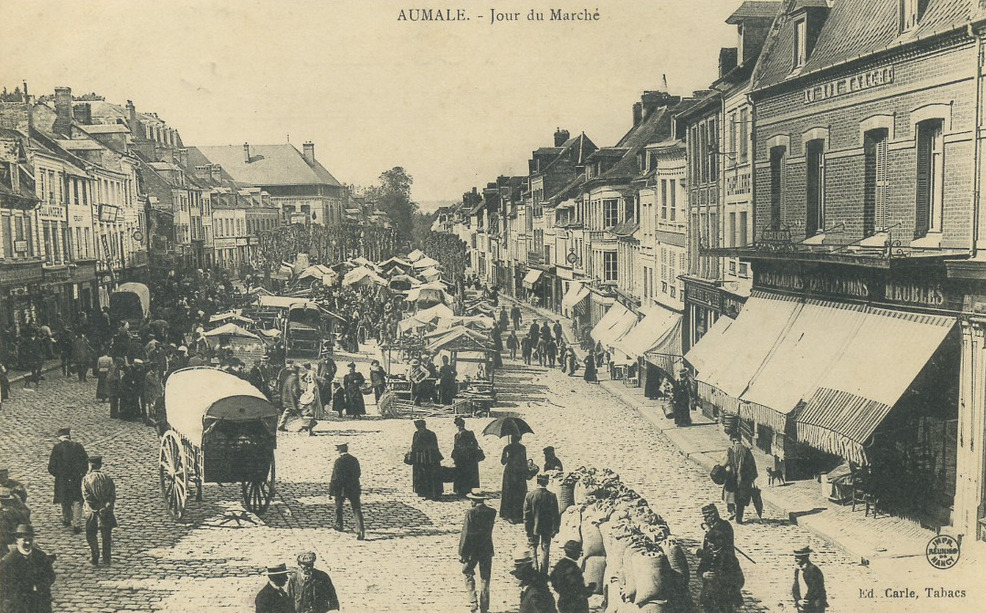 |
||||||||
| ||||||||
| Emma de Normandie Reine d'Angleterre (985-1052)
Emma de Normandie (v. 976 – 6 mars 1052, Winchester), fut une princesse normande, fille du duc de Normandie Richard Sans-Peur et de sa « frilla » Gunnor.
En 1000, une expédition maritime anglaise contre le Cotentin échoue. Les négociations de paix qui s’ensuivent aboutissent et le traité est scellé par les fiançailles d’Emma avec le souverain d’Angleterre. Par son mariage en 1002 avec le roi anglo-saxon Ethelred II, elle prend le nom d’Ælfgyfu ou d’Ælfgyva et devient reine d’une Angleterre en proie aux ambitions da-noises. En effet, dès le 23 novembre, Ethelred avait relancé le conflit avec Sven Ier de Danemark en déclenchant le massacre de la Saint-Brice. Les raids vont alors se succéder.
Fin 1013, elle doit un temps trouver refuge en Normandie avec son mari et ses enfants, alors que les Vikingsdanois ravagent l’Angleterre et que leur roi Sven Barbe fourchue se proclame roi d’Angleterre. | 
Queen Emma and her sons being received by Duke Richard II of Normandy. (Cambridge University Library) | |||||||
|
| ||||||||
| Rappelés par la population, ils y retournent l’année suivante, à la mort de Sven. Mais Ethelred meurt peu après, le 23 avril 1016, et lui succède Edmond Côtes de Fer, un fils qu’il avait eu de sa maîtresse Ælflæd. Édouard, l’aîné des fils légitimes d’Ethelred et d’Emma, n’avait que onze ans et ne pouvait pas mener la lutte contre Knut, le fils et successeur de Sven. Edmond Côtes de Fer meurt à son tour le 30 novembre 1016, et Emma et ses enfants trouvent de nouveau refuge en Normandie, tandis que Knut monte sur le trône d’Angleterre. Puis Emma laisse ses enfants en Normandie et revient en Angleterre pour épouser le nouveau roi, devenu Knut le Grand À la cour d’Angleterre vit également Ælfgifu de Northamp-ton, la première épouse more danico de Knut. La haine qui va rapidement opposer les deux femmes perturbe la cour et Knut décide de confier la Norvège à son fils aîné et de confier la régence de la Norvège à Ælfgyfu. Mais cette dernière se rend rapidement impopulaire et la Norvège se révolte en 1035 et appelle Magnus, le fils du roi que Knut avait détrôné. Il donne ensuite le Danemark à Harthecnut, son fils et celui d’Emma.
| ||||||||
| Knut meurt le 12 novembre 1035. Harthecnut lui succède au Danemark, et doit combattre Magnus de Norvège qui cherche à envahir son royaume. Occupé au Danemark, il ne peut faire valoir ses droits sur le trône anglais.
Emma, voyant que l'absence d'Harthecnut, retenu au Danemark, cause la défection de ses partisans anglais, elle décide de faire venir son fils Alfred. Mais celui-ci est fait prisonnier avec la complicité du comte Godwin, torturé et exécuté.
Finalement, Harthecnut ne put empêcher son demi-frère Harold, fils d’Ælfgyfu de Nor-thampton, de monter sur le trône anglais.
Ce n’est qu’en 1040 qu’Harthecnut fait la paix avec Magnus et vient en Angleterre affirmer ses droits. Il n’a pas besoin de combattre, car Harold meurt le 17 mars 1040. Harthecnut meurt lui-même brusquement au cours d’un festin le 8 juin 1042.
Durant son second mariage et après la mort de Knut, Emma a favorisé la descendance de Knut au détriment de celle d’Ethelred. Parvenu au pouvoir en 1042, son fils Édouard le Con-fesseur s’en souvient et l’écarte définitivement du pouvoir. C’est pourtant par sa parenté avec Emma que son petit-neveu, Guillaume le Conquérant, affirme ses prétentions à la couronne anglaise en 1066.
Elle meurt à Winchester le 6 mars 1052. | ||||||||
|
| ||||||||
| Mariages et enfants
De son premier mariage, célébré en 1002, avec Ethelred II (v. 996 † 1016), roi d’Angleterre elle avait donné naissance à :
- Édouard le Confesseur (v. 1005 † 1066), roi d’Angleterre de 1042 à 1066 - Alfred († 1036) - Godjifu († avant 1049), mariée à Dreux († 1035), comte de Vexin et d’Amiens, puis à Eustache II (v. 1020 † 1085), comte de Boulogne
De son second mariage, célébré en juillet 1017, avec Knut le Grand, roi d’Angleterre, de Danemark et de Norvège, était né :
- Harthacnut (1018 † 1042), roi d’Angleterre de 1040 à 1042 - Gunhlid (v. 1020 † 1038), mariée sous le nom de Cunégonde le 29 juin 1036 à Henri III, empereur germanique | ||||||||
|
Emma de Normandie reçoit le Encomium Emmae Reginae de son auteur, vers 1041-1042. Ses fils Édouard le Confesseur et Hardiknut sont à l’arrière plan | ||||||||
| ||||||||
| Dames de l’histoire normande Gonnor Epouse de Richard Ier, duc de Normandie († 1031)
Selon Dudon de Saint-Quentin, le duc Richard Ier (935-992) veuf d'Emma, se lie à Gonnor, vierge de haute majesté ", issue d’une noble lignée danoise.
Elle donne au duc de nombreux enfants dont, son héritier Richard II, Robert, futur archevê-que de Rouen et comte d’Évreux et Emma, mariée à Ethelred, roi d’Angleterre.
Cette alliance aurait été légitimée vers 980. Le cas de Gonnor illustre le rôle des concubines dans le lignage ducal au Xe siecle, qui embarrasse parfois les chroniqueurs des périodes sui-vantes. Certains auteurs, comme Wace, chantent ses amours avec Richard Ier, d’autres, com-me Robert de Torigni, la font sortir d’un lignage peu prestigieux et affirment que ses enfants sont nés hors du mariage et n’ont été légitimés qu’après coup. Elle est cependant représentée en donatrice dans le cartulaire du Mont-Saint-Michel (XIIe s.). |
Gonnor, concubine de Richard I, confirmant une charte de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, cartulaire de l'abbaye, XII s | |||||||
| La légende de Gonnor
Extrait d'Histoire des Ducs de Normandie, par Guillaume de Jumièges, traduction de M. Guizot
Les premiers ducs de Normandie possédaient la terre d'Équiqueville. C'est dans ses bois et sur ses collines qu'ils venaient chasser au sortir de leurs châteaux d'Arques ou de Bures.
Voici ce que raconte un moine de Jumièges à propos de la rencontre de Gonnor avec Richard Ier, duc de Normandie :
« Celui-ci, informé par la renommée de la beauté de la femme d'un de ses forestiers, qui demeu-rait près de la ville d'Arques, dans un domaine appelé Équiqueville, alla à dessein chasser de ce côté, voulant s'assurer par lui-même de l'exac-titude des rapports qu'on lui avait faits. S'étant donc logé dans la maison du forestier, et s'étant épris de la beauté de sa femme, qui se nommait Sainfrie, il commanda à son hôte de la lui amener dans sa chambre, pendant la nuit. Celui-ci, fort triste, rapporta ces paroles à sa femme; mais elle, en femme honnête, consola son mari, et lui dit qu'elle mettrait en sa place sa soeur Gonnor, jeune fille beaucoup plus belle qu'elle-même. Il fut fait ainsi ;et le duc ayant été instruit de cette fraude, se réjouit infiniment de n'avoir pas péché avec la femme d'un autre. Richard eut de Gonnor trois fils et trois filles ; l'un des fils, Robert, devint archevêque de Rouen. » | ||||||||
|
||||||||
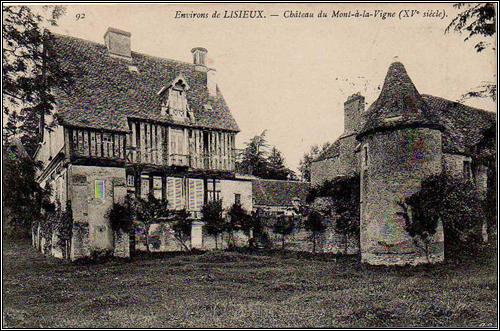 MONTEIL 14 Château du Mont-de-la-Vigne, collection CPA LPM 1900 |
||||||||
|
Culture de la vigne en Normandie (1844) par M. l'Abbé Jean-Benoît-Désiré Cochet (1792-1836)
INTRODUCTION
Qu’il y ait eu autrefois des vignobles en Normandie, que cette province ait fourni à la consommation et au commerce des vins abondants, que ses coteaux, aujourd’hui ombragés de pommiers, aient été autrefois couverts de vignes, ce sont là des faits dont il n’est pas permis de douter. |
||||||||
|
Les princes les prenaient sous leur protection ; l’église les couvrait de ses bénédictions ; les moines les cultivaient de leurs mains, le peuple en gardait le souvenir, et le transmettait aux siècles futurs. Il n’est pas jusqu’à la vigne sauvage de nos forêts, qui ne proteste par sa présence de son antique possession du sol. Les premiers monuments écrits, qui traitent de notre pays, datent du moyen-âge. Eh bien ! dès l’origine des temps historiques, nous voyons apparaître la vigne, enfonçant ses racines dans le sol gallo-romain ; et du plus loin que nous l’apercevons, elle couvre déjà de ses rameaux flexibles la cellule de nos solitaires, ou tapisse dans ses branches souples la grotte de nos ermites. On peut l’appeler, à juste titre, la fille des saints, car les trois premiers vignerons connus dans nos contrées furent : saint Ansbert, de Rouen, saint Philbert, de Jumiéges, et saint Wandrille, de Fontenelle.
|
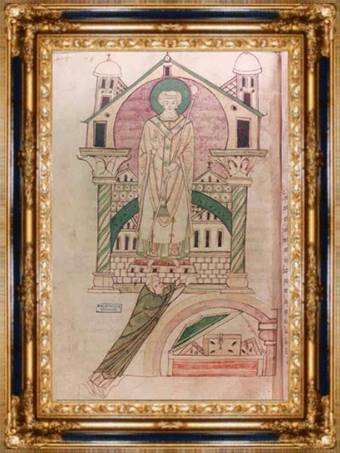 Saint Ansbert, de Rouen |
|||||||
|
Lorsque ces fondateurs d’ordre voulurent rassembler autour d’eux les débris de la société française, lorsqu’ils tentèrent de réunir ces flots de barbares qui erraient comme des brigands au milieu de nos forêts poussées sur des ruines, ce fut à l’agriculture qu’ils demandèrent les premiers éléments de civilisation. Saint Leufroy, saint Ouen, saint Saëns, saint Ansbert, saint Wandrille, saint Valery, et tous ces puissants thaumaturges qui changèrent la face des Gaules, étaient des hommes qui partageaient leur temps entre la prière et le travail des mains.Saint Wandrille et Saint Ansbert plantèrent la vigne de leurs propres mains, et la cultivèrent dans le vallon de Fontenelle, à cinq cents pas de leur monastère Un chroniqueur contemporain nous montre la chapelle de saint Saturnin tout ornée de pampres et de rameaux fertiles. On le voit, les patriarches avaient planté l’Orient, les moines plantèrent l’Occident. Les premiers chroniqueurs de Jumièges se plaisent à nous peindre la terre Gémétique toute couverte de grappes empourprées. Dans la distribution de la maison, ils n’oublient pas les caves souterraines, où l’on resserre et pressure les vins. |
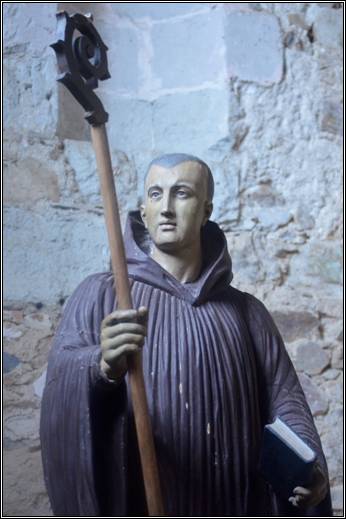 Saint Philbert, de Jumiéges |
|||||||
|
Le vin de Jumièges et celui de Conihout, qui est voisin, conservèrent longtemps leur réputation. Il en est fait mention dans un état des revenus et des dépenses de Philippe-Auguste. En 1410, une queue de vin de Conihout se payait encore 70 sous par les châtelains de Tancarville. Ainsi donc, au XVe siècle, le vin indigène n’était pas dédaigné par les caves féodales.
Les vignobles de Rouen sont mentionnés dès le temps de Charles-le-Chauve, dans cette charte carlovingienne, dont l’abbaye était si fière. Le petit-fils de Charlemagne confirma un monastère dans la ville, et aux alentours des maisons, d’où relevaient des champs cultivés, des prés, des moulins, des pêcheries et des vignobles (9). Pommeraie assure qu’en 1254 ces vignes formaient encore une des principales richesses de la royale abbaye (10). Les vignobles de la côte Sainte-Catherine sont mentionnés jusque sur d’anciens plans de la ville.
Le prieuré du Mont-aux-Malades possédait aussi des vignobles autour de Rouen, et ses archives des derniers siècles disent qu’on en voyait encore des traces sur les flancs du Mont-Fortin (11). |
 Saint Wandrille de Fontenelle. |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
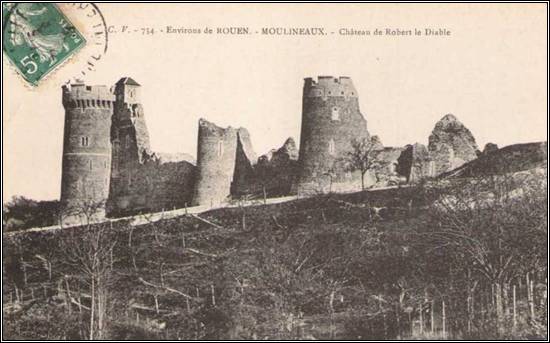 Le château du Duc Robert, CPA collection LPM 1900 |
||||||||
|
Le duc Robert, au temps de l’archevêque Hugues, donna à l’abbaye de Cerisy trente arpents de terre situés à Rouen et plantés de vignes (12). Enfin, c’était chose si commune dans ce pays aux temps anciens, que Gautier de Coutances établit des dîmes ecclésiastiques sur le vin comme sur le lin, le chanvre, la laine, le foin, les pommes et les autres productions indigènes (13).
En retour, l’église accordait à ce produit du sol ses puissantes bénédictions, et, dans notre cathédrale, à partir du 14 septembre, on faisait chaque dimanche, avant la grande messe, la bénédiction de vin nouveau (14). Nos anciens rituels contiennent, en outre, des prières et des exorcismes que l’on pratiquait dans le diocèse sur les arbres, les moissons et les vignobles. Cette formule se retrouve jusque dans l’édition de 1771, donnée par le cardinal La Rochefoucault (15). |
||||||||
|
On le voit, les bords de la Seine étaient riches en vignobles, et si nous remontons un moment le fleuve, nous verrons les vins d’Oissel et de Freneuse mentionnés dans les anciens tarifs des droits d’entrée de la ville de Rouen. Noël de la Morinière, qui a bu du vin d’Oissel en 1791, assure qu’il était encore potable (16). Mais celui de Freneuse était regardé comme le meilleur ; il est question de ce vin dans un ancien cahier de remontrances faites, vers la fin du dernier siècle, sur la liberté des foires de Rouen. |
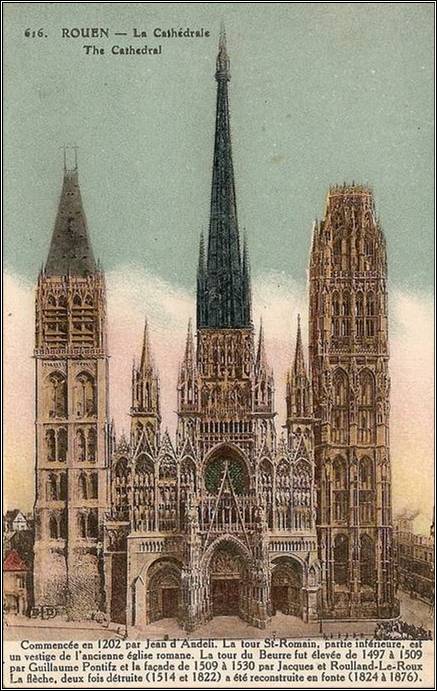 Cathédrale de Rouen, CPA collection LPM 1900 |
|||||||
|
A Saint-Jean-de-Folleville, M. Emmanuel Gaillard a connu la terre de la Vigne (18), et nous savons que, dans le plan cadastral du Valasse (19), figure toujours le clos de la Vigne dans le parc de l’ancien monastère. La tradition et d’anciens titres parlent de ce vignoble, depuis logn-temps disparu.
Les rivages de la mer, quoique exposés à un froid plus vif, n’étaient point dépourvus de ce genre de plantation. Il dut y avoir des vignes sur le territoire de l’ancienne exemption de Montivilliers. Cette opinion repose sur les traditions, et sur une bulle du pape Alexandre, donnée à Anagnie, la sixième année de son pontificat, par laquelle il confirme à l’abbaye de Montivilliers, et prend sous sa protection toutes ses possessions, telles que bois, terres, vignobles, moulins et autres biens (21). Je regarde également comme une preuve de ce fait les sculptures du XVIe ou du XVIIe siècle, qui couvrent les grandes portes de bois de l’église abbatiale. On y voit des claies et des échalas soutenant des vignes, ce qui paraît une réminiscence de l’ancienne industrie du pays. |
||||||||
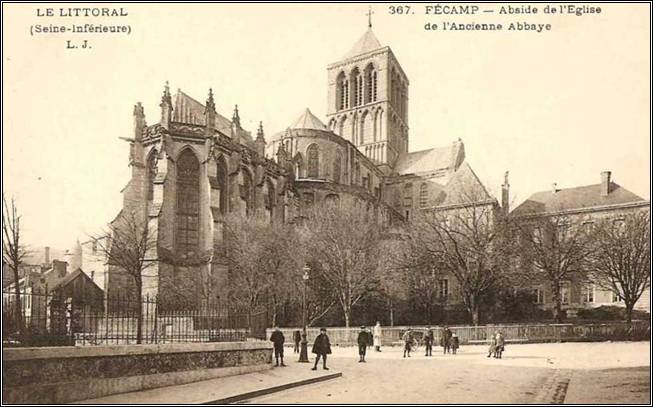 L’abbaye de Fécamp, CPA collection LPM 1900 |
||||||||
|
Dans les délibérations capitulaires de l’abbaye de Fécamp, nous trouvons mentionnées, en 1700, les dîmes de la côte de la Vigne, sur la paroisse Saint-Valery de Fécamp, et, en 1706, celles de la côte de Vigne, sur la paroisse de Saint-Nicolas (22) de la même ville. La tradition a conservé le nom de côte des Vignes à un coteau du val aux Clercs, près le bois de Boclon, sur la paroisse Saint-Léonard.
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
En 1118, Guillaume à la Hache, comte de Flandre, ayant été blessé près d’Aumale, par Hugues Boterel, se retira dans cette ville, où le comte Etienne, et Avoise son épouse, le reçurent de leur mieux ; mais, s’étant livré à la bonne chère, et ayant bu du vin nouveau avec excès, il finit bientôt après sa vie avec ses desseins (29). |
||||||||
 L’abbaye de Montivilliers, CPA collection LPM 1960 |
||||||||
|
Guillaume-le-Conquérant confirme, dans une Charte, à l’abbaye de Montivilliers, cinq arpents de vignes, à Longueville, que Ubasta, fille de Rimer, avait apportés avec elle en se faisant religieuse dans ce monastère (32). Dans le nécrologue du Vallasse, on lit ceci : « En 1165, mourut Valeran de Meulan, qui donna à l’abbaye du Voeu beaucoup de biens, en forêts, en vignobles, en terres et en revenus (33). » C’était une des plus glorieuses inscriptions que les moines pussent accorder à leurs bienfaiteurs. |
||||||||
 Argences, CPA collection LPM 1900 |
||||||||
|
La possession de cette exploitation si lucrative était attachée à l’office de sacristain, et voici comme une vieille tradition explique l’origine de cette propriété. Le duc Richard était très pieux. Un jour, il se laissa enfermer dans l’église de l’abbaye, pour y prier Dieu tout à son aise pendant le silence des nuits. Par hasard, le frère sacristain s’avisa de faire sa ronde cette nuit-là dans l’église : il trouva le prince agenouillé au pied d’un autel. L’obscurité l’empêchant de le reconnaître, il le prit pour un voleur, le traita en conséquence, et le mit à grands coups de pieds hors l’église. De part et d’autre, on garda le silence, le prince pour ne pas être reconnu, le bénédictin pour ne pas manquer à la règle. Le lendemain, le duc fit venir le sacristain, et lui demanda s’il se souvenait de l’histoire de la nuit passée ; il lui confessa alors que le maître de la Normandie en était le héros. Le sacristain, épouvanté de cette révélation, se jeta aux pieds du duc, demandant pardon et miséricorde : « Non pas ! dit le prince : vous avez fait votre devoir, et, pour vous récompenser, je vous donne le vignoble d’Argences, mais vous saurez que cette faveur est spécialement accordée à votre exactitude à garder la règle du silence. »
|
||||||||
|
Il y avait aussi des procureurs aux vendanges « procuratores in vindemiis », des vendangeurs pour la récolte « qui vina colligebant », et des gardiens pour le pressoir « qui torcular custodiebant. » On voit que le service était parfaitement organisé.
Ce n’était pas, du reste, le seul établissement viticole que possédât l’abbaye de Fécamp. Ce même Richard II, appelé à juste titre le Père des moines, leur avait donné, dans Saint-Pierre-de-Longueville, près Vernon, douze arpents de vignes (37), qui furent cultivées jusqu’à la révolution. Voici ce que nous lisons dans un inventaire de tous les biens de l’abbaye, dressé en 1790, par Alexis Lemaire, dernier prieur du monastère :
« Les religieux font valoir, en la paroisse de Saint-Pierre-Longueville, le clos de Hardent, contenant douze arpens, planté en vignes, clos de murs, édifié d’une maison, cour, pressoir et écurie. On y récolte jusqu’à 136 muids de vin, mais la dernière récolte n’a produit qu’un muid et demi. Année commune, on y récolte 95 muids, qu’on estime de même à 70 # le muid, ce qui fait 3,850 #, sur quoi il faut diminuer les frais de culture, fumier, échalas, gages du concierge, frais de vendanges, etc. » ; et, au chapitre des meubles, on lit : « Deux pressoirs avec tous les ustensiles nécessaires, dont un pour le vin, dans la métairie du Hardent (38). » |
 Richard II |
|||||||
|
En voilà, ce me semble, plus qu’il n’en faut pour prouver l’existence de la vigne en Normandie. Mais, dira-t-on, comment y est-elle entrée, et comment en est-elle sortie ? (39) Voilà qui est moins facile à dire, et ce que je vais pourtant tâcher d’expliquer. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||||
|
L’introduction de la vigne en Normandie me paraît remonter aux Romains, qui l’apportèrent d’Italie en Gaule, vers la chute de l’Empire. Ce fut un des bienfaits de la conquête. Dès le temps de Pline l’Ancien, la vigne était cultivée dans les provinces voisines des Alpes (40), et, à l’époque où Strabon écrivait sa Géographie, cette culture s’étendait assez avant dans l’Auvergne et dans les Cévennes (41). Il observe même qu’à mesure que l’on avance dans le Nord, on trouve que le raisin a peine à murir.
Néanmoins, il paraît certain, par le rapport de tous les historiens, que Probus fut le premier qui planta la vigne sur les coteaux de la Gaule et de la Pannonie. « Probus gallos et pannonios vineas habere permisit. (42) » Aurelius Victor nous montre cet empereur couronnant nos collines de pampres et de raisins fertiles (43). |
||||||||||
|
La vigne prit heureusement racine dans les Gaules, car l’historien de Julien l’Apostat nous dit qu’à Lutèce, on recueillait de meilleur vin qu’ailleurs, parce que, ajoutait-il, les hivers y sont plus doux que dans le reste du pays (44). Peu de temps après, le poète Ausone nous montre les collines de la Moselle couvertes de pampres (45).
Maintenant, comment se fait-il qu’une culture si bien naturalisée parmi nous, ait disparu complètement dans le dernier siècle. |

Buste de Probus Empereur romain an 281 |
|||||||||
|
L’opinion publique attribue généralement cette disparition à un refroidissement progressif du sol et de l’atmosphère (46). Elle appuie son assertion sur un raisonnement bien simple. La côte d’Ingouville, près du Havre, est parfaitement orientée au midi, et reçoit, sans modification aucune, les plus chauds rayons du soleil. Les vignes qui y croissent, tapissent ordinairement des maisons de pierre, ou recouvrent des treilles parfaitement exposées et parfaitement entretenues. Le plant est des meilleurs, et la culture des plus soignées. Eh bien ! malgré cela, le raisin coule et avorte le plus souvent, et il faut des années très favorisées par le soleil pour le voir mûrir. Or, autrefois, il mûrissait en plein champ et de très bonne heure, puisque nous voyons les vendanges avoir lieu parmi nous, le 9 septembre, et même le 6 d’août, et la bénédiction du vin nouveau se faire le 14 du mois suivant. Donc, une révolution s’est opérée dans le climat de notre pays.
M. Arago, dans les Notices scientifiques de l’Annuaire du Bureau des Longitudes, fait un raisonnement à peu près semblable ((47). Il prouve, l’histoire à la main, que, dans plusieurs provinces de France, telles que le Vivarais et la Picardie, le raisin ne mûrit plus aujourd’hui, tandis qu’il y prospérait autrefois. Il en conclut, non à une diminution des rayons solaires, mais à un refroidissement de la terre, ou plutôt à un plus grand nivellement des saisons, tellement qu’aujourd’hui les hivers seraient moins froids et les étés moins chauds. Il n’est pas éloigné de voir la cause de ce changement de température dans le déboisement de la France et le défrichement de nos forêts (48).
On conçoit facilement que des plantations aussi fragiles que la vigne ne pouvaient résister à de pareilles épreuves si souvent réitérées. |
||||||||||
|
Mais nous n’en sommes pas réduit sur ce point à des conjectures. La chronique manuscrite de l’Abbaye du Tréport nous révèle clairement le résultat que nous cherchons. Car, à cette même année 1709, elle dit : « Grand hyver rigoureux qui ruyne la pêche, les blés et les vignes. Grande misère partout (51). » |
 |
|||||||||
|
Les blés, ils purent être facilement remplacés, mais la vigne ne pouvait être replantée qu’à grand prix d’argent. Le fut-elle jamais ? Il est permis d’en douter, d’autant mieux que, depuis quelque temps, elle n’était plus qu’une culture ingrate et stérile ; et puis, la qualité du vin du pays s’était considérablement détériorée dans certains cantons, tels que l’Avranchin : on ne le nommait plus, au XVIIe siècle, que le tranche-boyau d’Avranches (52). Ajoutez à cela le grand développement qu’avait pris, dans les derniers temps, la fabrication du cidre, et la facilité toujours croissante des communications avec les pays vignobles ; en voilà plus qu’il n’en faut pour expliquer la défaveur et le discrédit dans lequel tombèrent, à la fin, les vins de la Normandie. |
||||||||||
|
||||||||||