|
||||||||||
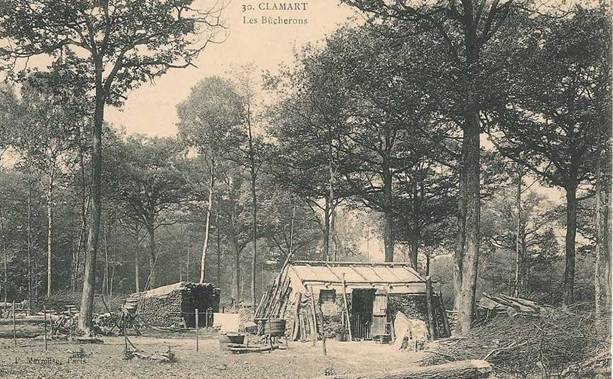 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Un gruyer est un officier public chargé dans le monde plein du XIIIe siècle de s'occuper des forêts domaniales pour le compte d'une autorité légale souveraine. Il met en réserve les domaines boisés ou hagis, contrôle les usages coutumiers et juge en première instance les délits commis dans les forêts et les rivières de sa circonscription ou gruerie, à commencer par les déprédations ou les mésusages paysans.
Ce titre est utilisé très longtemps en Bourgogne, en Franche-Comté, en Bretagne, ainsi qu'en Lorraine où les grueries subsistent jusqu'en 1747. La réformation des forêts met un terme à cette fonction qui peut toutefois être décrite comme la glorieuse ancêtre des premiers offices des Eaux-et-Forêts.
Histoire du mot et d'une fonction
Le mot gruyer en ancien français a une origine féodale au XIIe siècle. Il provient du gallo-romain grodiarius, le maître forestier chargé de gérer la part non cultivé ou allouée d'un domaine, c'est-à-dire la manse domaniale principalement mise en réserve. Elle comporte le capital réservé d'un domaine, soit le cheptel nourri à la bonne saison et les bois de valeur.
Rappelons que, si le saltus gallo-romain est un espace à usage et à prédation ouverte et commune, la foresta mérovingienne est étymologiquement "en dehors des états", donc du domaine ou villa. L'espace de la foresta est simplement géré à part, pour préserver bois, clairière, prairie, flore et faune sacrées. Le roi germanique et sa cour, peut-être la noblesse gallo-romaine y avaient des privilèges de chasse. Le francique gruoli, ce qui est vert, a influencé par rapprochement la fonction. Désormais les forestiers ou forestarii, habillé de façon reconnaissable en vert, exercent une fonction collective de protection de l'ordre du monde. Un sens collectif d'espace mis en commun, où chacun a des droits définis, apparaît. Si les pauvres n'ont pas de droit de chasser le grand gibier, ils peuvent ramasser le bois mort et capturer certains petits animaux.
Le mot féodal s'est appliqué par essence à une possession privée. Il peut s'agir d'un garde privé au service d'un seigneur propriétaire. Le terme a aussi fini par désigner un noble qui possède un droit d’usage et de justice sur les bois d’un vassal.
L'officier gruyer intervient dans la récupérations des épaves. Celle-ci peuvent être un troupeau ou un animal domestique divaguant, un gibier imprévu, un chariot délaissé par des pilleurs de bois en fuite, une attelage saisi en délit de traînage, une voiture de bois dérobé... Les procès verbaux rédigés depuis la généralisation de cette fonction de protection des forêts témoignent de la vie quotidienne dans les forêts.
Le droit de gruerie
Originairement, le droit de gruerie était une taxe que le Souverain prélevait notam-ment sur certains bois appartenant aux gens de mainmorte : dès l'origine, les gruyers furent à la fois comptables et administrateurs et cette dualité de fonction durera jusqu'à l'occupation française en 1681.
Les comptes de grueries contiennent de véritables règlement pour l'exploitation des forêts ducales.
Le gruyer est assisté du "contrerolleur" ou contrôleur qui frappe au corps de son marteau les arbres qui ont été marqués à la racine par le gruyer et dresse un compte de gestion devant permettre de vérifier celui du gruyer.
L'organisation de la gruerie était complétée par l'arpenteur-juré, chargé d'asseoir les coupes et de les diviser en lots de vente de 1 ou 2 arpents, et par les gardes ou fores-tiers affectés à la surveillance et à la constatations des délits, dont ils devaient faire au gruyer un rapport verbal dans un délai assez court. Les gages de ces forestiers étaient très faibles mais ils touchaient des émoluments pour leurs participations aux opérations, les délivrances faites aux usagers. Ils avaient droit également à une part des amendes pour les procès verbaux qu'ils avaient rapportés |
||||||||||